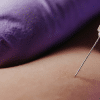Éditorial essais de mars : Enfin libres !
Par
Publié le
8 mars 2022
Partage

Parmi les sources d’étonnement que l’épidémie de Covid n’a cessé de fournir, l’idée d’un retour impossible au monde d’avant est probablement celle qui ne laisse de surprendre puisqu’elle argue d’un changement radical que la crise aurait provoqué… comme s’il y avait eu un monde d’avant plus aimable et dont la dynamique nous emmenait autre part qu’à l’endroit où nous sommes rendus à présent.
Bien sûr, on n’ignore pas que certains bouleversements occasionnent parfois un bond quantique susceptible de favoriser des tendances sous-jacentes que l’on n’avait pas encore identifiées aussi clairement. Mais, au fond, de quoi parle-t-on lorsque l’on parle du monde d’avant l’épidémie ? Du monde mis sous surveillance depuis la fin des années 90 en raison d’un terrorisme métastatique ou faut-il remonter plus loin et regretter les fabuleuses années 80 quand le capitalisme nous fit croire que chacun, sous l’effet de sa seule volonté, pouvait plier le monde à son désir et arraisonner l’ensemble du vivant ? Ou alors imagine-t-on encore que les années 70 furent une décennie enchanteresse, éprise de libertés, alors que, hors l’image d’Épinal, on sait que la licence que réclamaient les hippies qui accouchèrent cette époque maudite s’avéra la condition sine qua non du flicage que l’autonomisation toujours plus poussée de l’individu moderne réclame.
Plus l’individu se libère de ce qui le contrôle à un niveau immédiat, plus il est nécessaire de le contrôler via la surveillance généralisée
Sauf à considérer que le monde tient debout tout seul et qu’il s’agit d’harmoniser l’action humaine avec le mouvement du Cosmos, lequel maintiendrait dans son être, tel un dieu bienveillant, tout ce qui se plierait à son économie – ce qui implique par ailleurs de rabattre l’humain sur l’animal – plus l’individu se libère de ce qui le contrôle à un niveau immédiat par des limites aussi symboliques que coercitives, la famille, la nation, la religion, bref, par la morale, plus il est nécessaire de le contrôler via la surveillance généralisée, qui n’est que le stade terminal de la liberté telle qu’on la vante depuis qu’on a décidé qu’un homme existait pour lui-même indépendamment des autres.
Autrement dit, notre liberté de faire ce que l’on veut, d’aller où bon nous semble sans rendre de compte à personne, amène irrémédiablement le crédit social, si l’on a des tendances étatistes et qu’on sacrifie à l’idée que le pouvoir est transcendant à ceux qu’ils gouvernent, ou bien l’eugénisme pour les plus libertaires, pour ceux qui pensent que l’homme est à lui-même sa propre mesure et qu’il lui suffit, pour base politique, de laisser la nature sélectionner selon ses règles qui mérite de survivre, et qui ne le mérite pas. Deux cauchemars tout droit issus du fabuleux monde d’avant que beaucoup regrettent parce qu’on y aurait été libres. C’est d’ailleurs à peu près ces deux mondes qui désormais se dessinent sous nos yeux, s’entrelaçant jusqu’à se confondre, et qui devraient rassurer ceux qui se désolent de ne plus vivre dans le fameux « monde d’avant » puisque celui d’après semble le continuer fondamentalement et par là continuer en la portant à son paroxysme cette liberté que d’aucuns craignaient avoir perdue.
Lire aussi : Éditorial essais de février : Des conséquences de ce que l’on pense et de la dynamite
On pourrait par facilité incriminer là le fameux paradoxe de Bossuet, mais cela ne nous avancerait pas à grand-chose ; il serait plus sage d’avouer que la liberté avec laquelle on nous bassine depuis deux ans, pour ce qu’elle nous apporte en fin de compte, n’est rien qu’une statue creuse qu’il serait bon de briser une fois pour toutes de telle sorte qu’on puisse en retrouver une un peu plus authentique, définitivement séparée des turpitudes contemporaines où nous nous baignons comme des cochons ravis de leur propre boue.
EN KIOSQUE
Découvrez le numéro du mois - 6,90€
Soutenez l’incorrect
faites un don et défiscalisez !
En passant par notre partenaire
Credofunding, vous pouvez obtenir une
réduction d’impôts de 66% du montant de
votre don.
Retrouvez l’incorrect sur les réseaux sociaux
Les autres articles recommandés pour vous
Restez informé, inscrivez-vous à notre Newsletter