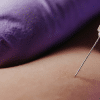Affaire Weinstein : croyons-nous encore au libre-arbitre ?
Par
Publié le
15 novembre 2017
Partage

[vc_row][vc_column][vc_column_text css= ».vc_custom_1510736260801{margin-right: 25px !important;margin-left: 25px !important;} »]
Il est tentant de mettre l’indignation consécutive à l’affaire Weinstein sur le compte de l’hypocrisie. Mais elle vient de plus loin : cette indignation, comme la proscription effrayante qui frappe l’œuvre de M. Weinstein, est le fruit d’une conception spécifique du bien et du mal, qui pervertit nos jugements.
Hollywood a découvert avec horreur qu’il avait nourri un monstre pendant des années. La brutalité de la proscription médiatique décrétée à l’encontre de M. Weinstein a quelque chose de disproportionné. Alors même qu’il n’a pas encore fait l’objet d’une condamnation pénale et qu’il est donc, pour l’heure, présumé innocent, il est devenu la cible d’une campagne sans précédent visant à effacer son nom de l’histoire du cinéma. Il est expulsé de l’Académie des Oscars et du Syndicat des producteurs d’Hollywood. Les hôtels cannois font disparaître ses photos. On songe en haut lieu à lui retirer sa Légion d’Honneur. Son nom est effacé des Planches de Deauville et cesse même d’être mentionné dans les génériques des séries qu’il a produites.
L’affaire a ceci d’intéressant qu’elle révèle avec acuité la conception du bien et du mal qui domine la société occidentale. À nos yeux, l’homme est moralement déterminé. Sa bonté ou sa malice lui est essentielle et intrinsèque. Méconnaissant le péché originel, nous ne voyons pas que le mal existe en germe dans le cœur de tout homme, y compris le plus vertueux ; nous ignorons que faire le bien résulte d’un choix libre, conscient et continu, et non uniquement d’une disposition naturelle. Nous oublions que le libre-arbitre suppose précisément d’arbitrer. D’où notre étonnement lorsque défaille un homme considéré comme bon, ou du moins admirable par son talent.
La surprise d’Hollywood est probablement plus sincère qu’on ne le dit : selon toute probabilité, beaucoup de ceux qui ont entendu les rumeurs courant au sujet de M. Weinstein n’y ont pas cru ou en ont minimisé la gravité parce qu’il ne pouvait pas pécher, parce qu’il était du même monde qu’eux : n’était-il pas un des plus grands mécènes de Madame Clinton ? Parce que nous croyions qu’il était intrinsèquement bon, nous pensions qu’il ne pouvait pas commettre d’actes mauvais. Mais s’il les commet, c’est qu’il est lui-même intrinsèquement mauvais ; dès lors, rien ne lui sera pardonné : ni ses actes bons, ni ses grandes réalisations. Cela explique qu’il ait été si imprudemment protégé, puis si violemment attaqué, non seulement – à juste titre – pour ses agissements privés, mais aussi, ce qui est infiniment plus contestable, dans son œuvre.
Lire aussi : Harvey Weinstein est-il un porc-émissaire ?
L’idée de la prédétermination morale de l’homme est vieille comme le monde. Elle justifie le système indien des castes ; dans le monde chrétien, elle a été professée sous des formes diverses par les gnostiques, les marcionites, les manichéens, les cathares et les calvinistes, pour ne citer que les hérésies les plus notoires. Les courants déterministes du siècle dernier, en psychologie comme en sociologie, ont achevé de la répandre dans l’inconscient collectif, où elle règne en maître. Or cette doctrine pose de graves problèmes. Elle nous conduit à oublier que ce sont nos actes, et non nos prédispositions, qui font de nous des justes ou des pécheurs. Le christianisme est fondé sur la conviction que même les plus grands saints sont perméables au péché, et même les plus grandes crapules à la grâce. Nous l’avons oublié. Or si certains hommes sont intrinsèquement mauvais, le pardon est impossible. Le christianisme, dans ce qu’il a de plus beau et de plus révolutionnaire, se retrouve éviscéré.
Ce déterminisme moral est d’autant plus problématique qu’il se conjugue, dans notre axiologie, avec l’affirmation d’une autonomie radicale : d’un côté, l’homme est moralement déterminé ; de l’autre, il choisit ses propres règles. Nous définissons la liberté non pas comme le libre choix à l’intérieur des contraintes du réel, mais comme le choix libéré de ces contraintes. Or la liberté, ainsi conçue, n’a plus la moindre valeur ; elle a la mollesse du caprice. Sans digues ni barrages, l’être, comme l’eau, ne s’élève pas : il se contente de se répandre.
Lire aussi : La gauche caviar n’aime pas les femmes
Cette conception explique l’arrogance de notre conception du progrès. Nous croyons résoudre la contradiction interne à notre discours en affirmant que le progrès nous a délivrés de nos déterminismes et des contraintes de notre être, et qu’il nous a permis de réaliser notre liberté. Nous avons cru accéder à la lumière en étouffant le conformisme du bourgeois sous la licence du bohème. Nous croyons être ce que les gnostiques appelaient les pneumatiques, êtres d’esprit et d’âme à qui le salut est réservé, par opposition aux hyliques, êtres de matière et de boue, insusceptibles de rédemption. Les derniers hyliques arrimés à leurs déterminismes, les « fainéants et les extrêmes », les beaufs arriérés, les réactionnaires impénitents et les fanatiques religieux que le Zeitgeist n’a pas submergés, sont des prisonniers qui ne méritent que notre haine ou notre dédain.
Cette morale, malgré ses règles lâches, est d’une dureté infinie. Nous ne pardonnerons jamais à Harvey Weinstein. La morale que nous nommons chrétienne était comparativement bien plus douce, car ses préceptes tatillons portaient en filigrane l’empreinte lumineuse de la miséricorde. Nul n’était certain d’être sauvé : c’est pourquoi la morale chrétienne était pleine de scrupule. Mais nul n’était certain d’être condamné : c’est pourquoi la morale chrétienne était pleine d’espérance.
Nous avons détruit la morale chrétienne en croyant détruire la culpabilité. Mais nous n’avons détruit, hélas, que l’espérance.
[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]
EN KIOSQUE
Découvrez le numéro du mois - 6,90€
Soutenez l’incorrect
faites un don et défiscalisez !
En passant par notre partenaire
Credofunding, vous pouvez obtenir une
réduction d’impôts de 66% du montant de
votre don.
Retrouvez l’incorrect sur les réseaux sociaux
Les autres articles recommandés pour vous
Restez informé, inscrivez-vous à notre Newsletter