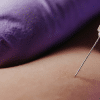Journal d’un confinement incorrect – premiers jours
Par
Publié le
21 mars 2020
Partage

[vc_row][vc_column][vc_column_text css= ».vc_custom_1584790357821{margin-right: 25px !important;margin-left: 25px !important;} »]
Constatant comment n’importe quelle starlette surestimée s’était mise à publier son journal de confinement, Maximilien Dreyer, écrivain maudit et de droite, a décidé d’explorer à son tour ce nouveau genre littéraire. À sa manière à lui.
Jour 4 : Après Leïla Slimani dans Le Monde, c’est la Darrieussecq qui s’y colle pour Le Point. Leur style n’avait aucun intérêt. Leurs vies non plus. Des directeurs de journaux ont dû parier sur le fait que leurs vies sans intérêt, mais en confinement, et relatées sans le moindre allant, voilà qui atteindrait un tel degré d’ennui que ça en deviendrait fascinant. De l’art contemporain. En fait, non. C’est juste très, très chiant, plutôt que seulement dispensable. Mais ça m’a poussé à l’action. Si n’importe quelle cruche surévaluée se doit de consigner ses journées pour contribuer à l’effort de guerre, alors pourquoi pas moi ? Puisque Slimani existe, alors tout est permis ! Enfin… Le mot « guerre » est galvaudé de nos jours.
Lire aussi : L’Incoronavirus – Jour 4
Le président, qui adore se donner des airs solennels, user d’anaphores et de trémolos, attendait la première occasion possible pour l’employer à nouveau, il adore ça. Mais enfin, la dernière fois, il s’agissait d’éclairer la Tour Eiffel, de lancer des ballons, de ne pas désigner l’ennemi et de garder sa haine pour soi. On était loin de l’effort surhumain des Poilus. Cette fois-ci, la « guerre » signifie qu’il faut rester à la maison. Je ne dis pas, c’est une grande épreuve pour quelqu’un comme moi, mais enfin, une guerre, ça implique d’être prêt à mourir pour sauver quelque chose de grand. Là, il s’agit d’être décidé à ne pas mourir pour sauver quelque chose d’un peu dérisoire : soi-même.
Ça n’a pas le même cachet. Quoi qu’il en soit, vu que les Français, comme on aime à le dire, ont toujours une guerre de retard, j’étais quant à moi encore mobilisé sur la ligne Maginot de la résistance en terrasse quand les terrasses ont fermé et qu’on m’a expliqué que les Boches arrivant à pied par la Chine (je résume), il allait falloir résister en appartement. Un petit geste de loin, désolé et entendu, aux camarades Slimani et Darrieussecq, j’arrive un peu en retard, c’est vrai. Me voici au rapport, les filles. Récapitulation.
Jour 1 : Réveillé vers 13h. Je mets un certain temps à rapatrier mes souvenirs et à remplir les trous grâce aux photos qu’on m’a expédiées sur mon portable. Il semblerait que je n’aie pas dessaoulé depuis samedi soir. Il fallait dire au-revoir à ses amis qu’on n’allait pas revoir durant des semaines, à ces nouveaux amis qu’on venait de rencontrer, à ces passants qu’on aurait aimé connaître, à ces inconnus si sympathiques, à ce jeune homme occupé à vomir sous un pont, à ces mouettes plongeant sur la Seine, à ce monstre jovial, à ce bus éloquent, à ces nymphes à la renverse, bref, et ces adieux sans embrassades, néanmoins, s’éternisèrent. 13h30 : mal de tête, courbatures, légère fièvre… Suis-je infecté ? 14h : Non, juste une gueule de bois classique. 15h : Me voici douché, vêtu, rasé de frais, prêt à faire des réserves pour tenir le siège. Mais dehors : horreur ! C’est Paris à l’heure soviétique avec de longues queues immobiles devant les supermarchés.
13h30 : mal de tête, courbatures, légère fièvre… Suis-je infecté ? 14h : Non, juste une gueule de bois classique.
Je déteste attendre sagement derrière les autres. Plutôt mourir de faim. Heureusement, j’aperçois, accueillant et directement accessible, le primeur maghrébin et ses joyeux vendeurs. C’est ça qui est pratique avec les Arabes, du moins intramuros, ils sont rieurs et se foutent de l’hygiène. Pas un masque, pas un gant, ils jonglent avec les oranges en attendant le client comme si aucune mesure spéciale n’était en mesure d’entamer leur bonne humeur. Si l’on compare aux Asiatiques qui, à Paris, portent tous leurs masques depuis dix jours comme s’ils n’attendaient que le premier prétexte sanitaire possible pour se dissimuler la tronche et démontrer la qualité de leur discipline collective ! Quelle arrogance… Je reviens chargé de plusieurs sacs emplis de pommes, d’oignons, de carottes, d’avocats, de noisettes, de brocolis. Le virus peut venir, j’ai de quoi tenir…
Jour 2 : Deux jours. J’ai de quoi tenir deux jours. Ai passé la journée à reprendre l’introduction de mon grand livre à écrire pour me mettre tout le monde à dos : Le Fascisme, c’était mieux avant, qui, en dépit du titre, n’a aucune prétention politique, et puis j’ai fait plusieurs séries de pompes sur du Wagner (puisqu’on est en guerre, mettons-y les moyens), avant de m’employer à méditer longuement sur la situation, sortant au besoin, de ma bibliothèque, Les Pensées de Pascal, Les Confession de saint Augustin et les Sermons de Maître Eckhart, prenant des notes, fumant sur mon balcon, griffonnant des schémas sur des feuilles volantes. Dîner à base brocolis vapeur parsemés de noisettes avec du riz. Soudain, illumination : cet enfoiré de virus est en train de faire de moi un enculé de vegan.
Lire aussi : Une pandémie de Coronavirus était plus que prévisible : elle était attendue
Jour 3 : Je dois trouver de la viande, par tous les moyens. J’élabore un plan en fixant le portrait en pied de Charrette qui est accroché au-dessus de mon bureau. Voyons : j’ai l’habitude de faire mes courses au Monoprix du coin, un supermarché de riches ; or, j’ai pu constater que les pauvres sont bien moins disciplinés, du moins les pauvres parisiens. Atavisme de leurs cultures d’origine, défaut d’éducation, désinvolture devant un destin de toute manière pas si radieux… Je ne sais. De toute manière, mon problème n’est pas sociologique, il est d’être efficace. Moins les clients sont disciplinés et scrupuleux, moins l’attente est longue. Voilà l’enjeu.
M’insinuant moi-même dans des mœurs débraillées que je n’aurais pas contribué à créer, aucune raison de culpabiliser. En moins de vingt minutes, je parviens à acquérir un gros steak au Franprix de la rue d’à côté. Et huit bouteilles de vin. Apéro-skype avec une copine qui n’habite pourtant qu’à deux cent mètres de chez moi – sensation de l’absurde à faire pâlir Kafka. « L’abstinence va rendre tout le monde fou, présage-t-elle. Il va y avoir saturation de dick pics sur les réseaux. Griveaux passera pour un précurseur. » Je n’ai jamais compris l’intérêt de la sexualité virtuelle, si cette expression à un sens (masturbation améliorée me paraissant plus adéquat). Pour moi, il s’agit de la même aporie qu’une boîte à strip tease : faire monter le désir de toucher et ne jamais pouvoir toucher. Le Sisyphe du cul.
Je n’ai jamais compris l’intérêt de la sexualité virtuelle, si cette expression à un sens (masturbation améliorée me paraissant plus adéquat). Pour moi, il s’agit de la même aporie qu’une boîte à strip tease : faire monter le désir de toucher et ne jamais pouvoir toucher. Le Sisyphe du cul.
21h : Je sonne chez ma voisine pour lui demander le prêt d’un tire-bouchon. C’est une petite brune, étudiante, l’air maussade. Elle me tend l’engin. « Merci, partageons la bouteille, si cela vous tente ! » Je l’installe sur mon canapé, tamise la lumière, lance une playlist duveteuse. Nous trinquons. L’avantage du confinement, nous réjouissons-nous, c’est qu’il permet de revenir à des choses simples, élémentaires, que nos vies trop sophistiquées, artificielles, connectées, nous font perdre de vue – comme échanger avec ses voisins. Tu m’étonnes. Puis j’ai surtout envie de baiser et les bars sont clos.
Par Maximilien Dreyer
[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]
EN KIOSQUE
Découvrez le numéro du mois - 6,90€
Soutenez l’incorrect
faites un don et défiscalisez !
En passant par notre partenaire
Credofunding, vous pouvez obtenir une
réduction d’impôts de 66% du montant de
votre don.
Retrouvez l’incorrect sur les réseaux sociaux
Les autres articles recommandés pour vous
Restez informé, inscrivez-vous à notre Newsletter