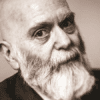À VOIR OU À FUIR, C’EST LA SEMAINE CINÉMA DE L’INCORRECT
Par
Publié le
26 juin 2019
Partage

[vc_row][vc_column][vc_column_text css= ».vc_custom_1561548379046{margin-right: 25px !important;margin-left: 25px !important;} »]
Une descente dans l’abîme de la lobotomie, une ballade dans un Québec à la recherche de son indépendance et une plongée au cœur d’un kibboutz, que faut-il voir ou ne pas voir au cinéma cette semaine.
The Mountain : une odyssée américaine
THE MOUNTAIN (1h 48) De Rick Alverson, Avec Jeff Goldblum, Tye Sheridan, Denis Lavant. En salle le 26 juin
Rick Alverson, réalisateur remarqué aux états-unis pour sa singularité, présente ici son cinquième film, premier néanmoins, à atterrir jusque dans les cinémas français. Dès l’ouverture, le style est immanquable : le format carré, les compositions géométriques et esthétisantes, le grain, sont autant d’éléments qui affirment déjà une personnalité artistique forte. Le plus souvent filmé en plan fixe, les mouvements, très lents, précautionneux, deviennent précieux, et l’ensemble nous rappelle alors des peintures, sortes de natures mortes réanimées. Dès lors, on sent cette volonté de laisser le temps aux images d’être, pour que l’on s’imprègne de leur symbolique.
Le réalisateur construit alors un temps qui lui est propre, dont l’écoulement frustrant ou jubilatoire, vient finalement nous rapprocher d’une certaine réalité, et fait de The Mountain un film ambitieux mais lent. Cette lenteur, qui n’est pas un défaut en soi, le devient lorsque par le manque d’action et de résolution au coeur de son récit, la présence symbolique devient centrale. Celle-ci perd alors son caractère implicite et son charme, entraînant un jeu analytique élitiste, pour tenter de comprendre un film présenté par ses acteurs, comme apportant plus de questions qu’il n’en résout. Finalement, porté par une mise en scène perfectionniste et un jeu d’acteur minutieux, ce film quasi-abstrait, aux qualités nombreuses, semble se perdre à son propre jeu, imbu de ses prétentions.
Tarot Victor
Lire aussi : Nous Finirons ensemble : série culte d’une génération de fumiers
Peinture à l’eau pour alcoolique
VILLE NEUVE (1h 16) De Félix Dufour-Laperrière, Avec Robert Lalonde, Johanne Marie Tremblay, Théodore Pellerin. En salle le 26 juin
Comme des ombres chinoises, des personnages passent, surgissent et se traînent un peu. On se balade au Québec, on rencontre les membres séparés d’un couple, lui, alcoolique, voudrait changer, retrouver sa femme et ses vieux souvenirs, mais il échoue. En fond, un pays en tension en raison du référendum sur l’indépendance. Toute l’originalité et la beauté de ce dessin animé tiennent à sa technique. À la manière dont étaient fabriqués les premiers Disney, Félix Dufour-Laperrière et son équipe ont tout esquissé à la main et passé à l’encre noire, planche par planche.
On est bien loin des logiciels d’animation, d’où cette sensation de douceur et de légèreté. Un régal pour les yeux, plein de suggestions subtiles comme, par exemple, la maison en feu, symbole du foyer brisé et du Québec divisé. Une belle image peut se passer souvent de dialogue, mais pas toujours, et c’est là où le bât blesse. Même ponctué d’instants de rage, d’émotion ou de poésie, le récit reste poussif et on ne comprend pas où l’on veut nous mener. Juste beau ; c’est peu, mais c’est déjà beaucoup.
Jeanne Battesti
Rififi dans le kibboutz
UN HAVRE DE PAIX (1 h 31) De Yona Rozenkier, Avec Yoel Rozenkier, Micha Rozenkier, Yona Rozenkier. En salle le 12 juin
Trois frères se retrouvent pour enterrer leur père dans le kibboutz de leur enfance. Avishaï, le plus jeune, doit partir deux jours plus tard à la frontière libanaise où un nouveau conflit vient d’éclater. Il sollicite les conseils de ses frères qui ont tous deux été soldats. Itaï souhaite endurcir le jeune homme tandis que Yoav n’a qu’une idée en tête : l’empêcher de partir. Le testament du père va réveiller les blessures secrètes et les souvenirs d’enfance…
Brutalement jeté au beau milieu de ce havre étrange où le temps semble flotter et où le hippie porte une kalash, on se demande pendant un bon quart d’heure ce qu’on est venu foutre là. Rozenkier joue une partition espiègle entre comédie noire et drame familial, use de soudaines ruptures de ton et nous colle aux basques de ses personnages sans qu’on prenne le temps de faire connaissance. Mais rapidement les silhouettes se précisent, la narration gagne en tension et le film en noirceur. S’il montre peu de style, ce Havre de paix efficace et parfaitement interprété, nous séduit et nous interpelle.
Arthur de Watrigant
[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]
EN KIOSQUE
Découvrez le numéro du mois - 6,90€
Soutenez l’incorrect
faites un don et défiscalisez !
En passant par notre partenaire
Credofunding, vous pouvez obtenir une
réduction d’impôts de 66% du montant de
votre don.
Retrouvez l’incorrect sur les réseaux sociaux
Les autres articles recommandés pour vous
Restez informé, inscrivez-vous à notre Newsletter