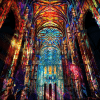Le rose et le noir
Par
Publié le
25 juillet 2023
Partage
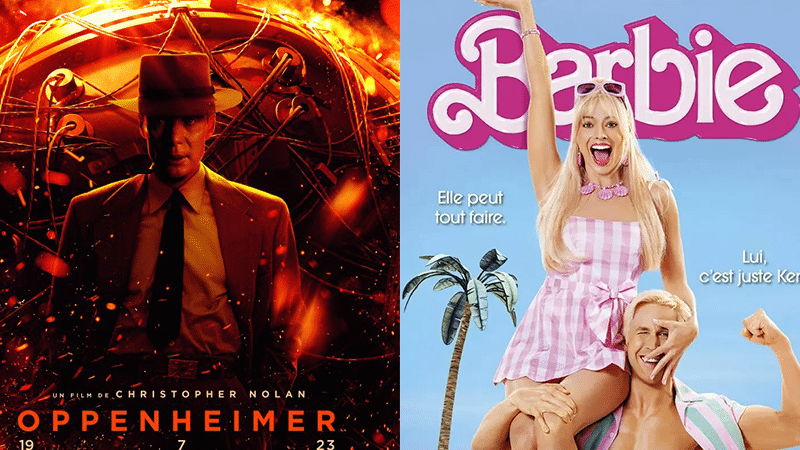
Une erreur communément admise avec Barbie et Oppenheimer veut que ce soient tous deux des films. Or, avant même l’échelon inférieur de produits – et de stade ultime, poli à la puissance hollywoodienne – ce sont des idées : l’idée du film Barbie et l’idée du film Oppenheimer. Qui peuvent toutes deux se décliner en propositions contradictoires que les films feront semblant de départager :
– Barbie aide-t-elle la cause des femmes ? Autrement dit, est-elle féministe ou non ?
– Oppenheimer regrette-t-il que son travail ait mené à la mort des centaines de milliers d’innocents, ou pas du tout ?
Le but est de rendre la thèse indiscernable de l’antithèse, la synthèse se calculant en dollars à la fin de l’exploitation. Il conviendra donc d’apporter de l’eau aux deux moulins, de donner l’illusion de la complexité, tout en respectant le genre d’origine des produits : fantaisie « pop » décalée comme un crabe boiteux, biopic patapouf sur la nature prométhéenne de l’Homme.
Pour ancrer les produits, il conviendra de jouer sur l’identification des œuvres et de leurs créateurs, et partant de leurs publics à venir. Le narratif est trouvé d’emblée, on a d’un côté :
– Greta Gerwig, l’ancienne actrice-égérie hipster volant enfin de ses propres ailes (i.e. celles de l’industrie) sur un projet mondial après deux médiocrités indés personnelle/impersonnelle (Lady Bird) et sentimentale de patrimoine (Les Filles du Dr Marsh). Barbie quittant Barbieland pour le monde réel, ce serait un peu elle…
– Christopher Nolan, le pape du blockbuster intelligent (?) et aspirant-Kubrick (ou plutôt Kubrique, si l’on se base sur son matériau de prédilection, numérique ou non, qui explose par dizaines de millions dans Inception et la saga des Batman). Le projet d’une vie se concrétiserait enfin avec Oppenheimer, car J. Robert, ce serait un peu lui…
Les publics captifs sont ferrés, d’un côté la gent féminine pas tout à fait dans son ensemble (mais additionnée de quelques contingents LGBTQIA+), les cinéphages adulescents persuadés que Nolan est un Grant-Ôteur. Les metteur.e.s en scène n’ont plus qu’à rester fidèles l’une à la poupée « iconique » (et surtout à Mattel), l’autre au Grand Sujet, dont s’est jadis si justement raillé le jeune Chabrol critique (ou du moins à Kai Bird, le biographe adapté ici).
Il suffira d’inventer quelques légendes suggérant le gigantisme pour faire monter le désir dans la masse bovine des spectateurs indifférenciés : le tournage de Barbie aurait conduit à une pénurie mondiale de peinture rose, Nolan aurait filmé une explosion atomique déclenchée pour l’occasion (ce qui est doublement faux). Quels sont ces films qui infléchissent le monde ? Rien que des idées…
Barbie et Oppenheimer ne trouvent pas le temps de respirer : ils parlent, parlent sans s’arrêter, et quand ils se taisent un peu, la musique parle à leur place, sachant que, chez Nolan, elle recouvre de toute façon à peu près tout. Le silence est assimilé à un temps mort ; tout est fait pour que les spectateurs ne puissent réfléchir à ce qu’ils voient, de crainte de perdre un dialogue. Se rajoute dans Oppenheimer la fameuse structure éclatée-fluide qui, avec la démultiplication des personnages, tire le spectateur comme un bambin dépassé ne comprenant pas ce qui lui arrive.
Si le but de Nolan est de paraître plus intelligent que son public, Gerwig souhaite plutôt mettre le sien dans sa poche, d’où les différents registres d’humour, la pseudo-insolence et les allusions hors-sol (par exemple à Stephen Malkmus, la réalisatrice ayant bien deviné que de pauvres gars seraient traînés par leur copines ; au moins, pourront-ils esquisser un sourire à la mention du leader de Pavement.)
Tout dans l’écriture indique que Nolan ne pose que superficiellement la question de la culpabilité.
Il convient toutefois de relever deux silences dans Oppenheimer, qui ne convoquent pas l’intellect mais préparent au pire. Pour que le souffle atomique de l’essai Trinity agisse pleinement, tout bruit doit cesser. Et lors de l’hallucination de Oppenheimer (Cilian Murphy) pendant son discours post-bombe, la bande-son se vide, ne conservant qu’un vrombissement sinistre (le malheureux verra bientôt des corps carbonisés). Le silence est, comme au cirque, le roulement de tambour avant le numéro de tous les dangers.
Il est vrai que leurs personnages principaux posent problème à Gerwig et à Nolan. Simple réceptacle à fantasmes infantiles, Barbie n’a aucune existence, et le déroulé de péripéties méta- ou pas n’entame sa surface ni à Barbieland, ni dans notre monde ; elle se fait donc logiquement voler la vedette par Ken (Ryan Gosling).
Quant à Oppenheimer, la profondeur attendue est perpétuellement contredite par l’entrelacs de trois fils temporels et une factualité besogneuse qui ne s’élève qu’à hauteur de fatras signifiant (Florence Pugh chevauchant Murphy en le faisant lire à voix haute les mots de Vishnou : « Mais je suis devenu la Mort, le destructeur des mondes »). La dernière heure est intégralement consacrée à l’affrontement avec sa Némésis personnelle, Lewis Strauss (Robert Downey Jr) par le biais de deux commissions menées en parallèle mais non synchrones où les deux sont jugés pour leur potentielles déficiences (Oppenheimer serait peut-être un espion russe, Strauss l’aurait peut-être conduit à sa perte par pur ressentiment personnel).
Tout dans l’écriture indique que Nolan ne pose que superficiellement la question de la culpabilité. Le Projet Manhattan apparaît comme un décor de tournage avec Oppenheimer en metteur en scène dont le producteur/commanditaire serait le colonel Groves (Matt Damon). Cet émiettement de la responsabilité se retrouve dans la scène pivot avec Einstein et Strauss – d’ailleurs représentée deux fois – où le mutisme du premier envers le second trouve son explication dans l’échange précédent entre Oppenheimer et le prix Nobel. La généalogie de la faute nucléaire est remontée aux théoriciens et descendue à ses prolongateurs : à l’en croire, personne au final n’est seul responsable. Cette scène renvoie à l’unique chef-d’œuvre de Nolan, Le Prestige, comme on le voit au motif du chapeau renversé. Les deux antagonistes – Christian Bale et Hugh Jackman – y étaient conduits, dans une implacable réaction en chaîne pré-atomique, à perdre chaque fois un peu plus une partie constitutive de leur être, jusqu’à l’annihilation finale. Dans Oppenheimer, l’antagoniste du héros est double, Strauss et sa conscience.
Bouclons sur le final gerwigien où la poupée choisissant le monde réel, comme la Petite Sirène, apparaît toute ravie d’enfin aller chez son gynéco. Le vagin de Barbie est comme le remords d’Oppenheimer, il existe peut-être mais on n’en voit trace.
Reste l’autopublicité démente de deux pures réalisations de l’industrie, jusque dans leur sortie concomitante. On n’échappera pas aux poupées Barbie vendues pas millions grâce à Greta, ni à la stature un peu plus (h)auteurisée de Nolan grâce à Oppie. Le consommateur choisit des produits, mais ce sont les vrais films qui vous choisissent.
EN KIOSQUE
Découvrez le numéro du mois - 6,90€
Soutenez l’incorrect
faites un don et défiscalisez !
En passant par notre partenaire
Credofunding, vous pouvez obtenir une
réduction d’impôts de 66% du montant de
votre don.
Retrouvez l’incorrect sur les réseaux sociaux
Les autres articles recommandés pour vous
Restez informé, inscrivez-vous à notre Newsletter