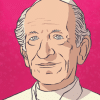Relisons Donoso Cortès !
Par
Publié le
7 mai 2020
Partage

[vc_row][vc_column][vc_column_text css= ».vc_custom_1588854982178{margin-right: 25px !important;margin-left: 25px !important;} »]
Durant le confinement, l’écrivain Luc-Olivier d’Algange s’est replongé dans Donoso Cortès, dont il nous donne ici une lecture revigorante. Contre l’oppression matérialiste où l’on prétend nous délivrer, osons le Droit Divin !
« Ce qu’ont d’extraordinaire et de monstrueux toutes les erreurs sociales, dérive de ce qu’ont d’extraordinaire les erreurs religieuses qui les expliquent et desquelles elles procèdent. » Donoso Cortès
Pour Donoso Cortès, il n’est point d’erreur politique qui ne soit d’abord une erreur religieuse et métaphysique. Ce qui nous livre à l’errance, ce qui nous éloigne de nous-mêmes, ce qui nous invite au reniement, au désastre, à la calomnie, au mensonge, à la déroute et à la bêtise, est toujours ce qui nous éloigne de Dieu, c’est à dire du silence.
Ce silence est quelque peu mystérieux. Il est ce dont procède la parole, cette fine pointe où la parole se délivre du bavardage ; espace infini où la parole retourne à l’oubli. Il est aussi vain de s’insurger contre le langage humain que de croire en son omnipotence. « La première façon de sortir du mensonge, écrit Philippe Barthelet, et la plus offensive – car il s’agit bien d’une guerre intérieure, d’une guerre sainte qu’il nous faut livrer -, est de faire silence. L’ordre grammatical est ici le reflet inversé de l’ordre ontologique, car c’est véritablement le silence qui nous fait ; et c’est le silence qui nous fait parler, véritablement, selon la vérité, et toute parole vraie est à la lettre superflue, elle coule du dehors, déborde, elle n’est là que pour confirmer ».
Lire aussi : Agnès Thill : « Au motif de ne pas mourir, on nous empêche de vivre »
La Lettre au Cardinal Fornari réfute cette première et fatale erreur moderne qui consiste à penser que la Religion, la politique et la philosophie sont des domaines séparés, autonomes, qui vagueraient en d’impondérables mondes à leurs occupations respectives aussi étanches les unes aux autres que des spécialités universitaires, avec leurs jargons, leurs fins particulières et insolites. Pour Donoso Cortès, non seulement la Religion n’est pas absente de la politique ou de la philosophie mais celles-ci sont toujours religieuses, l’ordre grammatical s’ordonnant à l’ordre ontologique, même et surtout lorsqu’elles s’évertuent à nier ou à défaire la Religion.
UN AUTEUR TOUJOURS PLUS ACTUEL
Les aperçus de Donoso Cortès sont de ceux, fort rares, qui gagnent en pertinence à mesure que le temps nous éloigne de leur formulation. Mieux qu’en 1848, par exemple, date de son Discours sur la dictature, nous pouvons vérifier et approfondir sa pensée et prendre la mesure de la titanesque erreur religieuse qu’est le matérialisme, cette adoration de la physis, dont sont issus la démocratie, en tant que dictature du nombre, et les diverses formes de totalitarisme, en tant qu’accomplissements de la « promesse » démocratique dans l’utopie d’une socialisation extrême, fusionnelle, des rapports humains, où la raison ni les principes ne tiennent plus aucune place. « On pourrait constater, d’une façon très générale, écrivait René Guénon, que l’apparition de doctrines naturalistes ou anti-métaphysiques se produit lorsque l’élément qui représente le pouvoir temporel prend, dans une civilisation, la prédominance sur celui qui représente l’autorité spirituelle »
Nous pouvons vérifier et approfondir sa pensée et prendre la mesure de la titanesque erreur religieuse qu’est le matérialisme, cette adoration de la physis, dont sont issus la démocratie, en tant que dictature du nombre, et les diverses formes de totalitarisme, en tant qu’accomplissements de la « promesse » démocratique dans l’utopie d’une socialisation extrême, fusionnelle, des rapports humains, où la raison ni les principes ne tiennent plus aucune place.
« Désormais, plus aucun Allemand ne sera seul », cette phrase prononcée par Hitler à sa prise de pouvoir par les urnes semblait à Henry de Montherlant la plus effrayante qui soit sous l’apparence d’un bon-sentiment anodin. Phrase terrible, en effet, laissant transparaître la volonté d’établir un monde d’où la solitude, la contemplation, la distance, et le silence, et les profondes raisons d’être du silence, seraient bannis au nom de la « volonté commune », d’une adoration panthéiste de la nature. Or, que nous dit Donoso Cortès dans sa Lettre au Cardinal Fornari ? « La raison est aristocratique alors que la volonté est démocratique ».
Le totalitarisme est l’accomplissement, la réalisation de cette erreur religieuse que constitue la démocratie, en tant que socialisation extrême, outrancière, des rapports humains. Le culte de la matière et la haine de la forme, l’adoration de la fusion immanente et la détestation de la distinction, le sacre de la volonté et l’excommunication de la raison, en tant qu’instrument de connaissance métaphysique : telles sont les conséquences de cette erreur religieuse qui voudrait se faire passer pour une vérité anticléricale, – mais à cet aval désastreux et inhumain correspond un amont dont il n’est pas inutile de tenter l’analyse en usant de la méthode même de Donoso Cortès.
LA MATIÈRE N’EXISTE PAS
En effet, la « matière » telle que la conçoivent les matérialistes, n’existe pas. Elle est cette abstraction « ourouborique », totale, dont le communisme fera sa mystique. Pour le matérialiste, qu’il soit controuvé ou naïf, « tout est matière ». C’est dire que pour lui la matière est l’autre nom du « tout ». Il n’est rien en dehors d’elle et tout ce qui procède d’elle, le langage, la forme, est encore englobé par elle, ou dévoré, comme la filiation de Chronos.
Ce « partout » qui n’est nulle part n’est donc pas une invention nouvelle : c’est le panthéisme : « Pour ce qui est du communisme, écrit Donoso Cortès, il me semble évident qu’il procède des hérésies panthéistes et de l’ensemble de celles qui leur sont apparentées. Quand tout est Dieu et que Dieu est tout, Dieu est, d’abord, démocratie et multitude ; les individus, atomes divins et rien de plus, sortent du tout, qui perpétuellement les engendre, pour retourner au tout, qui perpétuellement les absorbe. Dans ce système, ce qui n’est pas le tout n’est pas Dieu, même s’il participe de la divinité ; et ce qui n’est pas Dieu n’est rien, car il n’y a rien en dehors de Dieu, qui est tout. »
Les hommes, avant que ne s’instaure le politiquement correct, avaient un nom pour ce relativisme, ils le nommaient barbarie. Appellation pertinente rappelant que la barbarie est bredouillement, atteinte portée au vocable et à la grammaire, déficience agressive du langage, accusation permanente, vacarme et confusion.
L’analyse de Donoso Cortès, loin de valoir seulement pour les sociétés étatiques, d’inspiration marxiste, vaut également pour toutes les sociétés à dominante matérialiste, aussi libérales ou « libertariennes » qu’elles se veuillent. Le mot « matérialisme » lui-même, car les mots, sinon l’usage que l’on en fait, sont innocents et ne mentent pas, divulgue sa nature religieuse ; c’est bien le culte de la « Magna Mater », l’immanence déifiée et devenue abstraction. Car la « matière » du matérialiste, et c’est là où se précise, en amont, l’erreur religieuse, n’est jamais présente.
De ce moment où j’écris ces lignes, la « matière », telle que la conçoit le matérialiste, est absente. Certes, je vois la table sur laquelle est posée la feuille de papier, j’aperçois par la fenêtre l’arbre dépouillé de ses feuillages dans la paysage hivernal, je vois et je perçois un nombre infini de choses que je nomme et que je reconnais par leur forme et leur usage, mais la « matière » je ne la vois ni ne la perçois pour la simple raison que la matière est abstraite dans ce « partout » qui n’est « nulle part », alors que la forme est concrète.
Lire aussi : Laurent Alexandre et la droite Bataclan
La matière du matérialiste est ce « tout » devant quoi les hommes doivent se taire et obéir, en croyant se glorifier, alors que les formes sont ce qui nous parle par les noms que nous lui donnons, par l’usage que nous en faisons, par cet entretien infini entre ce qui est en nous et en dehors de nous dont elles sont le principe. La « matière » qui veut être « tout », la « matière » qui n’est point une voix dans un concert de voix de l’âme et de l’Esprit, n’est rien ; et ce « rien » est d’autant plus despotique qu’il n’a pour raison d’être que la négation de la raison et de l’être. Rien de bien surprenant alors, et les craintes de Donoso Cortès se trouvent justifiées par-delà tous les cauchemars, à ce que le matérialisme eût agrandi, jusqu’au vertige, les minimes failles des erreurs religieuses antérieures, au point de laisser les hommes seuls face au néant d’une idolâtrie jalouse.
LE « PROGRÈS » N’EST-IL QUE LE PROGRÈS D’UNE ERREUR ?
On se souvient des premières phrases de l’admirable essai de Mighel de Unamuno, Le Sentiment tragique de la vie : « Homo sum ; nihil humanum a me alienum puto, dit le comique latin. (Je suis homme, et rien de ce qui est humain ne m’est étranger, ndlr.) Et moi je dirai mieux : nullum hominem a me alienum puto. (Nul homme ne m’est étranger) Car l’adjectif humanus m’est aussi suspect que le substantif abstrait humanitas, l’humanité. Ni l’humain, ni l’humanité ; ni l’adjectif simple ni le substantif abstrait, mais le substantif concret : l’homme. L’homme en chair et en os, celui qui naît, souffre et meurt – surtout meurt – celui qui mange, boit, joue, dort, pense, aime ; l’homme qu’on voit et qu’on entend, le frère, le vrai frère ».
De même, le propre de la « matière » du matérialiste, ce « rien » arrogant qui prétend à être « tout », cette abstraction vengeresse, comme toutes les abstractions, sera de nous ôter à la nature éternelle des formes, de nous précipiter dans un monde sans hiérarchie, sans distinctions, sans ferveur et sans pardon, un monde irréel, porté seulement par le frêle esquif de la « morale autonome », sur une houle chaotique et désespérante, antérieure au Verbe.
Définir le matérialisme comme un « progrès » par rapport à la Théologie médiévale, donne au mot « progrès » un sens particulier, dont Jean Cocteau eut l’intuition lorsqu’il écrivit que « le progrès n’est peut-être que le progrès d’une erreur ». Les Modernes répètent volontiers la formule « l’erreur est humaine » en oubliant son pendant « mais la persévérance dans l’erreur est diabolique ». Or, si le « progrès » est bien le progrès d’une erreur, on ne saurait nier sa persévérance. Le progrès serait ainsi une persévérante erreur.
C’est en ravivant la raison contre le rationalisme, c’est-à-dire en œuvrant à la recouvrance de la logique contre l’opinion, qu’une chance nous sera offerte de vivre notre destin non plus comme « le chien mort au fil de l’eau » dont parle Léon Bloy mais comme des hommes libres qui suscitent des formes précises dont l’ordonnance définit l’espace de la pensée,- et de cette forme supérieure de pensée qu’est la contemplation.
Il peut être difficile d’en remonter le cours, mais point impossible, en s’en tenant à l’enseignement de quelques bons maîtres (tels Joseph de Maistre, Donoso Cortès ou René Guénon) ; enseignement qui débute par l’exercice aristocratique et métaphysique de la raison et la résistance à la volonté. : « Avec le catholicisme, écrit Donoso Cortès dans une lettre au directeur de l’Heraldo, datée du 15 Avril 1852, il n’est pas de phénomène qui n’entre dans l’ordre hiérarchique des phénomènes, ni de chose. La raison cesse d’être le rationalisme, soit un fanal qui bien que n’étant pas incréé éclaire sans que personne l’ait allumé, pour être la raison, c’est-à-dire un merveilleux luminaire concentrant en lui et projetant au-dehors la lumière éclatante du dogme, pur reflet de Dieu, qui est lumière éternelle et incréée. »
C’est en ravivant la raison contre le rationalisme, c’est-à-dire en œuvrant à la recouvrance de la logique contre l’opinion, qu’une chance nous sera offerte de vivre notre destin non plus comme « le chien mort au fil de l’eau » dont parle Léon Bloy mais comme des hommes libres qui suscitent des formes précises dont l’ordonnance définit l’espace de la pensée,- et de cette forme supérieure de pensée qu’est la contemplation.
Lire aussi : L’Église ne tient sa la liberté de culte de l’État
Donoso Cortès nous donne ainsi à comprendre que ce n’est point à la politique de réformer la métaphysique (tentation prométhéenne qui n’est point dépourvue de panache mais qui méconnaît la relation d’effet et de cause, et la flèche du temps, – la conséquence ne pouvant agir sur la cause) mais à la métaphysique d’opérer à une « refondation » et, pour ainsi dire, à une justification du politique. De même qu’il n’y a pas de morale autonome, l’hétéronomie étant la condition de toute morale qui n’est pas seulement le constat d’un état de fait, il ne saurait y avoir de politique digne de ce nom qui ne soit légitimée par une exigence supérieure à la fois à celle du bien commun et à celle du « bien individuel ». Le « commun » ni l’ « individuel », ni leur compromis, ne suffisent : ce ne sont que des retraits, voire des retraites, comme on le dirait d’une armée vaincue, devant la vérité plus exigeante que ne le veulent la « nature » ou la « matière ».
LE SEUL DROIT POSSIBLE EST LE DROIT DIVIN
Ernst Jünger distingue, à juste titre, « Einzelne » et « individuum », autrement dit, l’individu en tant qu’unique et l’individu en tant qu’unité interchangeable. « Einzelne » renvoie à l’individu caractérisé, qui se différencie des autres par le faisceau de ses traditions, de ses appartenances, de ses souvenirs, de ses audaces et de sa liberté conquise, alors qu’individuum se rapporte à ce qui est équivalent, égal, dépourvu de toute réalité traditionnelle. « Einzelne » est l’Unique, mais cet unique porte en lui une multiplicité de possibles alors que l’individuum est seul mais à l’intérieur d’une multiplicité de « semblables » étrangers les uns aux autres. Le « Einzelne » appartient au règne de la forme, qui suppose une relation avec d’autres formes, alors que l’individuum appartient au règne de la matière, aussi abstrait et absent de la réalité humaine que la matière est abstraite et absente du monde. Le « Einzelne » croit à ses devoirs autant que l’individuum à des droits.
Donoso Cortès, de même , renvoie dos à dos, comme le feront après lui Jünger ou Bernanos, un libéralisme qui ne se fonderait que sur les individus déracinés, indifférenciés, égaux en droits mais rivaux en affaires, et le communisme ; l’un et l’autre lui apparaissant comme un renoncement à la souveraineté, une subjugation à cette erreur religieuse panthéiste, à cette manie de la socialisation extrême des rapports humains qui interdit tout cheminement intérieur, voire, à plus ou moins long terme, tout usage de la raison et de la parole ( il suffit hélas, pour s’en convaincre, d’écouter parler nos jeunes gens, nos journalistes, voire nos « intellectuels ») : « Pour ce qui est du parlementarisme, du libéralisme et du rationalisme, écrit Donoso Cortès, je crois du premier qu’il est la négation du gouvernement, du deuxième qu’il est la négation de la liberté, et du troisième qu’il est l’affirmation de la folie. »
Pour Donoso Cortès, non seulement la Religion n’est pas absente de la politique ou de la philosophie mais celles-ci sont toujours religieuses, l’ordre grammatical s’ordonnant à l’ordre ontologique, même et surtout lorsqu’elles s’évertuent à nier ou à défaire la Religion.
Le droit pour Donoso Cortès ne saurait être que divin. Que le droit soit divin, c’est là une idée qui semblera d’emblée révoltante au Moderne alors même qu’il consent à toutes les usurpations, à tous les bricolages juridiques, à toutes les instrumentalisations du droit sous condition qu’ils fussent « humains ». Les plus lucides ou les plus cyniques, reconnaissent dans le droit la consécration d’un rapport de force, la légitimation d’une volonté, sans voir que cette prétendue « délivrance du droit divin » n’est autre qu’une soumission religieuse à la force, une sacralisation de la volonté commune dont le propre est de tout subir et de ne pouvoir agir sur rien.
Ce qui distingue le droit divin du droit humain, n’est autre que la pérennité et l’universalité. Pour que les hommes ne soient pas livrés aux aléas de leurs goûts et de leurs dégoûts, de leurs humeurs, de leurs obsessions changeantes, il leur faut reconnaître une Loi et un Droit fondé sur la raison, et non sur le rationalisme, sur la bonté et la miséricorde et non sur les « bons sentiments ». Rien, en dernière analyse ne s’oppose véritablement au droit divin, à cette exigence qui tend vers l’universel sans pourtant jamais prétendre le détenir dans l’immanence, que le relativisme qui autorise tout et n’importe quoi.
Les hommes, avant que ne s’instaure le politiquement correct, avaient un nom pour ce relativisme, ils le nommaient barbarie. Appellation pertinente rappelant que la barbarie est bredouillement, atteinte portée au vocable et à la grammaire, déficience agressive du langage, accusation permanente, vacarme et confusion. À l’inverse, le droit divin est ce pur silence où se recueillent la Clémence et le Pardon.
Luc-Olivier d’Algange
EN KIOSQUE
Découvrez le numéro du mois - 6,90€
Soutenez l’incorrect
faites un don et défiscalisez !
En passant par notre partenaire
Credofunding, vous pouvez obtenir une
réduction d’impôts de 66% du montant de
votre don.
Retrouvez l’incorrect sur les réseaux sociaux
Les autres articles recommandés pour vous
Restez informé, inscrivez-vous à notre Newsletter