Éditorial culture de Romaric Sangars : Dernières tendances
Par
Publié le
1 septembre 2023
Partage
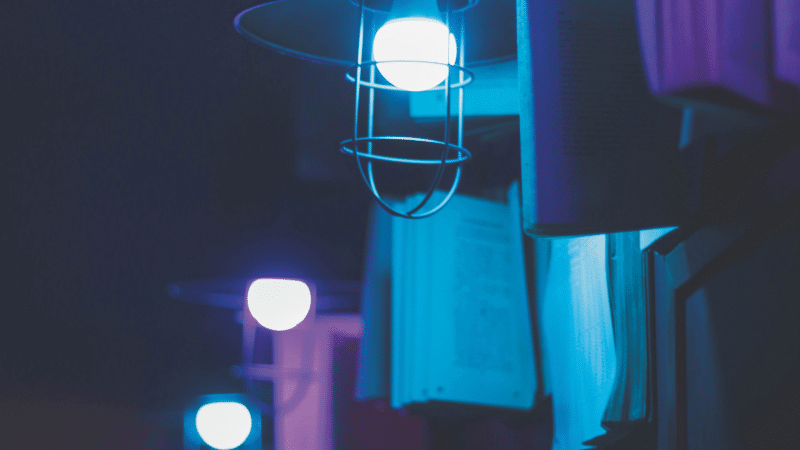
La rentrée littéraire est en pleine déflation : 466 livres, c’est le niveau de marée romanesque le plus faible depuis août 2000. Crise du papier, chute des ventes, fatigue du pilon, les raisons sont nombreuses. La masse produite n’en reste pas moins considérable et toujours une spécialité française. Le problème, en la matière, n’est pas tant la surproduction que la qualité réelle des quelques livres qui résisteront au reflux, ainsi que la variété qu’elle offre, cette marée, bien moindre, à l’analyse, que ce que de tels chiffres pourraient laisser supposer. Nous pouvons d’ailleurs résumer à quelques tendances l’essentiel de cette grosse salve d’automne : on y trouve la littérature rapport-sociologique, la littérature sœur-sorcière, la littérature dépôt-de-plainte, la littérature confession-et-résilience, la littérature identité-minoritaire, la littérature récit-de-viol, la littérature rappelle-toi-l’Occupation, la littérature enquête-historique, la littérature rééducation-masculine, la littérature « Je-est-un-autre » -en-conséquence-de-quoi-Gérard-devient-Géraldine ou bien l’inverse, la littérature femme-de-l’ombre-mise-en-lumière ou littérature de rattrapage féministe, la littérature secret-de-famille, la littérature dénonçons-le-fascisme-à-venir ou néo-néo-orwellienne, la littérature portrait-de-femme-forte ou littérature d’empouvoirement féministe, la littérature éco-anxieuse, et finalement pas trop d’autofiction (voici un genre épuisé).
L’amour ne représente pas moins pour eux cet « infini », fût-il à la portée des caniches, cet infini que Bégaudeau, au nom de ce qu’il croit être l’honneur des caniches, tente de réduire à l’état d’os à ronger
Échappant à ce panel quasi-exhaustif, François Bégaudeau, toujours en retard de trois révolutions, nous pond un petit roman naturaliste, L’Amour (il a le goût des titres professoraux et définitifs), son marxisme trouvant par là une expression idoine, c’est-à-dire aussi datée artistiquement que le matérialisme historique dont il se réclame. Faisant « l’hypothèse de l’ordinaire », projetant de relater une « expérience majoritaire de l’amour », Bégaudeau imagine une vie amoureuse où il ne se passe rien, cherchant à rendre hommage à ces prolétaires du sentiment qu’il imagine capables de partager une vie entière sans ébranlement significatif. L’écrivain, en bon communiste, a la passion du neutre, de l’égalité jusqu’au néant général, au point que même l’amour, même l’amour qui n’est que relief, doit pour lui se dissoudre dans le commun. Quel aveu. On pourrait affirmer exactement l’inverse. Que l’amour, c’est précisément ce qui arrive, l’évènement par excellence, le germe de tout drame. La Bible n’est qu’un immense épithalame affirmaient les pères de l’Église, la littérature occidentale ne raconte que l’amour exalté (et malheureux), ainsi que le montrait Denis de Rougemont, et même le premier texte européen, L’Iliade, ne relate une guerre à Troie que parce que celle-ci succède à un coup de foudre.
Évidemment, les gens du commun ont des factures à payer, ils ne tuent pas de dragons chaque matin, ou ne s’échappent pas de nuit pour se jeter au cou de l’ennemi héréditaire. L’amour ne représente pas moins pour eux cet « infini », fût-il à la portée des caniches, cet infini que Bégaudeau, au nom de ce qu’il croit être l’honneur des caniches, tente de réduire à l’état d’os à ronger. Cette « hypothèse de l’ordinaire » est une illusion marxiste. Nerval l’avait magistralement ruinée, déjà, dans ses Nuits d’octobre, exposant comment, si l’on tentait réellement de raconter littéralement ce qui se passait dans la rue, on aboutissait plutôt à une explosion baroque à la limite de la crédibilité qu’à la réalité des prétendus « réalistes ». Raconter une histoire d’amour où il ne se passe rien représente une espèce d’aporie terminale de la littérature et de l’humanité. Ne pas pouvoir imaginer que même chez des êtres a priori très humbles, très discrets, très communs, l’extraordinaire de l’amour, saveur transcendante et déchirures comprises, se produit, croire que l’amour se réduirait pour eux à une espèce d’acclimatation réciproque prolongée, sans plus, en dit long sur le surplomb sinistre avec lequel les idéologues envisagent les gens, ces gens « moyens » qui ne sont pour eux que la raclure des masses.
Lire aussi : Éditorial d’Arthur de Watrigant : Rentrée et gueule de bois
Il est significatif qu’à revers de François Bégaudeau, Éric Reinhardt nous offre Sarah, Suzanne et l’écrivain, roman par lequel l’écrivain parvient à relégitimer la fiction par l’entremise du récit d’une lectrice, Sarah, transposée dans son livre en Suzanne. C’est par les rouages de l’amour défaillant à même d’ébranler les existences les mieux construites que Reinhardt relance la machine narrative. Son geste est à l’opposé de celui de Bégaudeau. Le romancier ne part pas d’une hypothèse moyenne mais d’un témoignage réel. Il ne tente pas de légitimer l’amour après en avoir aboli abstraitement la dimension narrative, mais de relégitimer la fiction à partir de sa source concrète : un amour-moteur, a priori ordinaire, mais apte à entraîner toutes les métamorphoses, toutes les épreuves, toutes les résurrections. Et voilà qui reste tout de même la tendance la plus prometteuse.
Cliquez ici pour vous procurer le numéro 67 ou vous abonner à L’Incorrect.
EN KIOSQUE
Découvrez le numéro du mois - 6,90€
Soutenez l’incorrect
faites un don et défiscalisez !
En passant par notre partenaire
Credofunding, vous pouvez obtenir une
réduction d’impôts de 66% du montant de
votre don.
Retrouvez l’incorrect sur les réseaux sociaux
Les autres articles recommandés pour vous
Restez informé, inscrivez-vous à notre Newsletter










