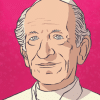Éditorial culture #38 : L’apocalypse est décevante
Par
Publié le
5 janvier 2021
Partage

En 2000, il n’y eut pas de « big bug » qui eût fait dérailler la machine au vertige d’un triple zéro. En 2001, nulle odyssée de l’espace, d’autant que la guerre des étoiles, ce transfert sublimé de la Guerre froide, s’était malheureusement attiédie depuis longtemps et que l’homme était revenu se cogner aux limites de son berceau. Il ferait bientôt de cette limite une obsession. En décembre 2012, on nous avait parlé d’apocalypse telle que prédite par les Mayas, comme si des gens qui n’avaient pas vu venir la destruction de leur monde auraient été en mesure de prophétiser celle de la planète entière. Cet a priori bienveillant sur les calendriers des primitifs est l’une des curiosités de cette époque, et qui produit d’ailleurs toujours les mêmes écueils, mais on continue de s’extasier par principe devant le premier égorgeur exotique, sans doute parce que nous sommes fatigués d’une civilisation qui a perdu son cœur et s’est vrillé les nerfs.
L’apocalypse est décevante, je ne la porte plus à la boutonnière depuis cinq ou six ans au moins, ses couleurs sont fades, son goût démodé.
Blade Runner déployait sa dystopie en 2019, pourtant aucun répliquant authentique, à cette date, n’était dissimulé dans la foule, même si la robotisation des êtres progresse, quoique d’une manière infiniment plus ambiguë. La perspective anthropophage de Soleil Vert, dans un monde ayant totalement sacrifié son habitat naturel et qui en est réduit à recycler les cadavres pour nourrir sa population, n’a pas encore à nous inquiéter pour 2022, même si l’angoisse écologique est en effet devenue centrale.
On ne peut pas dire qu’il ne se soit pour autant rien passé de catastrophique, ces cinq dernières années, entre la guerre civile mondiale de basse intensité qui a trouvé en France un pôle privilégié, Notre-Dame en feu comme un terrible intersigne et cette pandémie mondiale qui ne cesse de se répandre et de revenir, tous les fléaux semblent se succéder pour nous préparer au grand final. Mais pour moi qui fus un adolescent romantique, « Je suis né romantique et j’eusse été fatal », chantait Verlaine, « En un frac très étroit aux boutons de métal », voilà, c’était tout à fait moi, « L’œil idoine à l’œillade et chargé de défis », bref, j’étais un partisan de l’apocalypse, à laquelle j’attachais une aura wagnérienne, spectaculaire et grandiose. Un formidable et définitif assaut nous vengerait de la médiocrité de l’époque, voilà quel était mon fantasme morbide, « Et puis j’eusse été si féroce et si loyal ! »
Lire aussi : Éditorial culture #37 : Un édito positif
Désormais que la première connasse de première L est convaincue que la fin est proche, j’avoue que mon goût décadent s’est terni. Et puis l’apocalypse est décevante. Elle est insidieuse, terne, passive, peu romanesque. Ce n’est pas un front glorieux, mais se faire, au hasard, exécuter en terrasse. Ce n’est pas des cubes de béton qui s’effondrent dans la beauté du feu, mais le mystère sublime des cathédrales menacé par un accident domestique. Ce n’est pas la peste qui défigure les êtres, vide les villes en quelques mois et suscite des processions désespérées, mais les terrasses interdites en raison d’un virus qui tue suffisamment pour nous empêcher de vivre et insuffisamment pour qu’on comprenne pourquoi. Le pire, c’est qu’au lieu de vouloir se transcender à l’occasion d’un éclatant chaos, les gens souhaitent juste banalement survivre, et survivre suffisamment longtemps pour expérimenter un changement de sexe, achever le visionnage d’une série ou toucher leurs retraites.
L’apocalypse est décevante, je ne la porte plus à la boutonnière depuis cinq ou six ans au moins, ses couleurs sont fades, son goût démodé. Aucun de nos écrivains ou cinéastes de la fin du XXe siècle, qui l’avaient pourtant annoncée pour aujourd’hui, n’avait prévu qu’elle pût se montrer aussi lente et dépourvue d’éclat. Cette apocalypse est bas-de-gamme. Elle est indigne de nous, chères lectrices. Nous refuserons, chers lecteurs, d’y coopérer dans ces conditions. Survivons donc, ne serait-ce que pour la gâcher.
EN KIOSQUE
Découvrez le numéro du mois - 6,90€
Soutenez l’incorrect
faites un don et défiscalisez !
En passant par notre partenaire
Credofunding, vous pouvez obtenir une
réduction d’impôts de 66% du montant de
votre don.
Retrouvez l’incorrect sur les réseaux sociaux
Les autres articles recommandés pour vous
Restez informé, inscrivez-vous à notre Newsletter