Éditorial culture de juin : Vivre et mourir en terrasse
Par
Publié le
5 juin 2021
Partage
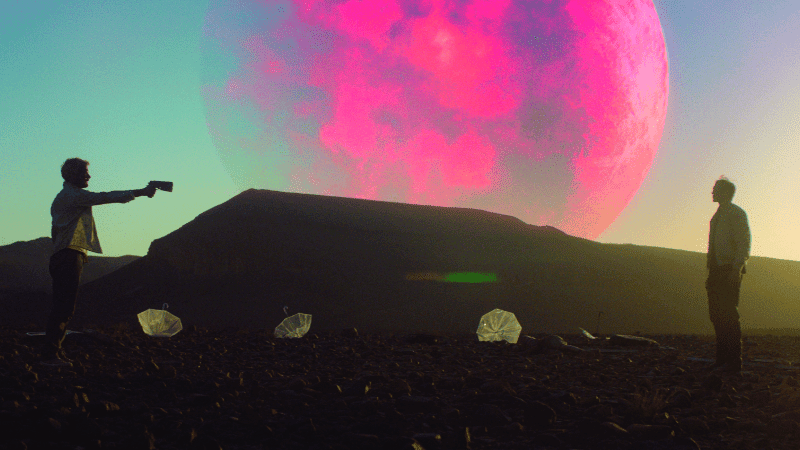
Plus de six mois sans pouvoir s’installer à une table de café en terrasse, au cours d’une flânerie ou par habitude, s’asseoir sur une chaise calée sur le bitume, poser son sac, en sortir un livre, un carnet, un paquet de cigarettes, bien sûr, si l’on s’adonne au beau vice du tabac, demander un café, un demi, un double whisky sec, et se retrouver dans cette position sublime, parmi le flux permanent des affairés, que de contempler un peu ce qu’est la vie, comment sont les êtres, vers quoi le monde penche, à cette extrémité de la civilisation qui, par la contemplation, rejoint les éclairs des premiers ascètes. Cela aussi relève de la culture, une certaine manière d’habiter le monde et de prendre du recul sur l’inertie qui pousse le troupeau à l’abîme (nous pouvons tous être entraînés ou arrachés au troupeau, à chaque instant, sur ce plan la terrasse représente un frein). Dans ces pages, je reportais il y a deux ans cette belle citation de l’Américaine Shirley Goldfarb : « Je me suis offert une bourse à vie pour étudier aux terrasses des cafés… » disait-elle, en faisant référence à Paris, où elle avait choisi de vivre et mourir, bien sûr, puisqu’on ne trouve guère de terrasses de café crédibles dans son pays d’origine.
La France donc, transforme tout en salon, même la rue, si bien que le passant devient un étrange invité
Chesterton a expliqué comment le « backyard » était anglais, soit le goût pour le revers de la maison, alors que la maison française était ouverte sur la rue comme sur un théâtre. Le pub est finalement une arrière-cour commune, tandis que les Allemands ont des Biergarten, des jardins à bière, où ces amoureux de la nature (nature qu’ils n’ont jamais vraiment quittée, pour le meilleur et pour le pire) trinquent en pleine nostalgie d’Éden. La France, qui est elle configurée au symbole de l’espace parfait, espace qui devient un salon, évidemment, ce qu’expliquait un célèbre linguiste étranger dont je ne chercherais pas le nom parce que je ne suis pas allemand et que je n’ai pas que ça à foutre, la France donc, transforme tout en salon, même la rue, si bien que le passant devient un étrange invité, la rue une salle de bal, la terrasse un balcon, le monde une soirée sans videur.
Comme il est bon de retrouver cette perspective, cette disponibilité au bel éparpillement des rues, la multiplication des visages, le gazouillis des conversations, d’entendre comment se trament toujours séductions et complots, révolutions esthétiques, considérations sur les mœurs, ardentes controverses, comment les êtres se confessent les uns aux autres ou échouent à se comprendre un verre de Spritz à la main et recommandent la même chose convaincus de l’effet fluidifiant de l’alcool.
Lire aussi : Éditorial culture de mai : Goebbels moins le grandiose
Durant deux saisons pleines, notre rapport au monde se réduisit aux soirées clandestines et aux médias officiels, à la connivence ou au matraquage, et nous avons manqué d’imprévu, de frivolité, de dérives. Nous étions livrés aux médecins des corps et aux médecins des âmes, les seconds acharnés à nous vacciner contre toute forme d’esprit critique sur le processus d’indifférenciation généralisée où les nouveaux fanatiques voudraient nous entraîner. En terrasse, nous pouvons à nouveau débattre avec des familiers ou des inconnus, la parole n’est plus monopolisée par les agents du néo-progressisme comme au sein de ces médias publics qui se trouvent depuis si longtemps privatisés par les idéologues d’un Parti Unique.
Certes, depuis 2015, nous savons qu’un mahométan hystérique peut toujours surgir pour abréger nos conversations, et si nous regrettons la pauvreté d’une telle répartie, nous savons aussi quelle envie dévorante la suscite, que le type de civilité que nous avons élaboré à ce bout de l’Europe depuis mille ans, depuis les cours d’Aquitaine et de Champagne jusqu’à ces cafés en bord de Seine, a quelque chose de révoltant pour les ennuyés du désert vu que notre vrai quotidien est plus excitant que leur faux paradis.
Alors je le répète : c’est un puissant plaisir de retrouver les terrasses, les digressions, les anecdotes, les heurts des verres, les présents du hasard, comme la grâce qu’on peut trouver aux jupes des femmes cis en euphorie de genre.
EN KIOSQUE
Découvrez le numéro du mois - 6,90€
Soutenez l’incorrect
faites un don et défiscalisez !
En passant par notre partenaire
Credofunding, vous pouvez obtenir une
réduction d’impôts de 66% du montant de
votre don.
Retrouvez l’incorrect sur les réseaux sociaux
Les autres articles recommandés pour vous
Restez informé, inscrivez-vous à notre Newsletter









