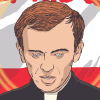Antoine Raimbault : filmer la justice française
Par
Publié le
5 février 2019
Partage

Pour son premier long-métrage, Antoine Raimbault nous replonge dans l’affaire Viguier, un professeur accusé du meurtre de sa femme – femme dont le corps n’a jamais été retrouvé. Dans ce thriller conduit à l’anglo-saxonne, le jeune réalisateur français offre une immersion fascinante au cœur d’un système judiciaire français mal connu. Nous l’avons appelé à la barre.
Pourquoi vous être intéressé à cette affaire-ci ?
C’est un peu par hasard. En 2009, un ami cinéaste, Karim Dridi, me parle de Jacques Viguier, un homme très cinéphile qu’il avait croisé dans des festivals et qui était sur le point de comparaître devant la cour d’assises pour le meurtre de sa femme, disparue neuf ans plus tôt. Je lui ai d’abord répondu que les affaires judiciaires n’avaient pas la cote dans le cinéma français, mais j’ai pourtant commencé à lire tout ce que je trouvais sur l’affaire parce que ce « crime parfait » – sans preuve – m’interpellait.
Un procès sans cadavre, c’est impossible dans le droit anglo-saxon. Lorsque je débarque à la cour d’assises en avril 2009 pour le premier procès Viguier, je tombe du banc. Je découvre en effet la justice de mon pays et trouve qu’elle marche un peu sur la tête (les deux verdicts successifs l’ont prouvé).
Je rencontre aussi cette famille en sursis. Sans doute parce que je ne suis pas journaliste, un rapport de confiance va se construire avec elle, et je suis marqué par l’indignation de quelqu’un de très important dans cette histoire qui n’apparaît pas dans le film et s’appelle Émilie : la maîtresse de Jacques Viguier au moment de la disparition de sa femme. Elle était alors étudiante en droit, voulait devenir juge d’instruction, et a découvert la justice à travers son histoire d’amour avec cet homme. Pendant neuf ans, elle a fait de cette quête de la vérité son sacerdoce.
C’est elle qui vous a inspiré le personnage de Nora ?
C’est en tout cas par cette rencontre que je commence à écrire une histoire. Ma volonté première est de représenter la justice de notre pays et je m’aperçois que je connais bien mieux le code de procédure anglo-saxon – comme sa fameuse formule : « Objection, votre Honneur! » – parce que mon imaginaire sur le thème est nourri de cinéma anglo-saxon, alors que le cinéma français a déserté les cours d’assises. En France, on dit « Monsieur le Président », pas « Votre Honneur ».
Dans la procédure anglo-saxonne, c’est au cours du procès que la vérité émerge, par l’affrontement entre la vérité de l’accusation et celle de la défense. En France, la vérité est à la charge de l’instruction, elle précède donc le procès, et l’oralité des débats est seulement là pour mettre en scène cette vérité judiciaire contenue dans le dossier, et qui se trouve verrouillée par l’instruction et par la police.
Un système plus libéral chez les Anglo-saxons, plus autoritaire chez nous ?
La procédure anglo-saxonne procède en effet d’une vision plus démocratique alors qu’en France la justice vient d’en haut, des « sachants » qui guident l’instruction. Ils ont à charge et à décharge de trier le bon grain de l’ivraie, le résultat étant remis en grande partie entre les mains d’un président, tout à la fois juge et arbitre. Dans la procédure anglo-saxonne, il y a le fameux « hear say » : on peut faire valoir qu’il ne s’agit que de rumeurs et que ça n’a pas lieu d’être dans l’enceinte du tribunal.
En France, l’accusation fait son beurre de la rumeur, ce que montre l’affaire Viguier. La justice française adore les accusateurs. On attend de la justice des preuves, qu’elle fabrique de la vérité, et bien souvent, elle ne fabrique que du doute et on sort frustré de la cour d’assises. (…)
À découvrir dans le dernier numéro de L’Incorrect et en ligne pour les abonnés.
Vous souhaitez lire la suite ?
Débloquez tous les articles de l’Incorrect immédiatement !
EN KIOSQUE
Découvrez le numéro du mois - 6,90€
Soutenez l’incorrect
faites un don et défiscalisez !
En passant par notre partenaire
Credofunding, vous pouvez obtenir une
réduction d’impôts de 66% du montant de
votre don.
Retrouvez l’incorrect sur les réseaux sociaux
Les autres articles recommandés pour vous
Restez informé, inscrivez-vous à notre Newsletter