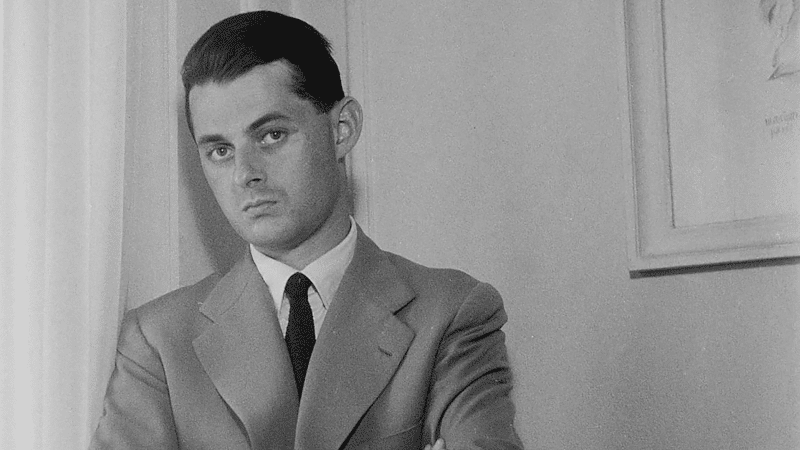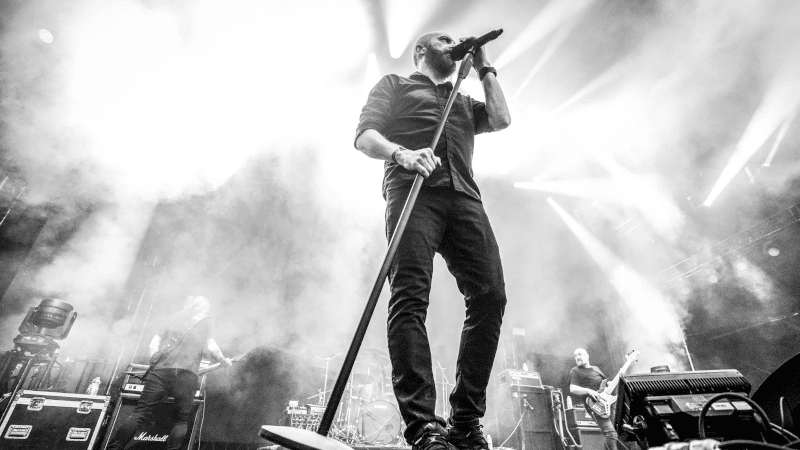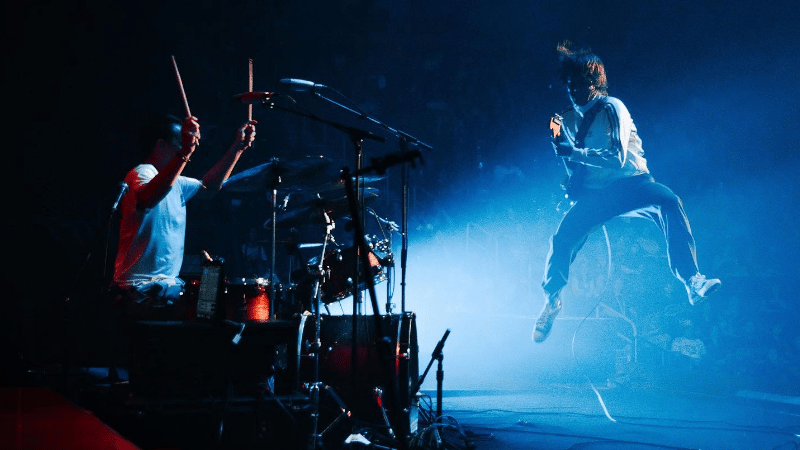Dixième anniversaire aidant, le service public se devait de traiter frontalement les attentats du 13 novembre, et France télévision y consacre enfin une série-évènement, comme on dit dans les échoppes subventionnées, ainsi qu’un documentaire pas tout à fait de création. Les deux sont problématiques pour user de litote, mais qu’attendre aussi de la télé que Serge Daney compara un jour à un gros téléphone d’hôpital ? Pas grand chose. Commençons par le pire : Des Vivants. Jean-Xavier de Lestrade – dont le passionnant Soupçons remonte à plus de 20 ans – suit sur 8 épisodes, 7 des 11 otages du Bataclan, qui semblent lui avoir donné un accès illimité à leur vie post-13 Novembre. L’axe choisi peut se résumer en une formule qui a valu une célébrité éphémère à son auteur, Antoine Leiris : « Vous n’aurez pas ma haine ! », auquel Lestrade ajoute sa touche personnelle, Vous aurez ma résilience. Impossible ou pas, celle-ci est figurée dans des scènes qu’on semble avoir déjà vues cent fois, notamment dans les fictions récentes abordant obliquement le 13 Novembre avec attentats imaginaires recréés dans un parc – Amanda (Mikhaël Hers, 2018) – ou dans une brasserie – Revoir Paris (Alice Winocour, 2022).…