Les critiques littéraires d’avril
Par
Publié le
22 avril 2022
Partage
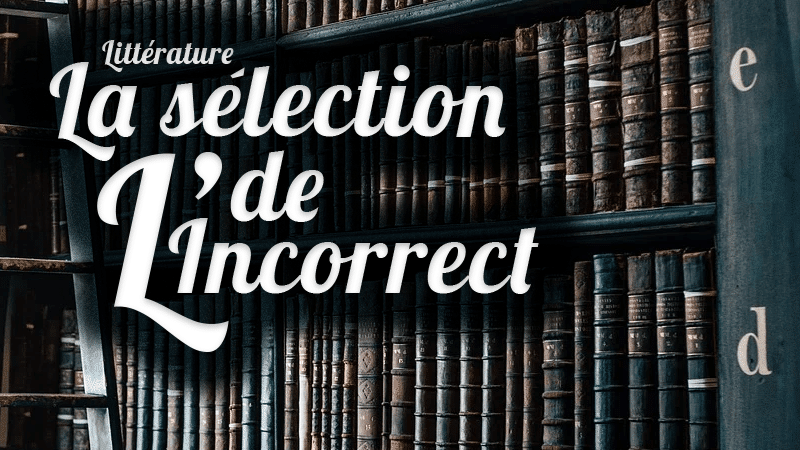
La bombe du printemps
Le parti d’Edgar Winger, Patrice Jean, Gallimard, 246 p., 20€
Le nouveau roman de Patrice Jean commence par une fable naïve de deux pages, « Poupinet », d’une platitude exaspérante. On est ensuite plongé dans le journal de Romain, militant du PR, le Parti Révolutionnaire, qui l’a envoyé à Nice pour retrouver Edgar Winger, un théoricien d’extrême gauche dont le parti réclame le retour pour pouvoir à nouveau affirmer une direction idéologique progressiste conséquente face aux nouveaux enjeux. Romain prend dans un bar son poste de surveillance, entre en relation avec un voisin réac dont il baiserait bien la fille, sympathise avec des militants locaux avant de se faire soudain virer du parti. Jusque là, le ton et les obsessions du personnage déroutent le lecteur de Patrice Jean qui, ne rejoignant pas la satire, nous agace presque, à force, de nous faire côtoyer avec réalisme la pensée obtuse d’un militant progressiste satisfait. Mais Romain finit par retrouver la trace de Winger, qui n’est plus le doctrinaire qu’il fut et, ayant constaté la déception de son visiteur écrit à celui-ci une lettre qui fait entrer le roman dans un nouveau registre.
C’est là que le dispositif s’éclaire. « Poupinet », c’était finalement l’objectif candide et médiocre que visent les utopistes en termes d’existence. Une certaine modalité de discours, pas si éloignée de celle, binaire et étanche, qui caractérise les confessions de Romain. Et la lettre de Winger, comme l’autre témoignage qui lui succédera, vont saboter de l’intérieur les illusions progressistes tout en redéployant le langage, la pensée et la sensibilité par des charges admirables qui résonnent comme une formidable réplique de la littérature contre l’idéologie. D’une audace remarquable dans la construction, d’une puissance implacable dans le propos, ce petit livre à la recette explosive fait de l’un de nos grands écrivains vivants, également un grand moraliste. Romaric Sangars

Snob et vide
Braves d’après, Anton Beraber, Gallimard, 124 p., 14,50€
Beraber fait des phrases; des exercices de style. Il joue, c’est hasardeux, nous prend pour des gogos. Construire une histoire ? Pensez-vous, c’est bon pour la littérature populaire, Anton Beraber est au-dessus de ça. Écrire des phrases grammaticalement correctes avec sujet, verbe, compléments, des phrases signifiantes? Respecter la ponctuation? Il le laisse aux autres. Ceux qui écrivent des histoires, peut-être, et des livres qu’on a envie de lire. Beraber plane, très loin au-dessus de nous; il n’est pas loin de s’écraser. Il y avait quelque chose, dans son premier roman; quelque chose d’étonnant qui donnait à espérer qu’il fût capable de grands livres. On était sur la crête, il pouvait verser d’un côté ou de l’autre, il a visiblement choisi l’ubac, nous offrant un livre obscur, un style prétentieux, faussement avant-gardiste, plein de mots snobs, qui nous ennuie. Que voulez-vous Monsieur Beraber, nous avons gardé de nos lectures d’enfant (Homère, Chrétien de Troyes, Cervantès) le goût des récits, pas celui des mots qui se regardent. Nous avons aussi des dictionnaires à portée de main pour piocher des mots rares, mais surtout des grammaires qui nous empêchent d’écrire : « Il eut mal d’avance aux organes qui devaient le faire mourir et sans doute à la poussière qu’il retrouva deux jours durant dans son mouchoir il mourut, symboliquement. » Il y aura sans doute les partisans d’Anton Beraber comme il y a ceux de Marien Defalvard. C’est surprenant. Comme d’écrire quand on n’a rien à dire. Matthieu Falcone
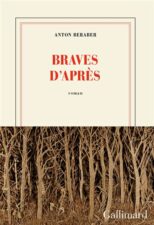
Plein de saveur et de pluie
Harcelé, Pierre Filoche, Serge Safran, 190 p., 17,90€
Cet excellent roman noir commence dans un hôpital psychiatrique. Le héros, Vincent Martin, s’est enfui d’une clinique où il était interné pour six mois. La justice le fait expertiser par des toubibs. Il leur raconte sa fugue, son voyage en train jusque dans le Nord, sa rencontre inopinée avec une femme qui s’avère être son avocate. Elle lui apprend qu’il a tenté d’étrangler un collègue. Lui ne se souvient de rien… Il y a des romans comme celui-ci dans l’atmosphère grise desquels on tombe instantanément, happé par le décor (le littoral, les baraques à frite, une maison de maître) et les personnages – un gros bras obtus, une avocate pleine d’audace, un fils de famille fantaisiste, féru d’histoire et décliniste. En arrière-plan, Pierre Filoche aborde quelques sujets graves comme le harcèlement au travail, la cruauté des petits caporaux dans les entreprises bureaucratisées, les arrangements avec la loi. On se laisse porter, sans sauter une ligne, et on se retrouve au bout de deux heures et 200 pages, tout étonné d’être déjà au bout, avec l’impression d’avoir vécu une grande aventure, dénoué une énigme, et s’être fait des amis. La chute, sanglante, donne une touche de dureté à ce roman plein de saveur et de pluie, pour rappeler qu’on est bien dans un polar. Bernard Quiriny

Prometteur
Les confins, Eliott de Gasines, Flammarion, 278 p., 19€
Années 1960, un projet de station de ski naît dans le village en altitude des Confins; il capote au bout de quelques saisons, ruinant l’architecte à l’origine de l’affaire. Années 1980, un écrivain débarque aux Confins, redevenu l’hiver un hameau perdu que ne dessert aucune route. Là, dans le huis-clos blanc, tout part en vrille… Comme parfois dans les premiers romans, Les Confins condense plusieurs livres: une épopée industrielle contrariée, un récit de vengeance filiale, et un polar alpestre à mystère criminel annoncé dans les premières lignes. Chaque facette a son style, son rythme, qui alternent du fait de la construction sur deux temps (1964/1984, chaque époque avec ses signes, surtout les 60’s, avec la mythologie bourgeoise des vacances à la montagne, dans l’euphorie des Trente Glorieuses). Ce côté brinquebalant est une faiblesse et une force : il empêche les ambiances de s’installer vraiment, mais il relance sans cesse le lecteur sur de nouvelles pistes (si l’on ose dire). Coup d’essai plein de promesses de cet ancien lauréat du Prix du jeune écrivain, aujourd’hui pubard et réalisateur, qui confesse s’être inspiré d’un souvenir familial: son grand-père fut, à l’époque, le premier exploitant de la Clusaz. Bernard Quiriny
[…]
Vous souhaitez lire la suite ?
Débloquez tous les articles de l’Incorrect immédiatement !
EN KIOSQUE
Découvrez le numéro du mois - 6,90€
Soutenez l’incorrect
faites un don et défiscalisez !
En passant par notre partenaire
Credofunding, vous pouvez obtenir une
réduction d’impôts de 66% du montant de
votre don.
Retrouvez l’incorrect sur les réseaux sociaux
Les autres articles recommandés pour vous
Restez informé, inscrivez-vous à notre Newsletter









