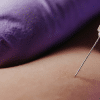« Le Dernier Tango à Paris » : le scandale de trop
Par
Publié le
16 décembre 2024
Partage

On voudrait, comme partout, faire d’un tournage un lieu à risque zéro. Un tournage, c’est pourtant un lieu de travail comme un autre, qui comporte des risques nombreux et variés : des abus de pouvoir, des accidents, des conflits internes, des malveillances diverses. A une époque, on célébrait d’ailleurs les cinéastes qui s’alimentaient de l’urgence ou du chaos d’un tournage : William Friedkin sur le tournage épique et désastreux de Sorcerer, Elen Klimov qui va jusqu’à engager un psychologue pour encadrer le jeune héros traumatisé de Requiem pour un Massacre, Coppola qui aurait planqué des vrais cadavres dans les faux charniers d’Apocalypse Now, Jack Nicholson qui s’amuse, hors caméra, à terrifier Shelley Duval pour donner du crédit à son personnage, sans oublier les innombrables tentatives de séduction de réalisateurs ou d’acteurs plus ou moins balourdes, plus ou moins « toxiques », comme on dit aujourd’hui.
Lire aussi : Stéphanie & Sylvain Tesson : Au nom du père, de l’art et de Notre-Dame
La femme, c’est une des nombreuses matières premières du cinéma, de cet art de l’enregistrement qui vampirise tout, alors les actrices sont évidemment en première ligne : abusées, trompées, humiliées – le point de non-retour étant certainement le sort de Linda Lovelace, actrice du tristement célèbre Deep Throat, un des premier films X de l’histoire où elle fut littéralement obligée de tourner avec un flingue sur la tempe. Que doit-on faire de tout ça ? Doit-on continuer à regarder certaines œuvres-limite pour continuer à aiguiser notre regard critique, notre empathie, ou au contraire les invisibiliser ? Un effacement d’autant plus dérisoire que pendant ce temps, la pornographie, l’actuelle, toujours plus barbare, s’écoule en continu des robinets numériques, abîmant les regards et les âmes ? Voilà donc que la Cinémathèque Français a cédé à la pression des néo-fems en supprimant de sa rétrospective Marlon Brando le film « sulfureux » de Bernardo Bertolucci, déjà condamné en son temps par le Vatican. Pourtant, loin de l’hagiographie crétine que lui consacre le biografilm Maria, le destin de Maria Schneider et son implication dans le film de Bertolucci sont définitivement à interroger, et constituent même un cas d’école de ce que peut – ne pas faire – le cinéma. Pourquoi donc refuser de regarder en face les œuvres qui interrogent, fusse dans la douleur, les rapports complexes du réel et de la fiction, d’une actrice avec son corps, d’un réalisateur avec son actrice ? Va-t-on demain canceller tous les Hitchcock parce que ce dernier était vraisemblablement un salopard patenté avec ses actrices, ou L’Histoire d’Adèle H. parce que François Truffaut tambourinait toutes les nuits à la porte d’Isabelle Adjani ? Va-ton refuser de voir E.T parce que Spielberg a fait pleurer la petite Drew Barrymore sur le tournage – étant probablement responsable, n’est-ce-pas, de sa longue toxicomanie ?
Il faut accepter le fait qu’une œuvre d’art, quelles que soient les conditions de sa production, n’appartient ni à ses auteurs, ni à ses participants, mais bien au monde entier, au peuple qui seul doit décider de son avenir, en la célébrant ou en l’ignorant. Ce ne sont pas des commissions des censure ou à des communautés quelconques de décider si elles sont permises ou non. A ce titre il est regrettable que Jean-François Rauger, directeur de la programmation à la Cinémathèque, ait fini par céder devant ce néo-puritanisme qui ne dit pas son nom, sous l’impulsion qui plus est d’une journaliste, Chloé Thibaud, qui en profite au passage pour faire la promotion de son dernier livre, Désirer la Violence. Aujourd’hui, la presse ne se prive pas d’évoquer un « tollé », alors qu’il s’agit en fait d’une cinquantaine de néo-fems planquées derrière leur compte Instagram. Drôle de tribunal populaire.
EN KIOSQUE
Découvrez le numéro du mois - 6,90€
Soutenez l’incorrect
faites un don et défiscalisez !
En passant par notre partenaire
Credofunding, vous pouvez obtenir une
réduction d’impôts de 66% du montant de
votre don.
Retrouvez l’incorrect sur les réseaux sociaux
Les autres articles recommandés pour vous
Restez informé, inscrivez-vous à notre Newsletter