
Culture


Vous souhaitez lire la suite ?
Débloquez tous les articles de l’Incorrect immédiatement !

Je ne connaissais pas Laélia Véron et à vrai dire, elle ne manquait pas à mon existence, mais la perversité des algorithmes m’a mené à découvrir l’une de ses interventions, sur France Inter, où, dans une émission de Charline Vanhoenecker (cette femme à elle seule justifierait la vitrification de la Belgique – Bernard Quiriny fait contre-poids), cette socio-linguiste justifiait l’usage de « du coup », enfin plutôt l’abus de cette locution, avec des arguments de statisticienne athée. C’est fou ce que ces gens qui apprennent à compter à trente ans en tirent une confiance étonnante en leur intelligence.
La jeune femme moquait Le Figaro et l’Académie (quelle rebelle – depuis la radio d’État en plus !) insinuant que ceux qui déplorent la diffusion de ce tic verbal seraient de vieux frileux grincheux paranoïaques, et un peu ignorants aussi, parce qu’elle et ses potes, qui font des enquêtes sérieuses, ont pu remarquer que, dans la pratique : les tics fluctuent.…
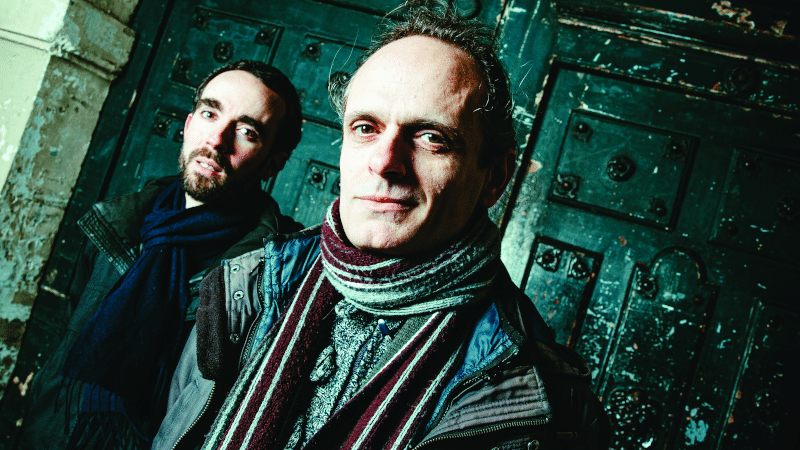
Vous souhaitez lire la suite ?
Débloquez tous les articles de l’Incorrect immédiatement !

Vous souhaitez lire la suite ?
Débloquez tous les articles de l’Incorrect immédiatement !

Vous souhaitez lire la suite ?
Débloquez tous les articles de l’Incorrect immédiatement !

Vous souhaitez lire la suite ?
Débloquez tous les articles de l’Incorrect immédiatement !

Vous souhaitez lire la suite ?
Débloquez tous les articles de l’Incorrect immédiatement !
L’Incorrect
Retrouvez le magazine de ce mois ci en format
numérique ou papier selon votre préférence.













