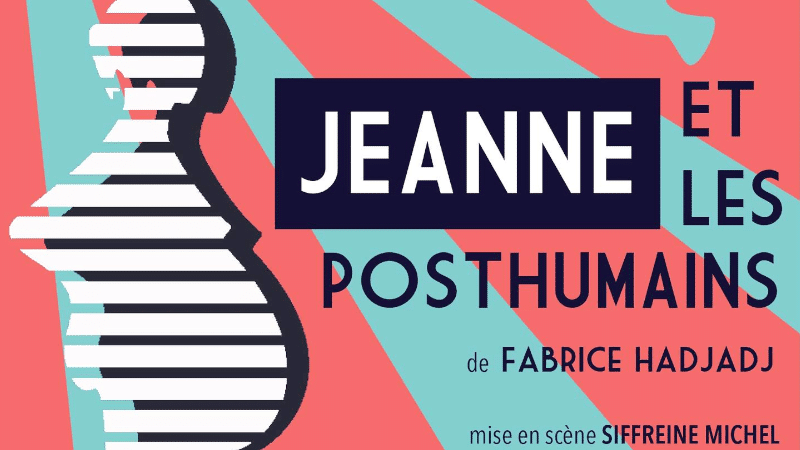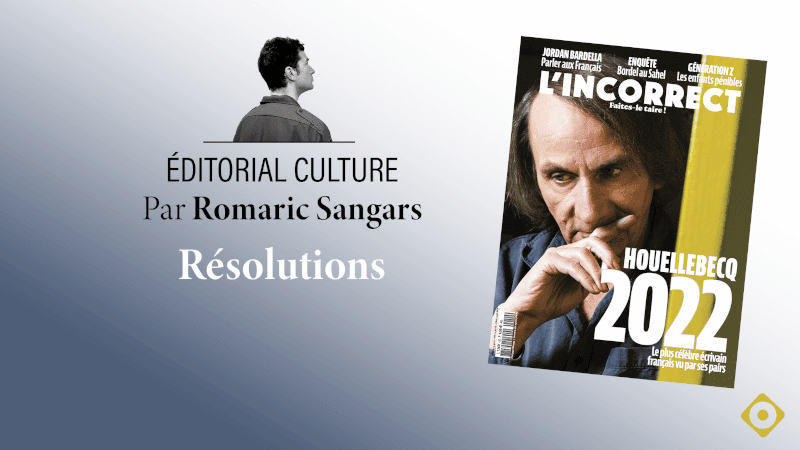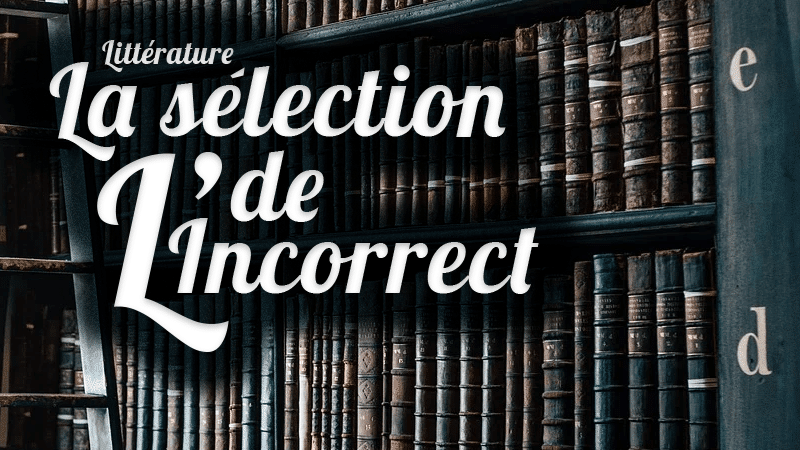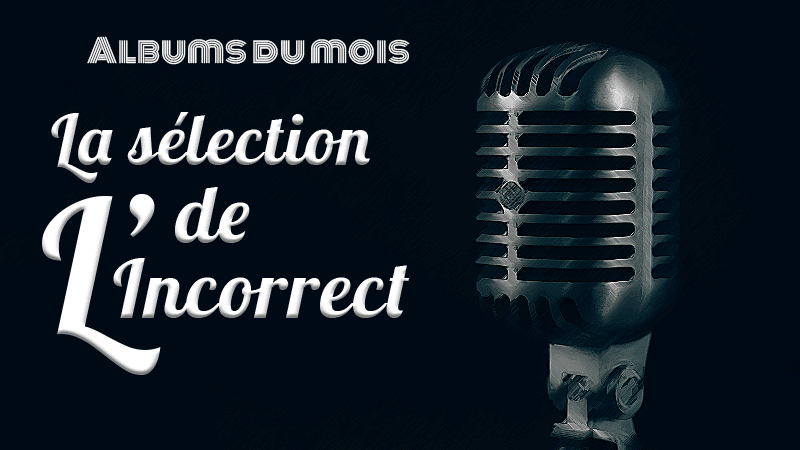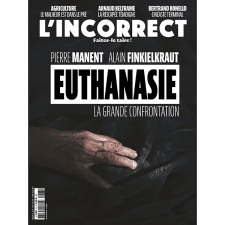Votre film insiste beaucoup sur la manière dont la politique de l’Union européenne sape les traditions.
J’ai commencé mes recherches des années avant le tournage, en discutant avec les pêcheurs et en leur demandant ce qu’ils avaient en tête. Et il n’a pas fallu longtemps pour que je me rende compte à quel point les normes européennes avaient bouleversé leurs vies. Il faut savoir que beaucoup d’entre eux ont pratiqué ce métier toute leur vie, dans leur famille et ce depuis des générations. Et lorsque Malte a rejoint l’UE, les pêcheurs ont soudainement dû passer du monde de la mer à un monde de papier, à un monde de bureaucratie sans fin. Ç’a été une rupture radicale qui a donné lieu à de nombreux drames familiaux. Les pêcheurs doivent désormais documenter chaque poisson qu’ils attrapent, rejeter les poissons non conformes, même s’ils sont morts, et tout relater dans des journaux de bords extrêmement précis. Les lois sont parfois ubuesques. J’avais une vision innocente de la pêche avant de me lancer dans mes recherches, jusqu’à ce que je réalise que les réglementations, le changement climatique, le gouvernement, les autorités locales, mais aussi les forces du marché conspiraient ensemble pour changer la vie des pêcheurs. Et cela s’est produit en l’espace d’une demi-génération.
Quel est votre rapport à la culture maltaise ?
Mes parents ont émigré de Malte peu avant ma naissance aux États-Unis, mais nous avons gardé des liens étroits avec l’île, et nous y retournions souvent. Alors que je grandissais entre deux mondes, mon cœur et mon imagination revenaient toujours à Malte. J’ai toujours voulu raconter des histoires sur l’île, notamment parce qu’il n’y avait pas vraiment d’autres films maltais. Avec Luzzu j’ai simplement essayé de faire le genre de film que je voulais voir, une représentation cinématographique de Malte, en évitant les clichés touristiques et en restant au niveau de la rue, comme si vous étiez un citoyen vivant sur l’île. Je n’avais aucun lien avec la pêche, et d’ailleurs j’ai toujours été enclin au mal de mer, mais j’étais fasciné par le monde de la pêche traditionnelle, simplement à cause de ces magnifiques bateaux et de ces hommes qui ont une sorte de force surhumaine, presque mythologique. En tant que spectateur, cela me semblait riche visuellement et culturellement. Et puis, j’ai pu faire le lien avec mes parents, qui eux aussi en tant qu’immigrés ont dû choisir quelles parties de leur héritage ils devaient garder ou pas, or c’est exactement ce qui se passait avec cette génération de pêcheurs. [...]