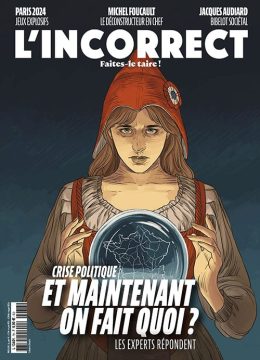Annie Ernaux ou l’apothéose de la prof de Lettres
Par
Publié le
10 octobre 2022
Partage

Les profs de Lettres, les femmes du moins, vont pouvoir recommencer à rêver. Plus d’une, en 2017, s’était mise à regarder son meilleur élève de Première d’un autre œil, imaginant qu’elle pourrait l’épouser un jour et devenir première dame de France quelques années plus tard.
En décernant leur prix à Annie Ernaux, les jurys du Nobel ont-ils voulu donner un peu d’espoir à toutes celles qui, comme la narratrice des Années ne donnent plus que « de vagues cours à des classes énervées » ? Le message serait simple : écrivez, vous pourrez arrêter d’enseigner et vous consacrer entièrement aux Lettres. Pourtant, sans s’en rendre compte, Annie Ernaux a fait l’inverse : depuis qu’elle a cessé d’enseigner pour écrire, elle a renoncé à la littérature, tout en devenant plus prof que jamais. Prof, elle est et elle reste, ce qui ne serait pas honteux si cela ne nuisait pas tant à ses textes. Dans son premier récit, Les Armoires vides, outre son avortement dont elle a fait depuis un argument éditorial permanent, Ernaux rapportait les mots de la fierté de sa mère : « Un futur professeur m’a dit sa maîtresse ». Plus que tout autre, ce mot résume la suite. Même quand Ernaux est sur le point de réussir une œuvre, elle la tue en y ajoutant son explication de texte.
Passons sur son refus du style et du genre romanesque, congédiés comme des formes de complicité avec les dominants et comme une seconde trahison de son milieu modeste, dont la réussite au CAPES l’a séparée. Par la grâce de l’argument sociologique, la platitude de ses écrits devient inattaquable, parce que présentée comme volontaire et nécessaire.
Lire aussi : Annie Ernaux : la littérature en ménopause
La platitude de sa vision du monde, à lire la presse enthousiaste, semble également intouchable. On croit pourtant lire, presque à chaque page, une défense et illustration d’un tract du SNES ou de Sud-Education, chantant le passé glorieux de la supposée libération du corps des femmes et appelant à une nouvelle vigilance. Sur ce point, le seul génie d’Ernaux est éditorial : il consiste à avoir découpé sa vie de femme de gauche en épisodes d’une série dont on sait d’avance que Marie-Claire et Elle l’applaudiront. Cela s’appelle trouver le bon filon. Petite, Ernaux dévorait La semaine de Suzette. Son œuvre, c’est Suzette adaptée aux goûts du jour et à des lectrices qui ont grandi avec la révolution sexuelle. Suzette, comme l’avait prédit sa maîtresse, est devenu professeur. Elle s’appelle désormais Annie et elle a lu Sade, Beauvoir et Bourdieu. Elle peut donc faire partager à tous l’itinéraire de son corps désirant d’intellectuelle de gauche.
Comme pour Suzette ou sur le modèle de la série des Martine, on peut aisément proposer quelques sous-titres : « Annie voit son premier film porno » (Passion simple) ; « Annie avorte » (Les Armoires vides, puis L’Événement, puisque c’est vendeur et que ça mène autant au Panthéon qu’au Nobel, et dans les deux cas sur les écrans) ; « Annie se masturbe » (à peu près dans tous les titres) ; « Annie passe le CAPES, son papa est très fier, mais elle est embêtée de parler mieux que lui » (La Place) ; « Annie couche avec un homme marié » (Passion simple, encore) et, plus récemment « la vieille Annie couche avec un très jeune homme, comme Marguerite Duras » (Un Jeune Homme). L’ensemble pourrait s’intituler « les Suzette à l’anis d’Annie ». La plupart des volumes sont d’ailleurs écrits aussi gros que des albums pour enfants, non pas pour que le jeune homme arrive à lire, mais afin que l’éditeur puisse décemment faire croire que c’est un livre entier.
Les phrases, quant à elles, sont souvent plus pauvres que dans la Semaine de Suzette, mais ce doit être une fois de plus pour éviter l’écriture bourgeoise : « Une fois, à la station Opéra, plongée dans ma rêverie, j’ai laissé passer sans m’en rendre compte la rame que je devais prendre » ou encore : « Aux feux rouges, de Nanterre au Pont-de-Neuilly, nous nous embrassions et nous nous caressions ». À l’arrivée, quand elle rapporte dans Les Années, parmi « les phrases terribles qu’il aurait fallu oublier », cette remarque : « tu ressembles à une putain décatie », on ne parvient pas à en vouloir totalement à celui qui l’a prononcée et on se dit qu’«Annie, putain décatie » pourrait fournir un titre de plus à la série. On l’aura compris, le principal argument de vente d’Ernaux est que « c’est pas si facile d’être une femme libérée », mais devant la platitude de l’ensemble, on se demande si Cookie Dingler ne méritait pas au moins autant d’être nobelisé.
Les œillères idéologiques, fâcheuses pour qui prétend faire œuvre sociologique et historique, ne sont rien à côté des gros sabots pédagogiques, qui toujours expliquent ce qu’il faut comprendre
Reste Les Années, le seul livre qui dépasse le niveau du journal intime de l’adolescente révoltée qui a fait des études de Lettres, mais regrette de ne pas avoir trouvé de description d’avortement dans La Princesse de Clèves. Considéré à juste titre comme son chef-d’œuvre (« son » et non « un »), Les Années offre un tableau sociologique très réussi de soixante ans de vie de la société française : Ernaux nous plonge dans les images qui sont « les signes spécifiques de l’époque » et dans les mots de « cette rumeur qui apporte sans relâche les formulations incessantes de ce que nous sommes et devons être ». Débordant de matériaux accumulés, le texte nous fait croiser une pub pour Paic Citron et l’élection de Mitterrand, Scarlett O’Hara et la guerre d’Algérie, L’Année dernière à Marienbad et les chaussettes de Bérégovoy, mai 68 et Bonne nuit les petits, sans oublier Saint Maclou évidemment. On se dit parfois que ça ne vaut guère mieux qu’un documentaire de FR3, « Cette année-là » de Claude François ou « Et mon père» de Nicolas Peyrac (« La pilule n’existait pas/ Fallait pas jouer à ces jeux-là » est sûrement le passage préféré d’Ernaux). En refermant le livre, on admet toutefois volontiers que l’ampleur des années couvertes, ainsi que les deux fils rouges qui entremêlent habilement mémoire collective et mémoire personnelle (les photos et les repas de famille) donnent un intérêt réel à l’œuvre. On pardonnerait presque à la narratrice d’être toujours la prof de gauche incapable d’emprunter un seul instant un autre point de vue que celui qu’elle entend depuis des années sur France Inter (les partisans du professeur Lejeune, bien sûr, rappellent Vichy et l’élection de Sarkozy ne peut s’expliquer que par « une envie de servitude et d’obéissance à un chef »).
Mais les œillères idéologiques, fâcheuses pour qui prétend faire œuvre sociologique et historique, ne sont rien à côté des gros sabots pédagogiques, qui toujours expliquent ce qu’il faut comprendre, sous prétexte de montrer – ô l’originalité suprême ! – que le narrateur découvre au fur et à mesure de l’écriture la forme qu’aura son récit. Le procédé était déjà omniprésent dans la série des Annie. Dans Passion simple, cela donnait : « L’imparfait que j’ai employé spontanément dès les premières lignes est celui d’une durée que je ne voulais pas finie ». Dans Une femme (« Annie perd sa maman »), c’était encore plus lourd : « Ceci n’est pas une biographie, ni un roman naturellement, peut-être quelque chose entre la littérature, la sociologie et l’histoire ».
Lire aussi : Richard Millet : le survivant
Dans Les Années, cela devient pachydermique, au point que la prof de Lettres finit par dévorer l’écrivain qu’elle a failli devenir, achevant son « autobiographie impersonnelle » par quatre pages de mode d’emploi. Sans doute soucieuse de faciliter le travail de ses anciens collègues, Annie Ernaux semble intégrer le livre du prof à son récit. « Dossier pédagogique inclus », a-t-on envie de tamponner en rouge sur la couverture, lorsqu’on lit, entre autres : « Ce sera un récit glissant, dans un imparfait continu, absolu, dévorant le présent jusqu’à la dernière page d’une vie » ou encore : « Aucun « je » dans ce qu’elle voit comme une sorte d’autobiographie impersonnelle – mais « on » et « nous » – comme si, à son tour, elle faisait le récit des jours d’avant ». Merci, Madame le professeur, de si bien nous expliquer votre livre.
On connaît la formule de Kundera pour définir la sagesse du roman : l’œuvre véritable est toujours plus intelligente que son auteur. En refusant le roman – étonnant, d’ailleurs, tous ces commentateurs qui tiennent à la qualifier de « romancière » – Annie Ernaux en a aussi perdu la sagesse. Son œuvre est exactement aussi intelligente qu’elle ; non seulement elle a les mêmes préjugés, les mêmes aveuglements, la même incapacité à emprunter un autre point de vue que celle de la prof de gauche, mais elle est régulièrement plombée par des fiches de synthèse qu’on s’étonne de pas voir couvertes de stabilo.
L’apothéose de la prof de Lettres de gauche est donc avant tout une défaite de la littérature. Il ne reste qu’à espérer qu’« Annie à Stockholm » sera le dernier épisode de la série.
EN KIOSQUE
Découvrez le numéro du mois - 6,90€
Soutenez l’incorrect
faites un don et défiscalisez !
En passant par notre partenaire
Credofunding, vous pouvez obtenir une
réduction d’impôts de 66% du montant de
votre don.
Retrouvez l’incorrect sur les réseaux sociaux
Les autres articles recommandés pour vous
Restez informé, inscrivez-vous à notre Newsletter