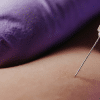David Lynch : L’homme entre les mondes
Par
Publié le
16 janvier 2025
Partage

Steven Spielberg lui avait donné en 2022, dans The Fabelmans, un de ses rares rôle en tant qu’acteur : dans un épilogue sidérant, on y voyait Lynch tenir le rôle de John Ford et donner quelques laconiques – mais inoubliables – conseils de mise en scène au héros sur le point de commencer sa carrière de réalisateur. Ford et Lynch : il fallait bien le génie de Spielberg pour faire le lien entre ces deux monstres que tout oppose en apparence. Pourtant, les deux hommes ont à leur manière alimenté une certaine légende de l’Amérique avec une œuvre à la fois et exigeante et… populaire. Car si Lynch s’était taillé une solide réputation de cinéaste avant-gardiste, volontiers cryptique, sa matière première reste d’une simplicité confondante et il n’aura de cesse, film après film, de tenter d’élucider un seul mystère : cette Amérique des années 50 qu’il a connu enfant et qui est la matrice fantasmatique d’à peu près tout le cinéma américain jusqu’à aujourd’hui.
Philadelphia Boy
Exception faire peut-être de son premier film, Eraserhead, coup de maître réalisé par un jeune étudiant en art féru de cinéma expressionniste et d’art plastique, qui fit les riches heures du cinéma de minuit new-yorkais où l’on projetait d’autres « eerie movies » – comme le fameux El Topo de Jodorowsky. Il faut dire que Lynch frappe fort avec ce film quasi-muet inspiré par les ambiances industrielles de la banlieue de Philadelphie où il a vécu, et hanté par le traumatisme du jeune père qu’il est : sa fille Jennifer est en effet née avec un pied bot. Eraserhead transfigurera ce handicap en paternalité cauchemardesque – Lynch inventant un nouveau-né en forme de lombric grâce à un effet spécial saisissant sur lequel il gardera toujours le silence – et ce malgré les pressions de Stanley Kubrick, fasciné par le film, qui voulait à tout prix en comprendre le fonctionnement. Mais ce n’est pas tout : dès Eraserhead, les bases du Lynch-verse sont posées, avec cette idée que notre réalité n’est qu’une couche du monde visible, et que d’autres couches, cosmiques ou chtoniennes, existent sur d’autres plans – saisissante image de la « fille du radiateur » qui hante les tuyauteries. Eraserhead attire l’attention de Mel Brooks qui lui propose un film de commande, ayant saisi dans le jeune réalisateur une capacité hors-norme à rendre le monstrueux séduisant. Elephant Man, film d’époque halluciné inspiré par la vraie histoire d’un homme défiguré et vendu comme un monstre de foire, porté par un noir et blanc charbonneux et par un crescendo émotionnel rarement vu au cinéma, sera sans doute le film de Lynch le plus touchant et le plus universel.
Lire aussi : « Les Feux sauvages » : une nouvelle ère pour le cinéma
Détour par les étoiles
En deux films, le réalisateur a déjà imposé sa marque : il est rentré au panthéon des cinéastes qu’on s’arrache pour imposer leur signature. C’est à ce titre que Georges Lucas lui propose de signer L’Empire contre Attaque : malgré une rencontre polie entre les deux hommes, le courant ne passe pas et Lynch sent déjà que Lucas a plus envie de vendre des figurines que de faire du cinéma. Il hérite pourtant d’une autre adaptation de science-fiction, et pas des moindres puisqu’il s’agir de Dune, space opera fleuve de Frank Herbert à la complexité redoutable, réputé inadaptable, et sur lequel Jodorowsky – encore lui – s’était déjà cassé les dents. Il aura fallu la rouerie des producteurs italiens De Laurentis père et fille pour persuader Lynch de s’engager, à 38 ans, sur un tournage pharamineux qui s’avéra un échec – tant critique que publique. On doit pourtant au métrage quelques saisissantes visions à côté desquelles le pénible remake de Denis Villeneuve ressemble à un luxueux téléfilm. Las, cet échec constituera pour Lynch une blessure qui ne se referma jamais mais qui lui permis de faire financer un projet plus personnel, sa première véritable entrée dans le Lynch-verse tel qu’il s’est déployé ensuite : Blue Velvet.
Lynch, qu’on a souvent traité d’artiste « difficile » cultive pourtant une philosophie minimaliste : il croit au Mal absolu comme il croit à l’Amour absolu
Rêves et cauchemars
Avec son prologue déroutant – le jeune premier incarné par Kyle MacLachan découvre une oreille sectionnée dans le jardin d’un paisible pavillon de banlieue – Blue Velvet frappe durablement les esprits : on est quelque part entre Buñuel et Philip K. Dick pour la peinture précise de cette Amérique contemporaine qui s’effrite à force d’être figée dans son propre fantasme, laissant échapper… le Mal. Lynch, qu’on a souvent traité d’artiste « difficile » cultive pourtant une philosophie minimaliste : il croit au Mal absolu comme il croit à l’Amour absolu. Et il est persuadé qu’entre les deux, ce consensus moral qu’on appelle le « réel » n’est jamais qu’un voile d’illusion – le fameux voile de Maya qui est au centre de la spiritualité hindouiste. Tous ses films, depuis Blue Velvet, hallucinant pastiche de film noir qui prend très vite des allures d’enquête cosmique, chercheront dès lors à percer ce voile, à montrer les choses qui sont derrière les choses, à prouver que la réalité américaine, fondée sur une terre maudite, suscitée par des exactions, est sans doute la plus fragile qui soit.
Vers la loge noire
Avec Mark Frost, scénariste obsédé par la théosophie et qui avait démontré comment le tout-Hollywood a été fondé par les occultistes et notamment par les séides d’Helena Blavatski, Lynch continue sa déconstruction méthodique du rêve américain avec Twin Peaks, série qui fondera sans doute les canons de la série télévisée moderne, au croisement entre le pastiche de soap opera, le drame de mœurs et le thriller déviant. Le personnage de Laura Palmer, victime autour de laquelle s’articule toute la série, est d’ailleurs un décalque de Marilyn Monroe – star qui fascina Lynch toute sa vie tant elle représentait à ses yeux le martyr hollywoodien. Succès légendaire aux Etats-Unis où des millions d’américains sont suspendus chaque semaine devant leur petit écran, le feuilleton sera malheureusement abandonné par ses créateurs en pleine saison 2 – encore une blessure que Lynch réparera avec Fire Walk with Me, préquelle d’une violence psychologique inouïe et dans laquelle toute la société américaine en prend pour son grade. Twin Peaks – et l’invention de la fameuse Black Lodge, à la fois métaphore du cinéma, représentation de l’impensé collectif et porte vers les autres mondes, constituera l’entrée de Lynch dans le pan le plus sombre de son œuvre incarné par la trilogie Lost Highway – Mulholland Drive – Inland Empire, trois rêveries terminales sur le pouvoir néfaste d’Hollywood, sur la façon dont les images enregistrées sont capables de soumettre les âmes et de corrompre la chair. Plus ouvertement expérimentaux, ces trois films sont probablement ce que l’histoire du cinéma retiendra de lynch, avec leur jusqu’au-boutisme, leur noirceur et cette forme très particulière d’horreur – une capacité que seule Lynch possède et qui consiste à susciter chez le spectateur une authentique terreur métaphysique, dans laquelle on retrouve volontiers des copeaux de Bergman, Antonioni ou même Rivette (Lynch, malin, ne parlera jamais vraiment de ses influences).
Lire aussi [Cinéma] The Fabelmans : lumineux
Le dernier cri
Une terreur qui culminera dans la troisième saison de Twin Peaks, cette fois maitrisé de A à Z par Lynch et Frost et qui se pose comme un épitomé de son œuvre. Œuvre testamentaire, phénoménale, réflexion sur le cinéma, peinture désespérée d’une Amérique rongée par la pauvreté, mais aussi chronique de la vieillesse et hommage aux acteurs disparus qui ont émaillé sa vie… une saison 3 inépuisable qui se regarde comme un film de 18 heures et qui culmine avec son fameux épisode 8 : une expérimentation muette de 45 minutes où Lynch revient littéralement aux origines cosmiques du Mal. La série se terminera en toute logique sur ce plan hallucinant, à la fois plein d’espoir et rempli de cette terreur quasi-gnostique qui baigne toute son œuvre : celle de comprendre que ce pan du cosmos où nous habitons n’est jamais qu’une prison. Le dernier cri de Laura Palmer, qui sera aussi le dernier plan tourné par Lynch, fera encore vibrer longtemps le cœur des cinéphiles.
EN KIOSQUE
Découvrez le numéro du mois - 6,90€
Soutenez l’incorrect
faites un don et défiscalisez !
En passant par notre partenaire
Credofunding, vous pouvez obtenir une
réduction d’impôts de 66% du montant de
votre don.
Retrouvez l’incorrect sur les réseaux sociaux
Les autres articles recommandés pour vous
Restez informé, inscrivez-vous à notre Newsletter