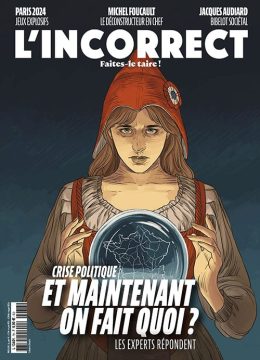Sélectron : 9 films vraiment cultes
Par
Publié le
5 mai 2020
Partage
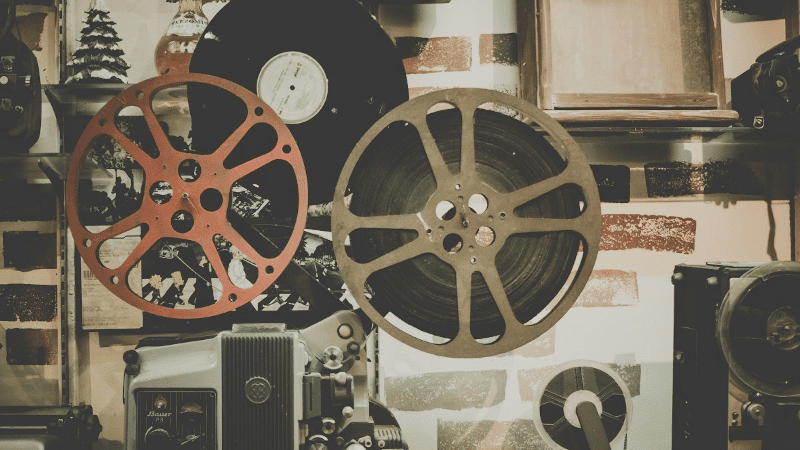
[vc_row css=”.vc_custom_1588667175526{margin-right: 25px !important;margin-left: 25px !important;}”][vc_column][vc_column_text]
Oubliez illico les listes de films cultes proposées par Mémère Magazine ou Toupitou le blog des tous petits. Quatre Mariages et un enterrement et Reservoir Dogs ne sont pas des films culte, et encore moins Les Goonies – même si nous en sommes les premiers désolés.
Un film culte, si l’on en croit l’austère et parcimonieux Sélectron (loué soit son Nom), c’est d’abord un film invisible, impossible à voir, un film qui a sommeillé trop longtemps dans les fantasmes des programmateurs de cinémas de quartier et dans les notules lunaires des magazines spécialisés, un film dont les cinéphiles pointus font la légende à base de rumeurs chuchotées, un de ces films que personne n’a jamais vus mais dont le titre suffit à provoquer dans le bas ventre un étrange frémissement de scandale – du moins avant que l’Internet omniscient ne mette à disposition du quidam la moindre bobine super 8 produite par Walerian Borowczyk entre mai et septembre 62. Un film culte n’est pas un film sympathique, au contraire : c’est un film forcément revêche, souvent arrogant, qui ne se donne pas facilement. Les années 70 et 80 furent profuses en la matière, c’était avant le Grand Retournement, avant que l’Œil Unique ne paralyse la moindre pulsion artistique qui pouvait demeurer intacte chez nos producteurs et artisans… C’est pourquoi la plupart des films présentés ci-dessous appartiennent en majorité à ce passé lointain. Le Sélectron a parlé.
Quand l’Embryon part braconner, Koji Wakamatsu (1966)
Non content d’avoir le titre le plus fabuleux jamais donné à un film, Quand L’Embryon est une entrée parfaite pour découvrir le cinéma de Koji Wakamatsu, cinéaste frondeur, anarchiste et formé à la réalisation dans les années 50 lorsque son clan de yakusas est engagé pour surveiller les plateaux de cinéma. Le jeune rookie se fait peu à peu une place d’assistant puis se voit confier la mise en scène de plusieurs pinku, ou « films roses », style en vogue en cette décennie de libération des mœurs et dans lequel s’engouffrent tous les grands studios nippons, flairant de juteux retours sur investissement. Wakamatsu utilisera le genre pour asséner son message à la fois désespéré et anarchiste, et utilisera notamment la figure de la femme-martyr pour symboliser son pays exsangue condamné par l’arrivisme et la spéculation. Filmé dans un noir et blanc crépusculaire, L’Embryon est une sorte de cauchemar urbain doublé d’un voyage aux confins du fantasme, où une jeune femme terrorisée par un inconnu aura l’occasion de se venger… ou pas. Jouant avec les codes du rape and revenge, le film sidère encore aujourd’hui par son intransigeante noirceur et son jusqu’au-boutisme total.
À l’Ombre de la canaille bleue, Pierre Clémenti (1986)
Pierre Clémenti ,c’est un peu le Rimbaud du cinéma des années 70, mâtiné de Burroughs pour le côté opiacé. À l’Ombre de la canaille bleue est son manifeste, un long-métrage qui est autant un hommage au cut up qu’un instantané de Paris pendant le Triangle d’Or, rebaptisée pour l’occasion « Necropolis », cette métropole du vice où il suffisait de se baisser pour trouver de l’héroïne pure. Porté par un poème en prose de Achmi Gachem (auto-proclamé le « bougnoule sexuel »), ce film tourné avec une caméra Beaulieu pendant plusieurs années est un impressionnant collages d’images et de sons, de scènes improbables et de portraits fulgurants. Pas ou peu d’histoire, si ce n’est du trafic de dope et de l’amour gluant : on y croise des figures légendaires et des petites frappes aux gueules cassées, inquiétantes : la prostituée Seringue, le Capitaine Speed, témoins de cette capitale néonique qui vivait alors au rythme de la drogue et de la new wave. Il n’y fait jamais jour : La Canaille bleue, c’est le spectacle déambulatoire de la nuit éternelle, qui se donne par surimpressions et gouaches de plans sanguins, préfigurant Mandico et Ossang, la came en plus. Une drôle d’expérience-limite, à ne pas mater sobre.
Black Moon, Louis Malle (1975)
Rarement cité dans l’œuvre de Louis Malle, et pour cause : Black Moon fut un fiasco. Film ambitieux sur lequel le réalisateur français avait beaucoup misé pour prendre à revers une critique déjà divisée par Lacombe Lucien. Las, le film fut un échec total et Louis Malle, vexé, ira aux USA filmer quelques-unes de ses plus belles réussites. Black Moon restera son film maudit. Il serait pour autant dommage de passer à côté de cet étrange objet qui traduit assez bien la mentalité de l’époque : angoisse du militarisme doublée d’un discours ambigu sur la rivalité homme/femme (Malle imagine un futur proche où les hommes et les femmes se font la guerre, une sorte de Calmos qui aurait dégénéré en massacre généralisé… voilà pour le pitch), et surtout un surréalisme très français qui puise à la fois dans le cinéma de Cocteau, Franju, Buñuel ou dans la peinture de Balthus. Magnifié par la lumière naturaliste du chef opérateur de Bergman et Tarkovski, ce Black Moon est une succession de saynètes dominées par la logique du rêve et par des juxtapositions fatales où se mêlent apparitions fantomatiques, processions d’insectes et bestiaire panthéiste. De véritables tableaux en mouvement traversés par une sorte d’Alice pubescente dévorée par son désir naissant. Prétentieux, assurément. Mais aussi obsédant et vénéneux.
Hausu, Nobuhiko Obayashi (1977)
Oubliez tout ce que vous avez vu : encore aujourd’hui Hausu fait partie du panthéon des films psychédéliques avec Lucifer Rising et La Montagne Sacrée. Sur un scénario de film d’horreur très classique (des lycéennes passent les grandes vacances dans une maison hantée), le génial publicitaire Obayashi livre ici une sorte de brûlot onirico-surréaliste qui ferait passer Michel Gondry pour un austère naturaliste. Entièrement filmé en studio, reproduisant les atmosphères de cartes postales surannées des années 50, accumulant les effets de montage et les trucages les plus variés, du plus obsolète au plus démonstratif, Hausu c’est un peu la rencontre improbable entre Dario Argento et Groucho Marx. Formidable collage d’influences, incroyable d’inventivité, Hausu se déguste comme une sorte de bonbon acidulé gorgé de LSD. Et de lycéennes japonaises, donc. Indispensable.
Lire aussi : Sélectron : 5 films qui… auraient dû rester des bandes annonces
Spider Baby, Jack Hill (1968)
Excellent artisan et bricoleur d’images, Jack Hill est un réalisateur typique de la fin des années 60 qui s’est essayé à tous les genres avec une générosité toujours égale, connu surtout pour avoir signé quelques succès du cinéma d’exploitation, du fameux Foxy Brown au graveleux Big Bird Cage – parangon de ce sous-genre très prisé qu’était le « film de femmes en prison ». Spider Baby fait figure de curiosité dans une œuvre déjà fort composite : filmée dans un noir et blanc léché qui se veut un hommage aux production de la Hammer, c’est un des premiers films américains à transposer des éléments d’horreur gothique dans un environnement domestique rural et à dépeindre une authentique famille de rednecks dégénérés, bien avant Massacre à la tronçonneuse. Jack Hill le fait avec une sympathique désinvolture et s’intéresse surtout à la poitrine de la belle Jill Banner, qui passe la moitié du film en nuisette, de façon totalement gratuite. Pourtant le métrage gagne d’étranges galons surréalistes à force de se vautrer dans le bis décomplexé et l’ambiance poisseuse, le jeu outré des acteurs et la direction artistique inspirée font de ce Spider Baby un insalubre joyau pour amateurs de raretés.
Le Vent, Victor Sjöstrom (1928)
Et Sjöstrom inventa le western métaphysique : fraîchement débarqué à Hollywood, le réalisateur suédois signe ici un monument du film muet à mettre à côté de L’Aurore. À partir d’un scénario étique (une femme seule, une visite nocturne), Sjöstrom déploie une grammaire tourbillonnante et regarde en face la folie, dépeignant les affres de la solitude et de la paranoïa dans un Far-west entrevu déjà comme une terre de spectres et d’abandon. D’une inventivité radicale, porté par une Lilian Gish complètement démente, Le Vent prouve encore aujourd’hui la formidable force picturale du cinéma muet, cet art presque invocatoire capable de suggérer l’invisible et de plonger dans l’abîme des âmes.
Viva la Muerte, Fernando Arrabal (1971)
Arrabal c’est un peu le jumeau disgracieux de Jodorowsky, avec qui il partage un anticléricalisme délirant et une passion pour toutes les sécrétions possibles du corps humain. Outre ces tares très communes aux années 70, son œuvre est aussi le fer de lance d’un cinéma surréaliste qui puise son inspiration dans l’actionnisme (le mouvement Panique, fondé avec Jodo et Topor) et dans une enfance anéantie par la guerre civile. Viva la Muerte est inspiré de son propre roman Baal Babylone, sorte de confession macabre où l’auteur s’adresse à sa mère et fait ressurgir les ombres cuisantes de leur passé commun. Dominé par cette figure de matriarche distante à la froide beauté, le film se donne comme une succession de souvenirs où l’imagination s’emballe, provoquant ces miniatures de la cruauté qui en feront pendant longtemps un film impossible à voir et censuré de toutes parts. Outre ces provocations parfois indigentes, il reste une œuvre forte et douloureuse, à ranger à côté de L’Esprit de la ruche et de Los Olvidados.
Chronopolis, Piotr Kamler (1983)
Piotr Kamler vient de la musique concrète et ça se voit : cet ancien collaborateur de Xenakis et de Parmegiani réalise avec Chronopolis une véritable partition musicale en images. En imaginant un astronaute perdu sur une planète inconnue où l’on fabrique du temps, Kamler signe un chef d’œuvre oublié du cinéma d’animation en volumes. Troublant, parce qu’il perd le spectateur dans les méandres de sa conception cyclique du temps, entrevu comme une sorte d’usine métaphysique où ses figurines en papier mâché distillent sans relâche la matière même de l’existence. Hypnotique, d’une beauté sidérante, Chronopolis est un objet presque unique dans le cinéma, une sorte de litanie poétique et cinétique qui prouve tout le génie autiste du réalisateur polonais, sa minutie et son goût du détail confinant parfois à la démence.
Requiem pour un massacre, Elen Klimov (1985)
La bombe absolue, le film qui change la vie. Oubliez Apocalypse Now, Voyage au bout de l’enfer ou les flatulences récentes de Dunkerque ou 1917 : Requiem c’est le film de guerre ultime, dont on ressort sali, terrorisé, mais aussi étrangement grandi. En relatant avec un pouvoir d’évocation stupéfiant la marche meurtrière des nazis sur le front biélorusse, qui occasionna à peu près autant d’Oradour-Sur-Glane que le pays comptait de villages, Elen Klimov signe un chef d’œuvre éprouvant qui commence comme une chronique enfantine onirique à la Tarkovski et finit par un explosion de brutalité et de noirceur. Le jeune interprète sera secondé par un psychologue pour affronter les neuf mois de tournage pendant lesquels Klimov, avec une application maniaque très soviétique, reproduit les conditions de vie et de mort de la campagne biélorusse pendant la guerre. À peu près impossible d’oublier cette successions de scènes hallucinées qui composent un climax de près d’une heure et ce plan incroyable où Klimov réussit à capter dans les yeux de son acteur quelque chose comme l’évaporation d’une âme.
Marc Obregon
[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]
EN KIOSQUE
Découvrez le numéro du mois - 6,90€
Soutenez l’incorrect
faites un don et défiscalisez !
En passant par notre partenaire
Credofunding, vous pouvez obtenir une
réduction d’impôts de 66% du montant de
votre don.
Retrouvez l’incorrect sur les réseaux sociaux
Les autres articles recommandés pour vous
Restez informé, inscrivez-vous à notre Newsletter