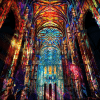CONTROVERSE SUR LE RAP : NOTRE RÉPONSE À MARIANNE
Par
Publié le
15 décembre 2020
Partage

Par la rédaction culture
Notre dossier avait bien pour vocation d’engager une réflexion polémique sur le nouveau genre dominant du village global : le rap. Certains nous applaudirent dès la couverture, d’autres nous conchièrent sans nous avoir lus. On nous traita de bourgeois pour ne pas s’extasier devant Booba. Il y a sans doute des bourgeois à L’Incorrect, ou qui seraient assimilés comme tels, comme sont représentées bien d’autres réalités sociologiques, mais il se trouve que les journalistes qui ont réalisé ce beau dossier ne coïncident pas franchement avec l’archétype. En outre, on voit bien la dialectique primaire à l’œuvre derrière l’épithète : le rap est la musique des « quartiers », des pauvres, la critiquer signifie forcément qu’on se trouve dans la classe adverse, du moins selon le schéma binaire des marxistes. Mais c’est encore ne nous avoir pas lus, puisque nous disons précisément que le rap est aujourd’hui la musique de tout le monde, des bourgeois blancs y compris, voire même de certains nationalistes ou identitaires européens (cf. le papier de Mathieu Bollon). Nous ne nous sommes donc jamais situés sur ce plan.
Simplement, nous nous foutons des exceptions, l’angle de notre dossier était d’analyser un phénomène général, et qu’il y ait quelques individus réellement talentueux ou doués d’une intelligence normale ne change rien à notre constat sur la moyenne, et sur la moyenne émergeante
Enfin, beaucoup y sont allés de leurs exemples de rappeurs témoignant une réelle maîtrise de notre langue et que si nous nous y connaissions, nous serions au courant. Outre que leur liste dépasse rarement trois ou quatre noms, toujours les mêmes, et que nous connaissions, notre dossier ne nie pas cette possibilité, et Ralph Müller, que nous avons interviewé, cite lui-même les quelques rappeurs pour lesquels il conserve une estime, simplement, nous nous foutons des exceptions, l’angle de notre dossier était d’analyser un phénomène général, et qu’il y ait quelques individus réellement talentueux ou doués d’une intelligence normale ne change rien à notre constat sur la moyenne, et sur la moyenne émergeante (pas les deux trucs indés pour mélomanes qui n’entraient pas dans le cadre de notre propos). Bref, tel fut notre angle d’attaque : une mise en perspective d’un genre saisi dans son histoire et sa globalité les plus manifestes pour en ébaucher une critique socio-esthétique.

LA PHILOSOPHE DU RAP
En réponse, dans Marianne, Kévin Boucaud-Victoire interviewe Benjamine Weill afin de défendre l’honneur du rap. Bien : nous sommes tout ouïe. Formée en philosophie, cette jeuniste exaltée a rédigé un livre à la gloire du rap et s’était déjà longuement exprimée sur Alohanews pour évoquer le sexisme du milieu : un petit morceau d’anthologie où, à l’instar d’un sociologue de gauche, l’experte ès hip hop joue sur la permanente confusion des registres et un glissement insidieux tout au long de sa démonstration pour réussir à caler la réalité récalcitrante sur son mantra idéologique. Non, le rap n’est pas sexiste, et quand il l’est, ce n’est pas lui qui l’est, mais l’Occident monothéiste qui le vampirise à son insu, parce qu’on sait bien que l’Occident monothéiste est manichéen donc sexiste, CQFD. Il y aurait trop à dire sur cet invraisemblable tour de passe-passe (il n’y a pas que l’Occident qui soit monothéiste, et ce qui caractérise le catholicisme est son opposition au manichéisme, par ailleurs, les centaines de concubines des empereurs chinois auraient eu à redire sur l’égalité des sexes) – quoi qu’il en soit, c’est cette spécialiste qui vient désormais éclairer nos consciences rapophobes.
PADAMALGAM
Les précisions, les corrections, les nuances, que cette dame apporte à l’histoire du mouvement ne sont pas inintéressantes, mais demeurent anecdotiques, le propos de Marc Obregon dans son papier panoramique ayant été de saisir une dynamique générale et son évolution tandis que les remarques de Benjamine Weill ne se situent jamais sur ce plan et ne rendent cette dynamique ni plus intelligible, ni même différente, tout juste servent-elles à prouver qu’elle connaît bien son histoire du rap. Elle nous reproche ensuite de faire un « amalgame dangereux » entre rap, contestation sociale et immigration. Devons-nous en conclure qu’il n’existe aucun lien entre les origines du rap en France et l’immigration ? Une telle assertion, contrairement à ce qu’insinue Benjamine, n’était en outre pas un jugement de valeurs, mais un simple constat, comme de dire que la naissance du punk a partie liée avec le prolétariat britannique et la crise économique des années 70. Imagine-t-on, sur ce sujet, Benjamine Weill nous expliquer qu’un tel amalgame est « dangereux », et que si le punk est bien une musique urbaine, la contestation sociale n’y est pas systématique et que la lier, cette musique, au prolétariat, sous-entendrait forcément dans notre esprit que les prolos auraient mieux fait de rester siffler dans leurs usines ?
INDIVIDUS IMPACTÉS
Nous expliquions comment le rap était devenu un pur symptôme du néo-libéralisme où chaque rappeur se fabriquait une identité narcissique fantasmée qu’il vendait ensuite comme produit. « Néanmoins, précise Benjamine, ce n’est pas la culture hip-hop ou le rap qui est ou non capitaliste, mais la perte de vitesse des idéologies collectives qui impacte les individus. » Pourtant, on ne voit pas des jazzmen ou des chanteuses de variété, aussi « individus impactés » qu’ils soient, exhiber des liasses de billets à tout bout de clip et il s’agit tout de même d’un leitmotiv du rap largement repérable. Mais voilà qui est trop simple : ce rappeur prône la loi du plus fort et fait l’apologie du fric ? Il est seulement « impacté par la perte de vitesse des idéologies collectives ». En termes de stratégie de déni, voilà qui touche au génie.
Lire aussi : Le rap, du guetto à la domination mondiale
Évidemment, le procès d’intention était inévitable, si nous critiquons la pauvreté d’une musique se résumant presque exclusivement au sampling : « Ce qui se lit en filigrane, c’est une question de couleur musicale dirons-nous et ses origines (même s’il oublie totalement l’impact de Chuck Berry sur le rock, mais bon… passons). » Notre critique serait donc raciste. Le papier de Patrick Eudeline, qui connaît mieux l’histoire du rock et Chuck Berry que Benjamine, entre autres, déplorait pourtant précisément que le génie noir américain si profus et si divers se soit depuis vingt ans dissout dans l’exclusive marmite du rap. Quant à ne pas comprendre que sous le joug de cette généralisation du rap, on se retrouve avec des créateurs de musique qui n’ont plus aucune réelle connaissance musicale, et que si ce n’est pas indispensable pour avoir du talent, cela trahit une certaine involution générale de la musique grand public, il faut vraiment ne rien saisir aux exigences de l’art.
LA FAUTE À L’INDUSTRIE
Quant on reproche au rap son récent conspirationnisme, nuançant cette critique en faisant un parallèle avec le rock, Benjamine répond : « Ce n’est pas le hip-hop et le rap qui met ça en avant, mais l’industrie qui considère que c’est ce qui vend ». Quand le rap est sexiste, c’est la faute à l’Occident ; quand il est capitaliste, c’est la faute à la perte de vitesse des idéologies collectives ; et quand il est conspirationniste, par contre, c’est la faute à l’industrie musicale. Parce que le rap, quant à lui, c’est pas du tout son genre. Mais comment pouvoir définir ce qui serait le genre de cet étrange Monsieur Rap abstrait, non incarné, n’ayant pas tendance au conspirationnisme, mais qui fait des confidences à Benjamine Weill pour lui avouer à elle seule ses vraies valeurs qui n’ont rien à voir avec celles qu’il exhibe au commun ?
OBSESSION ET DÉNI
Nous avons posé des constats sur l’évolution du rap en tant que tel, puis sur la rapisation générale de la musique mainstream. Chacun de ces constats, Benjamine Weill les élude par une stratégie de déni différente, sans jamais y répondre, sans jamais même sembler saisir quelle problématique a été soulevée. Et quand nous parlons du rap comme nouvelle « pop », ce qui signifie « popular music », quand nous regrettons que la diversité des musiques tende à se réduire à cet unique mode d’expression lui-même en phase de précarisation tant verbale que technique, ce qui nous paraît une inquiétude légitime, mais à laquelle on pourrait répondre que le rap est la synthèse supérieure de tout ce qui s’est fait auparavant et que c’est merveilleux, quand nous disons cela, donc, Benjamine Weill qui a sa propre traduction du mot pop « musique pop = musique festive pour le pop du bouchon de champagne en boîte de nuit », nous explique donc que oui, bien sûr, il y a du rap festif, mais pas que… et de nous faire à nouveau feuilleter son album Panini de ses groupes préférés…
Quant à ne pas comprendre que sous le joug de cette généralisation du rap, on se retrouve avec des créateurs de musique qui n’ont plus aucune réelle connaissance musicale, et que si ce n’est pas indispensable pour avoir du talent, cela trahit une certaine involution générale de la musique grand public, il faut vraiment ne rien saisir aux exigences de l’art.
Difficile de débattre à ce compte-là. Ce serait bien d’être capable de situer le rap au-delà de lui-même comme genre et d’en discuter de manière critique sans y mêler ses affects ou ses réflexes de fan. En traitant son sujet comme un gamin turbulent trop débile pour assumer quoi que ce soit, Benjamine Weill ne le grandit pas, et ne répond à aucune de nos critiques (quid de l’argumentaire linguistique de La Cartouche démontant la rhétorique régressive qui sous-tend la plupart des discours du rap actuel ?) Visiblement, Weill n’a pas les moyens d’assumer la battle. Dommage.
EN KIOSQUE
Découvrez le numéro du mois - 6,90€
Soutenez l’incorrect
faites un don et défiscalisez !
En passant par notre partenaire
Credofunding, vous pouvez obtenir une
réduction d’impôts de 66% du montant de
votre don.
Retrouvez l’incorrect sur les réseaux sociaux
Les autres articles recommandés pour vous
Restez informé, inscrivez-vous à notre Newsletter