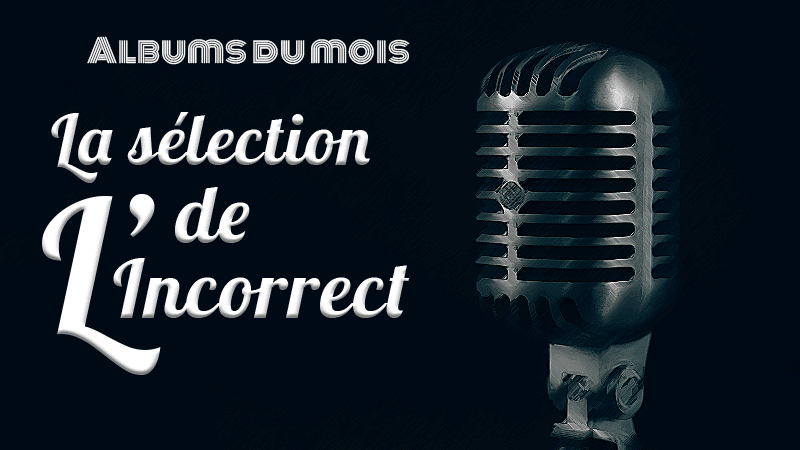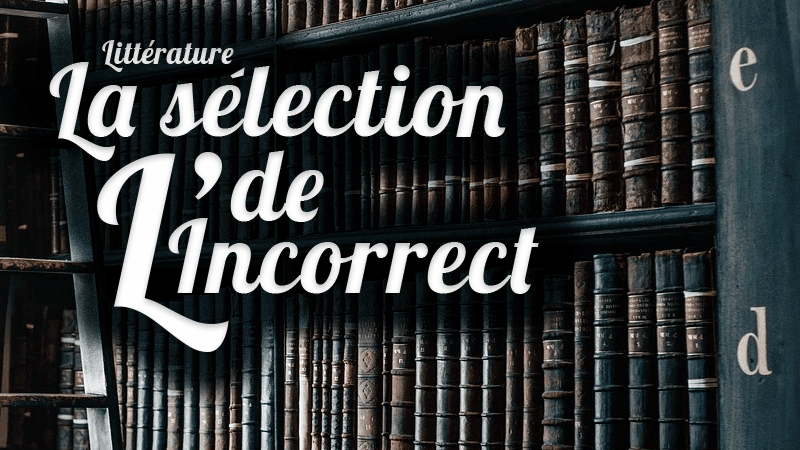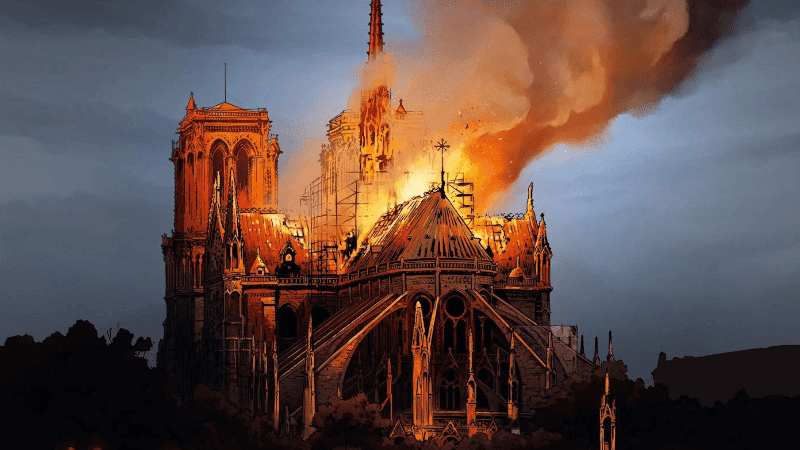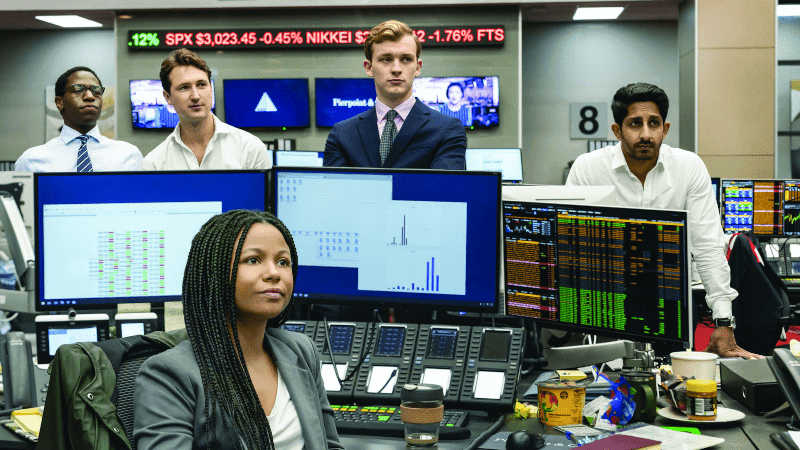Après avoir découvert que notre monde était devenu invivable, votre personnage, un professeur d’histoire-géographie parisien nommé Lazare, l’appelle « l’Immonde ». Pourquoi cette qualification ?
À l’origine, l’Immonde était une atmosphère. Une atmosphère que je n’ai pas besoin de détailler. Il suffit de se promener dans un centre-ville changé en galerie marchande, de passer trois heures au téléphone à rétablir sa connexion internet ou de tchatter sur un « site de rencontres totalement non-payant pour trouver l’amour » pour en ressentir immédiatement le dégoût. Les premiers lecteurs de Ce monde est tellement beau m’ont cependant suggéré de proposer une « théorie de l’Immonde ». Ce que fait Lazare pour moi, à la fin de la première partie du roman : « En rompant tout lien avec la réalité, l’univers sans regard qui s’était substitué à celui de la nature imposait aux individus de vivre sous le régime de la meute. Créé par l’artifice du commerce et du capitalisme, il se définissait par la rencontre de la technique, du collectif et de l’abstrait. Cette doublure qui enserrait la réalité pour la rendre inaccessible, c’était l’Immonde. » Par là, vous aurez compris que l’Immonde est le régime ordinaire des adorateurs de la Bête.
Votre roman est découpé en trois parties, « avant la loi », « sous la loi », « sous la grâce ». Est-ce l’histoire d’une libération, comme celle du peuple de Dieu dans la Bible ?
C’est en effet l’histoire d’une libération totale, en trois temps qui épousent à la fois les trois temps de La Divine Comédie – L’Enfer, Le Purgatoire, Le Paradis – et trois âges de l’humanité évoqués par saint Augustin. Nous n’avons pas le choix : toute vie est soit une dégringolade dans le néant soit une ascension vers la lumière. Avant de pouvoir vivre sous le régime de la grâce, l’humanité tout entière et chaque individu en particulier sont obligés de se souvenir de la loi de Moïse. [...]
La suite est réservée aux abonnés. Déjà abonné ?
Se connecter