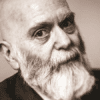Florian Henckel von Donnersmarck : La violente origine de l’art
Par
Publié le
16 juillet 2019
Partage
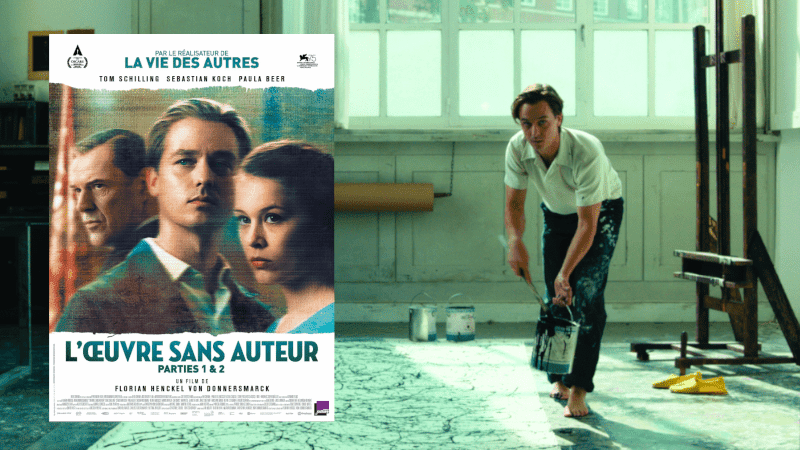
[vc_row][vc_column][vc_column_text css= ».vc_custom_1563276895417{margin-right: 25px !important;margin-left: 25px !important;} »]
Le 17 juillet sort sur les écrans français un chef-d’œuvre du 7e art rendant hommage au 3e, la peinture, et déployant une formidable fresque sur l’Allemagne au milieu du siècle dernier, du nazisme à la RFA exubérante des années 60 en passant par la destruction de Dresde et la RDA communiste. L’Œuvre sans auteur, de Florian Henckel von Donnersmarck ? Trois heures à couper le souffle.
Qu’est-ce que l’art ? Quelle est la signification de la souffrance ? Comment la démence idéologique peut-elle aliéner les sociétés ? Et l’amour offrir l’asile inespéré où le miracle a lieu ? C’est autour de ces grandes questions que tournent le film ainsi que l’entretien que nous a accordé le réalisateur de La Vie des autres, dans un français parfait et en faisant référence à de Gaulle et Fouché. Rencontre en haute altitude.
Après La Vie des autres, votre nouveau film tourne une nouvelle fois autour de l’expérience totalitaire européenne. Est-ce parce qu’en dépit des apparences, nous n’avons toujours pas pris la mesure de ce trauma ?
Il y a comme une erreur de programmation dans l’âme humaine qui nous rend susceptibles d’adhérer aux idéologies. C’est quelque chose de très dangereux, parce que celles-ci nous mènent à escamoter notre propre expérience, nos jugements et nos émotions. Nous nous trouvons alors prêts à accomplir des actes d’une manière impersonnelle. Et ce n’est pas tant le contenu comme tel qui représente un danger, que la forme idéologique en elle-même ! Lorsque les communistes ont pris le pouvoir en Allemagne de l’Est après la défaite des nazis, ils ont prétendu prendre leur exact contrepied. En art, ils ont par exemple affirmé que le réalisme socialiste serait le contraire de l’art promu par les nazis. Il est pourtant très ardu, aujourd’hui, de faire la différence entre l’art officiel du Troisième Reich et l’art officiel de la RDA… L’art implique que la communication entre l’artiste et son public se produise à un niveau si intime que cette communication atteint une dimension spirituelle. Mais ce phénomène est abrogé dès lors qu’une idéologie détermine le contenu. Alors il existe, aujourd’hui, en Allemagne, une grande vigilance devant toute résurgence possible de l’extrême droite, si bien qu’à la moindre manifestation un peu trop droitiste, s’organise immédiatement une contre-manifestation dix fois plus importante. Pourtant, on se trompe grandement en s’imaginant que si elle devait ressurgir en Europe, la démence idéologique prendrait la même forme qu’elle a empruntée au milieu du XXe siècle.
« Lorsqu’on étudie les biographies des artistes, on remarque que l’art agit comme un processus alchimique qui transmute en or le plomb de leurs traumatismes. »
Vous abordez dans votre film de très nombreuses thématiques, mais quel a été le sujet déclencheur ?
Il s’agissait pour moi d’analyser la créativité humaine. Or, lorsqu’on étudie les biographies des artistes, on remarque que l’art agit comme un processus alchimique qui transmute en or le plomb de leurs traumatismes. J’ai donc voulu raconter l’histoire d’un artiste, mais aussi de toutes les souffrances qui l’atteignent au cours de son existence avant qu’il ne parvienne à trouver son style. On comprend comment l’absence d’un seul épisode douloureux empêcherait que son art surgisse tel qu’il surgit. Je suis convaincu qu’en art comme ailleurs les souffrances ne sont jamais vaines.
Lire aussi : La vie palpable
Une opposition ne se joue-t-elle pas entre le rationalisme dément des nazis et la folie lucide de l’art ?
Le terme « rationalisme » est presque trop positif pour qualifier le nazisme. Encore une fois, on est confronté au mal de l’idéologie qui implique que si une certaine conviction entre en contradiction avec la nature humaine, c’est cette conviction qui prévaut néanmoins, ce qui la rend complètement dévastatrice. Cela apparaît dès la première scène du film, lorsqu’Elisabeth emmène son neveu Kurt à cette exposition d’ « art dégénéré » organisée par les nazis en 1937. Les nazis avaient confisqué toutes les œuvres qu’ils considéraient comme « dégénérées » et ils ont exposé ces toiles aux yeux de plus de deux millions de spectateurs afin de critiquer essentiellement l’expressionisme et la Nouvelle Objectivité selon l’argument suivant : « Regardez ce que veulent ces artistes pour notre pays: que les femmes soient des prostituées, les vétérans des êtres informes et des mendiants, etc. »
Ce qui est fascinant, c’est qu’ils n’étaient même plus en mesure d’imaginer que l’art puisse obéir à une autre intention que l’éloge de son sujet, qu’il puisse, par exemple, formuler un cri de désespoir, parce que de telles options n’entraient pas dans les cases de leur idéologie, laquelle ne présentait de l’art qu’une conception simpliste. Quant à la question : « Où commence la folie et où se termine l’art ? » C’est une frontière parfois difficile à déterminer, mais ce n’est en tout cas pas à une quelconque idéologie de s’en charger.
Votre film rappelle les grandes fresques hollywoodiennes d’avant le « Nouvel Hollywood » qui parvenaient à conjuguer rigueur esthétique et accessibilité…
Je vois le cinéma plutôt comme une expérience que comme la manifestation d’un certain style. Je suis tout autant contre les idéologies en art qu’en politique et je ne me réclamerai jamais d’aucune école, ni d’aucun mouvement. Toute expression artistique doit être quelque chose de personnel et la meilleure manière d’y parvenir est de ne pas mettre au premier plan certaines techniques considérées comme innovantes dans l’espoir qu’un critique s’émerveille d’un mouvement de caméra, car alors on risque d’arracher le spectateur à l’histoire.
On donne un prix Nobel à Dario Fo plutôt qu’à Tolstoï parce que Dario Fo crée une nouvelle grammaire alors que Tolstoï exploite, lui, une grammaire préexistante, mais c’est parce que Tolstoï s’occupe avant tout de servir ses histoires. Le réalisateur de Toy Story choisit ce style d’animation non pour rechercher un effet quelconque mais afin de pouvoir raconter ce qu’il veut nous raconter. C’est par l’expérience et l’émotion que l’on touche le grand public. Cela étant dit, si mon objectif principal avait été de toucher le grand public, il n’est pas sûr que choisir de réaliser un film de trois heures sur un peintre allemand contemporain ait été la meilleure option…
Vous avez su vous entourer d’un chef opérateur particulièrement prestigieux : Caleb Deschanel, qui a travaillé sur L’Étoffe des héros, Titanic ou La Passion du Christ…
Caleb Deschanel est sans doute le chef opérateur que j’admire le plus. Il était déjà le chef opérateur du deuxième film que j’aie vu dans ma vie, L’Étalon noir (1979), l’histoire d’une relation entre un petit garçon et un cheval racontée entièrement en images; un vrai film d’art pour enfant. Je doute qu’il soit encore possible de faire quelque chose de cet ordre aujourd’hui dans le système hollywoodien. Lorsque j’ai eu l’idée de L’Œuvre sans auteur, je l’ai appelé avant même d’avoir commencé à écrire et je lui ai dit que je voulais lui raconter mon histoire parce que je ne voyais pas qui pouvait la photographier si ce n’était lui. Durant un petit-déjeuner qui a duré pas moins de cinq heures, je lui ai décrit le film scène par scène ! Je sais qu’on lui propose presque tous les films à Hollywood et qu’il les refuse presque tous, mais il m’a répondu que si j’écrivais le film exactement comme je venais de le lui raconter, il était prêt à travailler avec moi, parce que cela touchait à tous les thèmes qui le passionnaient, notamment ce mystère de la créativité humaine. Ça a été une expérience formidable de travailler avec lui et d’apprendre à faire confiance à sa lumière si chargée en émotion et en intensité.
Comme je l’expliquais au réalisateur Jon Faveau qui cherchait un chef opérateur pour son Roi Lion (sortie juillet 2019), Caleb Deschanel a beau avoir plus de 70 ans, personne n’est aujourd’hui plus innovant et plus intelligent dans son domaine : il réinvente le cinéma. Prenez La Passion du Christ – et je pense personnellement qu’à rebours de la perspective de Mel Gibson, il aurait été plus intéressant de montrer le minimum plutôt que le maximum de ce qu’on sait des souffrances de Jésus – néanmoins, le film est très impressionnant grâce à la lumière de Caleb, qui s’inspire directement de Caravage.
Je crois qu’il est très important de montrer les choses, que ne jamais détourner le regard est un bon principe dans la vie, parce que cela permet aussi de voir parfois les choses au-delà de nos préjugés
Justement, pour ce qui est de montrer la violence, il y a une scène terrible dans votre film où vous montrez les chambres à gaz. La question de montrer cela au cinéma a donné lieu à de nombreuses polémiques. Comment l’avez-vous appréhendée ?
Je me souviens très bien de cette polémique autour de La Liste de Schindler, déclenchée par Claude Lanzmann, ce grand documentariste, qui avait a attaqué le film parce qu’y était montré le «dedans» des chambres à gaz. Lorsque le réalisateur hongrois László Nemes a réalisé Le Fils de Saul (2015), qui présente une immersion complète dans un camp de concentration, celui-ci a appelé Claude Lanzmann pour l’avertir qu’il venait de réaliser un film allant à 100 % à l’encontre de son dogme. Après l’avoir vu, Lanzmann a déclaré que c’était un grand film et qu’il renonçait à son propre dogme.
Je crois qu’il est très important de montrer les choses, que ne jamais détourner le regard est un bon principe dans la vie, parce que cela permet aussi de voir parfois les choses au-delà de nos préjugés. Dans le film La Chute (2004), j’avais été très surpris par ce choix étrange de ne pas montrer le moment où Hitler se suicide. Pourquoi rester derrière la porte et ne pas montrer comment cet homme est mort d’une façon si sordide ? D’autant que nous avons une idée assez concrète sur la façon dont cela s’est déroulé. La scène des chambres à gaz est très brève, mais c’était important de la mettre en scène afin que le crime des nazis ne reste pas quelque chose d’abstrait.
Lire aussi : La semaine cinéma de l’Incorrect
Vous montrez d’ailleurs un aspect souvent moins connu de la Shoah qui est l’assassinat industriel des handicapés mentaux, notamment des trisomiques. Les termes qu’emploient les nazis à leur sujet font d’ailleurs un étrange écho avec les polémiques actuelles sur la dignité ou l’indignité de vivre. Il y a quelques années, Bernard Kouchner avait même demandé qu’on n’utilise plus le mot « euthanasie » parce qu’il comprenait le mot « nazi ».
Ce ministre a raison, dans le mot euthanasie il y a « nazi » et c’est précisément pour cette raison qu’il faut continuer de l’utiliser ! Ça montre comment il est profondément contre-nature de tuer les plus faibles. Je connais plusieurs personnes atteintes de la trisomie 21, et il était d’ailleurs beaucoup plus fréquent d’en rencontrer auparavant. Mes enfants en croisent quant à eux très rarement. Les trisomiques ont été éliminés et je dois vous dire qu’ils me manquent parce qu’ils ont toujours ajouté quelque chose de beau et de joyeux à l’existence. Cette bonté que j’ai connue chez mes amis atteints de trisomie, on la découvre rarement ailleurs. Naturellement, une personne trisomique demande un immense effort à ses proches et c’est très compliqué d’assumer jusqu’à sa mort quelqu’un qui conserve toujours quelque chose d’enfantin et ne devient jamais pleinement autonome. Mais ces sacrifices peuvent être récompensés : regardez de Gaulle, qui a demandé à être enterré avec sa petite fille trisomique parce qu’elle
était, selon lui, le centre de sa vie. Ceux qui connaissent des personnes trisomiques savent à quel point on peut ressentir auprès d’elles quelque chose d’extraordinairement pur.
Si j’ai fait dire par cette fille trisomique un « Je t’aime bien » à l’attention de l’infirmière qui s’apprête à la gazer, c’est parce que les personnes trisomiques, je l’ai constaté, éprouvent un grand besoin de nous dire tout le temps qu’ils nous aiment bien, au point que c’en est presque drôle. Après que la jeune trisomique a dit cette phrase lors de la première prise, les autres actrices trisomiques qui étaient sur le plateau se sont mises à dire «Je t’aime bien» à tout le monde et on ne pouvait plus les arrêter tellement ça leur plaisait de le dire. C’était magnifique. Je crois que les personnes de notre société qui discutent de ces problèmes de manière abstraite ne se rendent pas compte de ce qu’ils perdent si on élimine les plus faibles. Je ne peux pas comprendre une telle attitude.
« Ce sont finalement les scènes d’amour dont je suis le plus fier, notamment en raison de la difficulté de les réaliser avec de jeunes acteurs, en plein climat “Me Too”. »
Le couple que forment Kurt et Elie rayonne d’un amour extrêmement pur, comme s’ils essayaient de former une bulle saine au milieu d’un monde de terreur, une bulle au sein de laquelle redevient possible le déploiement de l’amour, de l’art et de la personnalité…
Oui, et c’est pourquoi les scènes d’amour étaient essentielles. Le cinéma est redevenu assez prude mais il était très important pour moi de réaliser ces scènes parce qu’elles montrent précisément ce dont vous parlez : comment se forme une île de bonheur. C’est une chose qu’on oublie quand on arrive à un certain âge, mais durant cette période qui court de 17 à 27 ans – l’âge de mes protagonistes adultes –, on ne dispose ni de confort, ni d’argent, ni de pouvoir, alors qu’on a déjà conscience de ce qu’on pourrait faire… Le pouvoir est détenu par les plus vieux qui essayent d’utiliser les jeunes gens en vue de leurs propres buts. Pourtant, ces jeunes ont pour eux un pouvoir bien plus fort: cette capacité d’aimer, cette capacité d’acceptation sincère et entière de l’autre.
Or, cinématographiquement, c’est en montrant l’acte d’amour qu’on peut exprimer cela. Personnellement, je trouve souvent problématiques les scènes de sexe parce qu’il peut s’agir de montrer simplement une consommation brutale de l’amour ou de dévoiler un beau corps de femme. J’ai d’ailleurs beaucoup échangé à ce sujet avec Paul Verhoeven (réalisateur de Basic Instinct) qui se heurtait au même problème. Il m’a confié qu’une scène d’amour devait impérativement faire avancer l’histoire au même titre qu’un dialogue ou qu’une scène d’action qui vont nous faire comprendre la relation qui se noue entre deux personnes. Ce sont finalement les scènes dont je suis le plus fier, notamment en raison de la difficulté de les réaliser avec de jeunes acteurs, en plein climat « Me Too ».
Lire aussi : À voir ou à fuir, c’est la semaine cinéma de L’Incorrect
Pourquoi n’avoir pas simplement réalisé un biopic de Gerhard Richter, le peintre qui a si fortement inspiré votre personnage principal ?
Les données de la réalité sont toujours beaucoup moins intéressantes que la fiction. Le problème des « biopics », c’est que soit l’on se dit qu’on ne peut pas se permettre certaines choses parce qu’elles dérogent aux faits réels ; soit on s’autorise à s’éloigner de la réalité au point que ce n’est plus très honnête de présenter encore la chose comme biographique. Je ne suis pas documentariste, je n’ai pas voulu être contraint par les faits et j’ai donc simplement écrit l’histoire qui me semblait être la meilleure histoire, à partir d’une certaine réalité.
Cette manière de procéder correspond à une vraie tradition cinématographique. Citizen Kane, par exemple, est un film inspiré de la vie de William Randolph Hearst, mais je suis sûr que Hearst n’avait pas un traineau qui s’appelait Rosebud et que toutes les choses qui forment le centre dramatique de ce film sont très éloignées de son existence réelle. Cela ne m’aurait pas intéressé de voir un film fidèle aux faits et qui aurait été intitulé « Citizen Hearst », je préfère une bonne fiction, c’est-à-dire une fiction nourrie par la réalité plutôt que par des données historiques précises. En allemand, nous avons un très beau mot qui désigne à la fois la fiction, la poésie et la densité. La biographie de Goethe s’appelle Dichtung und Wahrheit (Poésie et Vérité en français) qu’on peut traduire par « Fiction et Réalité », « Poésie et Réalité » mais aussi par « Densité et Réalité ». Jouer sur cette ambiguïté permet de suggérer que la fiction est finalement une version plus dense de la réalité. Voilà ce que je veux créer.
Le fait que vous soyez issu d’une vieille et prestigieuse famille allemande (les Henckel von Donnersmarck sont une famille comtale de Haute-Silésie), vous donne-t-il une responsabilité particulière vis-à-vis de l’histoire de votre pays ?
Je suis très peu satisfait de la politique d’Angela Merkel et surtout de la coalition qu’elle conduit, si bien que je me demande parfois comment cela est possible que mes ancêtres aient aimé ce pays au point de tout lui donner. Ils étaient très actifs dans la politique, alors je me demande parfois s’ils ne seraient pas déçus que je ne m’y sois, moi, pas davantage intéressé. Mais je crois malheureusement que la politique, aujourd’hui, ne permet pas d’avoir des positions fortes, car il faut être suffisamment flexible et complaire à l’opinion majoritaire pour parvenir à être élu. En revanche, je pense qu’il y a d’autres possibilités que la pure politique électorale si l’on veut défendre certaines positions.
Propos recueillis par Romaric Sangars et Arthur de Watrigant
[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]
EN KIOSQUE
Découvrez le numéro du mois - 6,90€
Soutenez l’incorrect
faites un don et défiscalisez !
En passant par notre partenaire
Credofunding, vous pouvez obtenir une
réduction d’impôts de 66% du montant de
votre don.
Retrouvez l’incorrect sur les réseaux sociaux
Les autres articles recommandés pour vous
Restez informé, inscrivez-vous à notre Newsletter