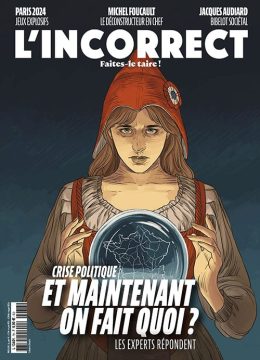Les jeux-vidéos à l’assaut de l’imaginaire
Par
Publié le
13 décembre 2017
Partage

[vc_row][vc_column][vc_column_text css=”.vc_custom_1513158794322{margin-right: 25px !important;margin-left: 25px !important;}”]
Tout individu s’adonnant aux jeux électroniques après ses 20 ans devrait être foudroyé sur le champ. Pour contribution à la déresponsabilisation globale de ces trentenaires bientôt quadras qui continuent à essuyer leurs nez morveux dans les jupons décatis de quelque terrible mère maquerelle pourvoyeuse de divertissements et qu’on appelle doucettement Occident.
Est-il pensable de jouer sur son téléviseur autrement que dans le salon familial, pétri de confiseries et d’un bon lustre séborrhéique, alors que fume dans la cuisine attenante quelque gros quatre-quarts confectionné par Maman pour fêter un bon bulletin de notes ? La réponse est non. Les jeux vidéo, comment leur nom l’indique, sont avant tout l’émulsion bidimensionnelle de jouets. Ce ne sont que des joujoux aplatis, encodés et simulés pour être reproduits sur des écrans, avec une interaction minimale. Il s’agira toujours de tuer des méchants. Il s’agira toujours de brandir un pistolet. Qui peut oser s’adonner à ce genre d’activité passé l’âge des premières foutances inquiètes dans les capiteux divertissoirs du putanat lycéen ?
Lire aussi : De quoi le sacre de la bande dessinée est-il le nom ?
Les jeux vidéo apparus dans les années 80, au même titre que les illustrés ou les feuilletons télévisés, avaient le mérite d’accompagner les jeunes hommes dans le douloureux processus de l’appropriation de leur sexe, de leur combativité et de leur entêtement. Ils provoquaient aussi l’imagination car leur représentation en pixels et en deux dimensions forçait l’esprit à inventer ce qui manquait : le cerveau se chargeait de surseoir à cette pauvreté visuelle et peuplait naturellement de ses propres hypostases cet espèce de hors-champ inique du jouet électronique : à l’instar des jeux de construction, ils dotaient le monde d’une ligne claire autour de laquelle il s’agissait de reconstruire une perspective qui constituait alors un exorable levier à toutes les préhensions possibles de l’expérience imaginale.
Le jeu vidéo a finalement reproduit en accéléré les mutations propres à toute représentation artistique : passant d’un art archétypal, puis symbolique, il s’est bien vite doté d’un appareil de représentation puisant dans l’art bourgeois ses pulsions les plus contrefaites. Singeant en cela l’ineffable évolution des arts vers le repoussant maniérisme, les jeux vidéo se sont dotés d’une troisième dimension dès lors que les processeurs ont eu assez de puissance pour calculer ce qui devait rester de l’ordre de l’invisible. Etrange histoire de l’art émise en fast-forward. Les poétiques scrollings horizontaux, quasi-rupestres, des premiers jeux Squaresoft, les lignes de fuite de la représentation isométrique ont laissé la place à des travellings sans fin dans des univers persistants : la pornographie avait fini par s’infuser également dans le jeu vidéo. Tout voir, tout posséder, tout explorer : le hors champs, l’ellipse naturelle contenus dans un jeu en deux dimensions devenaient immédiatement caduques, ruinant toutes ses instances poétiques et propitiées. En lieu et place, une pulsion exploratoire qui se heurte soudain à la logique inerte des algorithmes. Le sprite, cette construction minimaliste de pixels, se déformait sous les coups de boutoirs de la puissance de calcul pour devenir cet immonde personnage photoréaliste bondissant dans toutes les directions possibles. En quelques années le jeu vidéo, d’aimable lubie pour adolescent chétif, devenait un sport. Ô suprême immondice que la rencontre de ces tares de la bourgeoisie la plus indolemment vautrée dans le divertissement : le jeu et le sport. J’en frémis encore.
Lire aussi : L’art contemporain, l’esprit au piège
Ayant tout de même saisi une manette de jeu plusieurs fois depuis l’avènement des consoles next-gen, j’ai été frappé par le sentiment extrême et pesant de solitude que cette pratique semblait causer : être confronté à un programme, dans un monde soit disant ouvert mais clos, dont les bordures extérieures étaient scellées par d’indicibles lignes de codes, possiblement trouées par des glitchs comme par des trous de vers dans un cosmos desquamé, il y avait là de quoi frémir : passé l’âge où la simulation permet aux capacités cognitives d’évoluer, de créer des grilles patentes de compréhension, le jeu vidéo m’apparaissait comme une parodie proto-gnostique du réel où tous se jetaient sans voir une seule seconde qu’il s’agissait là d’une contrefaçon démoniaque causée par un réel démiurgique et dégondé, se dupliquant lui-même et inventant au travers de ses programmeurs ces déprimants vase-clos digitaux où nous mimions des actions crétinisantes à travers des pantins numériques grotesques. Ultime abjection : il existait même des jeux d’horreur. Voilà bien l’oxymoron de l’ère moderne résumé en un seul concept : un jeu d’horreur. Il y a évidemment quelque chose de proprement fascinant dans ces survival horror qui proposent une expérience immersive de l’angoisse, retraduisant finalement cette terreur enfantine du croquemitaine qui épouse vos pas dans l’ombre… et bien sûr de nombreux jeux ont poussé certaines logiques cinématographiques expérimentales dans leurs retranchements. J’entends déjà les cris d’orfraies des tâteurs de manettes biberonnés à Chronic Art défendre qui, des jeux indé, qui, d’un Cuphead déroulant magnifiquement l’esthétique des studios Fleischer, qui, d’un Life is Strange censé tutoyer le doute métaphysique d’un David Lynch.
Il y a évidemment de belles choses qui ont été faites à travers ce média, là n’est plus la question depuis longtemps. Ce qu’on peut craindre, en revanche, dans la globalisation de ce qui aurait probablement dû rester un divertissement de niche, c’est la perte d’une image-clé à la base de toute expérience imaginale, c’est la fractalisation de la pulsion qui intervient en retour, c’est la récupération par des majors du moindre recoin d’imaginaire qui pourrait échapper à la numérisation globale : comment rêver alors qu’on peut désormais explorer des mondes reconstructibles à l’infini, tel le babélien empire de Minecraft, grand «comme dix fois le Cosmos connu» ? Il y a quelque chose de fascinant et d’effrayant à voir l’imaginaire s’instancier de cette façon, numériquement et idéologiquement, au travers d’un nihilisme prométhéen. Je ne m’inquiète pas de savoir si les digital natives pourront rêver, mais de savoir de quoi seront fait leurs songes : si ces briques digitales qui s’amoncellent à l’infini n’ont pas fini par se recopier elles-mêmes à la source de notre propre appréhension du réel, et, par-là, incuber sournoisement ce qui nous reste de libre-rêver. Sur ce, je retourne finir ma partie de Sonic 2.
[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]
EN KIOSQUE
Découvrez le numéro du mois - 6,90€
Soutenez l’incorrect
faites un don et défiscalisez !
En passant par notre partenaire
Credofunding, vous pouvez obtenir une
réduction d’impôts de 66% du montant de
votre don.
Retrouvez l’incorrect sur les réseaux sociaux
Les autres articles recommandés pour vous
Restez informé, inscrivez-vous à notre Newsletter