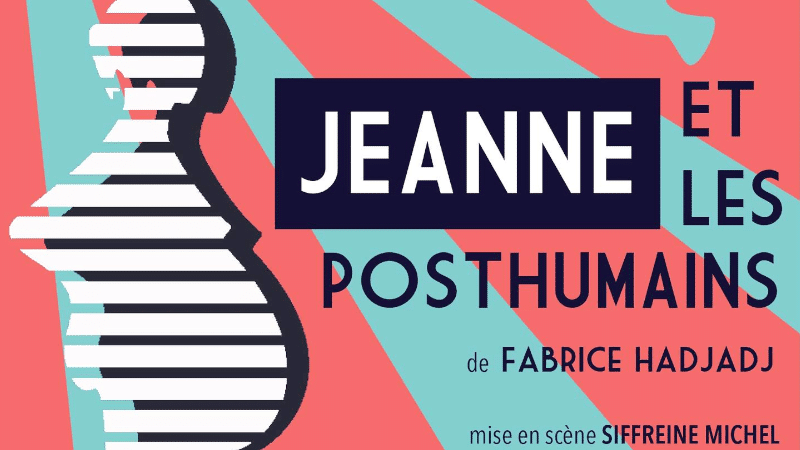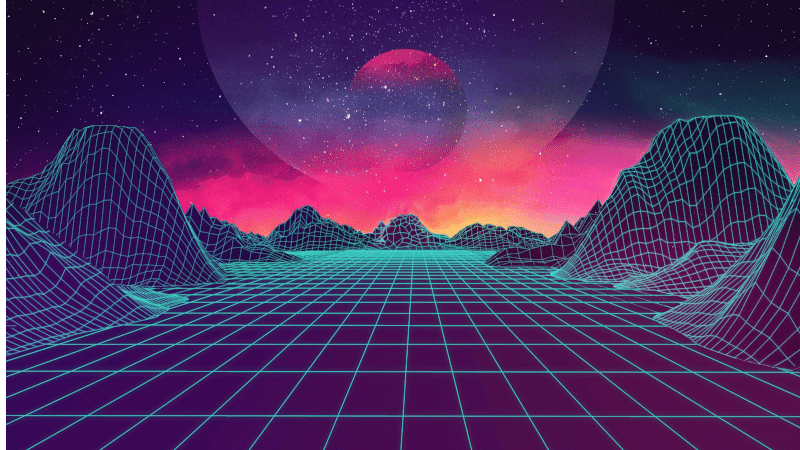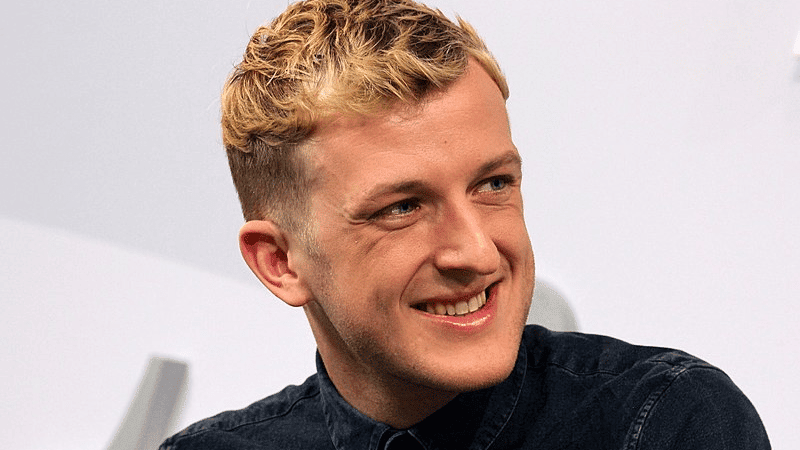C’est peu de dire qu’il n’y a pas beaucoup de points communs entre les navrants pensums d’aujourd’hui et le cinéma d’exploitation d’antan, qui se servait de l’alibi féministe pour produire des films à la violence parfois jubilatoire et à l’érotisme pas vraiment « Judith Butler-compatible ». Coup de projo sur d’authentiques brûlots qui ne parlaient pas du viol avec des trémolos de moraline compassionnelle, mais plutôt avec les moyens d’alors : décomplexés.
La Source, Ingmar Bergman (1960)
On est assez loin de la série B, mais La Source n’en reste pas moins un des premiers films à aborder le thème de la vengeance féminine. Magistral, à la fois naturaliste et poétique, porté par un noir et blanc à la beauté stupéfiante et par l’interprétation tout en nuances de la sublime Gunnel Lindblom - dont l’ultime regard vous hantera longtemps. Un film séminal et hanté qui inspira des générations de cinéastes.

The Black Cat, Kaneto Shindo (1968)
Kaneto Shindo signe ici un mètre-étalon du rape and revenge, servi par une mise en scène sauvage, traversée de fulgurances plastiques, qui retranscrit à merveille la brutalité de l’ère féodale japonaise. Avec cette histoire de samouraïs massacrés les uns après les autres pour avoir participé à un viol collectif, Shindo dénonce tous les travers de la société japonaise des années 60, tout aussi violente et corrompue. Flirtant avec le fantastique propre aux kaidan-eiga, The Black Cat est un véritable cri de détresse qui n’a rien perdu de sa radicalité.
Thriller, Bo Arne Vibenius (1973)
Sans doute le film qui entérine les canons du genre, avec son héroïne glaciale (forcément, elle est suédoise) mono-oculaire et solidement armée. Tarantino pillera largement l’œuvre de Vibenius, la classe en moins. Thriller (Crime à Froid en VF) reste aujourd’hui un témoignage unique de ce que pouvait produire le cinéma d’exploitation à l’époque, entre une esthétique complètement avant-gardiste, voire expérimentale, et un premier degré cathartique. Indispensable pour tout amateur de bobine radicale. [...]