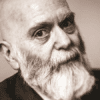Y a-t-il des héros après Dien Bien Phu ?
Par
Publié le
14 février 2020
Partage
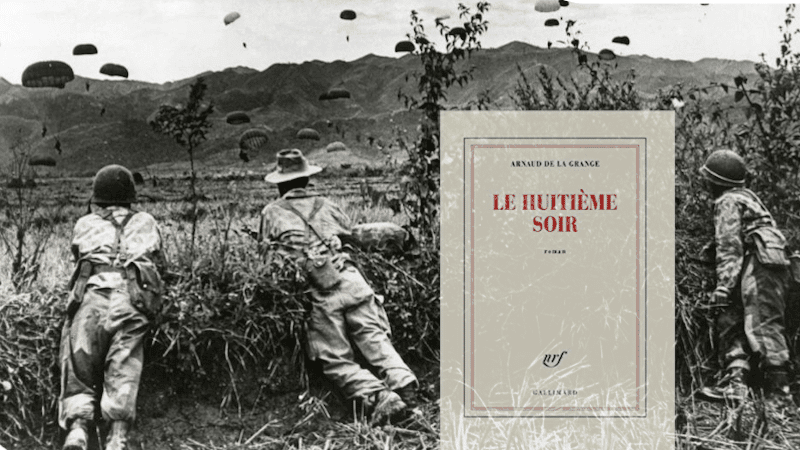
[vc_row css= ».vc_custom_1581678774980{margin-right: 25px !important;margin-left: 25px !important;} »][vc_column][vc_column_text]
Arnaud de la Grange est l’auteur du Huitième soir (Gallimard, 2019), qui suit un jeune lieutenant dans l’épreuve de Diên Biên Phu. Il nous accorde un entretien sur son roman de guerre, lauréat du prix Roger Nimier 2019.
Diên Biên Phu a été beaucoup moins représenté que d’autres batailles françaises : cette bataille nous fait-elle peur ?
La guerre d’Indochine, bien qu’elle fasse rêver, est de manière générale assez peu connue. Elle a peu passionné les Français de l’époque, sauf au moment de la bataille de Diên Biên Phu, événement historique très important qui signe le début de la fin de la guerre d’Indochine, et d’une certaine manière le début de la fin de l’empire français. Dien Bien Phu est aussi devenu un nom commun : on en parle comme on parle d’un « Stalingrad », d’un « Trafalgar » ou d’une « Bérézina ». Il y a une dramaturgie extrêmement forte de cette bataille, puisqu’elle est ramassée en une unité de lieu et de temps : cinquante jours dans un cadre très restreint où ont eu lieu des sacrifices humains absolument insensés des deux côtés.
Il y a une dramaturgie extrêmement forte de cette bataille, puisqu’elle est ramassée en une unité de lieu et de temps.
On pense à ces soldats français qui se sont portés volontaires quasiment jusqu’à la fin pour sauter en parachute alors qu’ils savaient qu’ils n’inverseraient pas le cours des choses. Ils ne le faisaient d’ailleurs pas forcément pour le drapeau ou pour l’empire – même si ces valeurs-là existaient chez certains – mais surtout pour leurs camarades. Cette fraternité dans la guerre, sans la magnifier, confère une dimension littéraire intéressante à l’événement.
Vous parlez de cinquante jours de bataille, mais vous décidez d’en tirer huit soirs et autant de chapitres. On dirait presque la Genèse à l’envers. Comment vivre lorsque l’on sait qu’il ne nous reste plus que quelques instants ?
Mon personnage est en effet un lieutenant de vingt-six ans qui s’est porté volontaire et qui saute à la fin de la bataille. On ne sait pas exactement si ce sont les huit derniers jours, même si l’on est vers la fin de la bataille. Lors du huitième soir, on ne sait pas non plus ce que le personnage va devenir, même si l’on pressent évidemment que les choses peuvent être assez sombres. Ce qui m’intéressait c’était ce resserrement. Je ne sais même plus d’où m’est venue l’idée des huit jours. Beaucoup de choses me sont venues toutes seules, ça n’a pas été un « truc » littéraire. Le resserrement du temps était particulièrement intéressant : la guerre dépouille, élague et resserre les choses et les êtres. Et plus on les sent « se resserrer », plus on a tendance à les vivre intensément. Il y a beaucoup d’allers-retours entre la bataille, qui met l’homme à nu, en décape l’âme, et des flashbacks sur sa vie. Ça parle de résilience après un accident, de la manière de se reconstruire, du rapport au corps, du rapport d’un fils à une mère qui se meurt, des leçons qu’il en tire, etc.
Lire aussi : Qu’un sang impur
Il y a aussi un resserrement de l’espace : les soldats sont coincés dans la fameuse « cuvette ». Vous arrivez à donner un sentiment de claustrophobie au lecteur.
J’ai toujours été fasciné par les mondes clos, où l’esprit n’a pas d’échappatoire, et est donc obligé de revenir sur les questions essentielles. L’esprit ne peut pas vagabonder en toute liberté. C’est également le principe de la tragédie grecque. Ce resserrement est presque comme une poigne qui se referme sur l’âme et le cœur. Il y a une correspondance entre le lieu, le temps, et la psychologie de mon personnage. Les mondes clos, fermés, peuvent être assez angoissants, mais également très intéressants.
Aller au bout des choses et ne pas lâcher, ne pas s’incliner devant le sort, ni devant le mépris des politiques.
C’est aussi pour cela que j’aime un auteur comme Jean-Paul Kaufmann, qui depuis son expérience d’enfermement en tant que prisonnier a souvent exploré des mondes un peu clos, que ce soit à Sainte-Hélène ou aux Kerguelen. Comme l’on ne peut pas s’évader sur les côtés, on descend en profondeur.
On pourrait également penser à Ernest Hemingway et L’appel aux armes avec ce style assez « staccato », avec peu de virgules et beaucoup de points, qui donne une dimension pesante et angoissante à votre récit. On y vit dans un monde plutôt désenchanté, où beaucoup ne se battent pas pour le drapeau.
Pour l’honneur ! Ce n’est pas forcément l’honneur du drapeau, même si je ne dis pas du tout que les gens ne croyaient pas à la France, là n’est pas le problème. Mais ce n’était plus tellement le sujet : beaucoup avaient été tellement déçus, tellement lâchés et par les politiques et par le haut-commandement que l’honneur c’était agir en rapport à l’idée qu’ils avaient d’eux-mêmes. Aller au bout des choses et ne pas lâcher, ne pas s’incliner devant le sort, ni devant le mépris des politiques.
Qu’est-ce qu’un héros ?
En littérature, le héros est le personnage principal mais aussi celui qui accomplit des actes héroïques. Dans mon livre, il y a ce jeune officier qui est présent à Diên Biên Phu, mais n’est pas un héros sans peur et un moine soldat qui n’aurait aucun état d’âme, au contraire. Le personnage doit avoir des failles, des faiblesses et révéler l’ambiguïté humaine. Ce personnage, jeune lieutenant, est quelqu’un qui a ses faiblesses et qui fuit et qui, en même temps, possède un certain nombre de valeurs comme le sens de l’honneur et de l’engagement.
Sont-ce les grandes circonstances qui font les héros ou cet état est-il inscrit dans ses gènes ? Un peu des deux. Claudel disait : « Un héros est quelqu’un qui ne pouvait pas faire autrement ». Il y a certainement un peu de ça.
Lire aussi : Guillaume Zeler, l’Indochine sous la terreur japonaise
Qu’en penser quand treize Français meurent au Mali ou quand le colonel Beltrame se sacrifie ?
On remarque qu’en France, par effet miroir, il y a un engouement incroyable pour ce type d’opération. C’est presque excessif car ces militaires eux-mêmes ne se pensent pas comme des héros. Dans une société où règne l’auto-détestation, où l’on dégrade facilement les valeurs, où c’est le bonheur à tout prix et le culte de l’individualisme qui prédominent, voir des gens qui se donnent entièrement nous fascine.
Dans une société où le bonheur à tout prix et le culte de l’individualisme prédominent, voir des gens qui se donnent entièrement nous fascine.
On découvre des âmes qui ne sont pas idéalistes mais qui vont au bout : les soldats d’élite vont au bout de leur mission, sans dimension sacrificielle. Ils aiment la vie et leurs proches et se dévouent aux autres par amour que ce soit au Mali ou lors d’opération d’otage. Ces gens font des actes en toute discrétion, sans vouloir être sous le feu des projecteurs. Le livre ne parle pas de guerre uniquement. C’est un livre qui met aussi l’homme à nu.
Est-ce que la dernière phrase : « C’est notre tour maintenant » incite à imiter ?
Il ne faut pas vraiment y voir une adresse au lecteur. Cette dernière phrase montre surtout le désarroi du personnage qui depuis des jours voit les positions tomber et la mort des gens autour de lui. Il se dit que son heure est sans doute proche.
Propos recueillis par Pierre Valentin
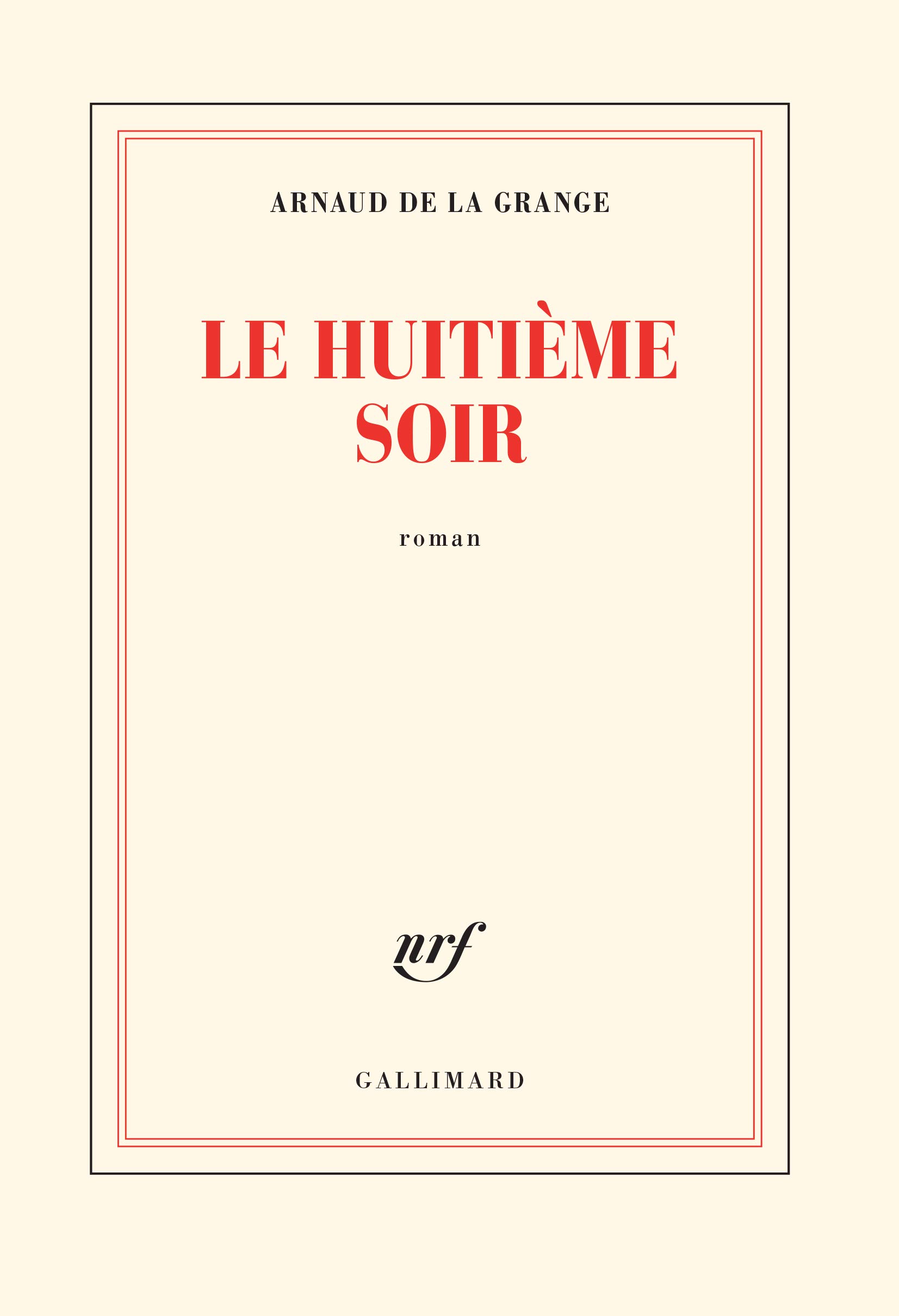
Le huitième soir
Arnaud de la Grange
Editions Gallimard
160 pages, 15 €
[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]
EN KIOSQUE
Découvrez le numéro du mois - 6,90€
Soutenez l’incorrect
faites un don et défiscalisez !
En passant par notre partenaire
Credofunding, vous pouvez obtenir une
réduction d’impôts de 66% du montant de
votre don.
Retrouvez l’incorrect sur les réseaux sociaux
Les autres articles recommandés pour vous
Restez informé, inscrivez-vous à notre Newsletter