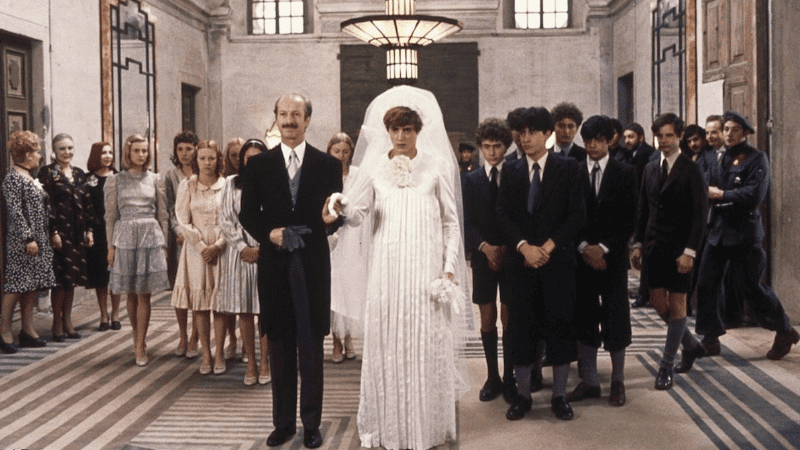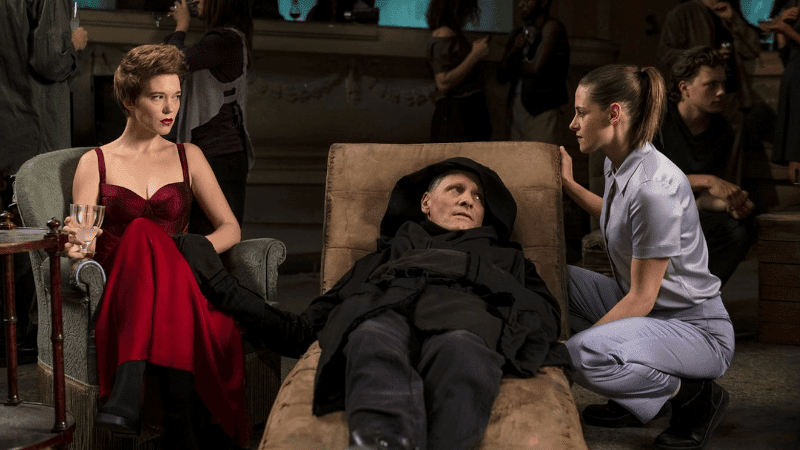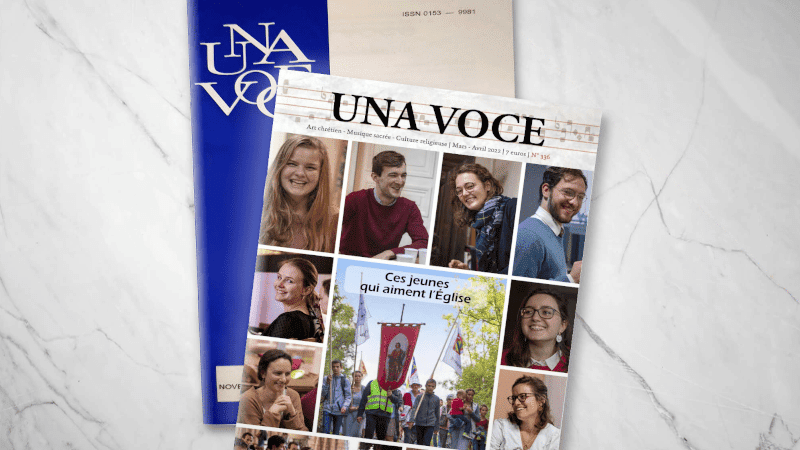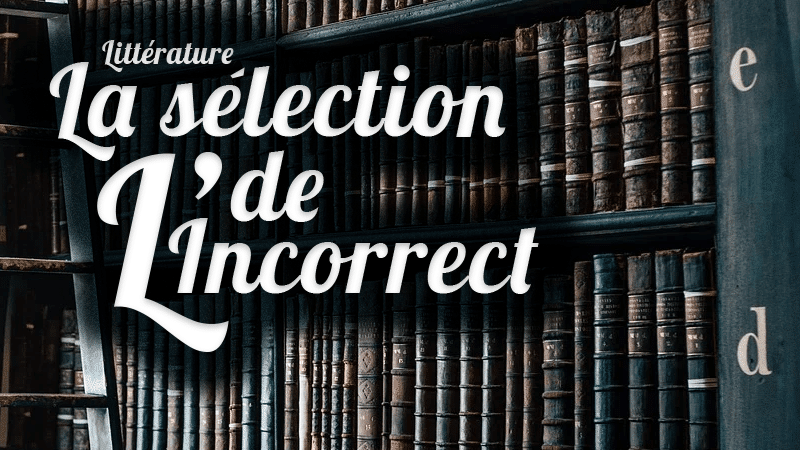
Yes we Kant
S’appuyant sur la Critique de la raison pure de Kant, qui sert d’armature au livre, Adam Roberts signe un roman de science-fiction fascinant, entre expérimentation, comédie noire, thriller et métaphysique soft. Partant du principe que la perception du réel est en partie façonnée par la conscience et que ce même réel a peu de chance de coïncider avec cette perception limitée par des paradigmes tels que temps et espace, l’auteur britannique a imaginé une quête hors du filtre protecteur des sens en direction de la dite Chose en soi. Partagé en douze sections calquées sur les catégories kantiennes, le roman s’articule autour d’un antihéros flamboyant de malchance – ou quand The Thing de Carpenter rencontre Kant sur fond de Paradoxe de Fermi et d’IA.
En 1986, deux scientifiques isolés en Antarctique participent au programme de recherche de signaux extraterrestres. Si Charles est un brave type terre-à-terre, Roy est un être obscur possédé par les écrits du philosophe allemand et habité par une mission trouble. Un pacte absurde initié par Charles va rendre la cohabitation de plus en plus délétère, menant à une issue aussi dramatique que vertigineuse. En 2017, Charles est un homme ravagé, marqué dans ses chairs et hanté par des visions terribles. L’astrophysicien devenu éboueur est alors réquisitionné par un étrange institut au sujet de l’incident ayant eu lieu 30 ans plus tôt sur la base polaire – début d’une course furieuse au-delà de la connaissance sensible. À grands traits, quelles seraient nos perceptions des phénomènes et des choses si les catégories kantiennes qui les sous-tendent étaient modifiées ? [...]