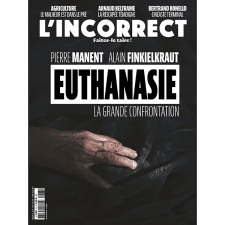Comment êtes-vous arrivé sur le projet Vaincre ou Mourir ?
Il m’a été proposé par les réalisateurs Paul Mignot et Vincent Mottez il y a un an et demi. Paul Mignot a vu Le Dernier Voyage, film de science-fiction dans lequel je jouais un astronaute fugitif, film qui l’avait interpellé parce qu’il sortait des sentiers battus dans le paysage de l’audiovisuel français. Cette fois, il s’agit d’un film historique et épique. Je suis très reconnaissant de la chance que j’ai de pouvoir jouer dans des univers aussi différents. Si j’étais assez hésitant au départ, l’ambition, l’engagement et la passion des réalisateurs m’ont très rapidement convaincu. L’exigence des équipes du Puy du Fou m’a aussi emporté. C’est un projet avec lequel il faut être humble : il a été réalisé avec seulement 3,5 millions d’euros et tourné en une petite vingtaine de jours. Ce film est un vrai tour de force, et on est extrêmement fiers du succès exceptionnel qui a eu lieu le 8 décembre pour les avant-premières, avec près de 25000 entrées dans la soirée. Ce film a une âme, il transpire le travail et la passion pour le cinéma.
C’est un projet avec lequel il faut être humble : il a été réalisé avec seulement 3,5 millions d’euros et tourné en une petite vingtaine de jours.
Connaissiez-vous le personnage de Charette avant ce projet ? Qu’est-ce qui vous a touché chez lui ? Comment avez-vous réussi à l’apprivoiser pour le jouer ?
Comme beaucoup de monde, je ne connaissais pas le personnage. C’est une partie de l’histoire de France assez méconnue mais qui m’a profondément touché. C’est un film-hommage aux victimes des guerres de Vendée, et je retiens des projections la profonde émotion qu’il a suscitée chez les spectateurs : ils avaient besoin que l’on reconnaisse leur histoire et par là leur existence. Je sous-estimais à quel point c’était important pour beaucoup de gens. C’est donc à la fois un honneur et une responsabilité de jouer un tel personnage. D’une certaine manière, ce film permet de réconcilier et de faire la paix. Le film en lui-même n’est pas manichéen. L’intérêt d’un film historique, c’est de découvrir quelque chose que l’on connaît mal. À chacun ensuite de se faire un avis. Ce qui m’intéresse, et c’était déjà le cas avec La Nuit juste avant les forêts ou avec Le Dernier Voyage, c’est quand un film dénote. Et cette histoire fait écho à énormément de choses. Comme de nombreux personnages historiques et beaucoup d’êtres humains à travers l’histoire, Charette se bat pour la liberté d’un peuple. Les paysans viennent le chercher parce qu’ils ont besoin d’un chef de guerre, et il s’engage presque à contrecœur. Animé par l’honneur et la force de conviction, il se donne corps et âme à un combat qui le dépasse, et il ira jusqu’au bout. Mais le film ne fait pas de cadeau au personnage de Charette : il n’échappe pas à la complexité et au traumatisme qu’engendrent les combats. Ce fait historique est intéressant parce qu’on peut y identifier de nombreux combats pour la liberté. Chez Charette, il y a un petit côté Astérix ou Braveheart. Un peuple dont on bouscule les us et coutumes décide de ne pas se laisser faire. Ce sont des gens qui ont des cœurs immenses et qui sont prêts à se sacrifier pour les autres. Le personnage incarne les valeurs de combativité, d’espoir, de dépassement de soi, et je pense qu’on en a terriblement besoin. Quand j’étais adolescent, les films qui me plaisaient le plus étaient ceux dans lesquels un héros me disait « relève-toi ».

Dans l’ère du capitalisme tardif, les divertissements filmiques se doivent d’avancer avec des narratifs suffisamment huilés pour absorber tout écueil ; ceux-ci peuvent même devenir partie intégrante du dispositif. Les récentes polémiques qui ont entaché la sortie de Tirailleurs de Mathieu Vadepied (propos soi-disant litigieux d’Omar Sy, figurants sans-papier soumis à une OQTF) montent une chantilly sur l’odeur supposée de scandale, créant ainsi un désir soudain pour ce qui fleure bon la fiction réparatrice plan-plan.
Et c’est bien le meilleur qui pouvait arriver à ce film totalement insignifiant, dont les appels au boycott anticipent le fait qu’il s’avorte sur la durée, se boycottant lui-même par une justice curieusement poétique. Après une voix-off venue d’entre les morts sur fond de déterrage, le récit remonte son cours jusqu’à ses prémisses, l’enrôlement forcé pendant la Première Guerre mondiale d’un jeune éleveur sénégalais Thierno (Alassane Diong) avec son père Bakary (Omar Sy) qui décide de l’accompagner incognito jusqu’en France pour tenter de le protéger. Il faut profiter de cette exposition, car c’est le seul moment ressenti du film, avec un rendu rapide mais suggestif de la vie d’un petit village africain et un sens à peu près opérant du paysage.
Lire aussi : Tops et flops des films français sur le patrimoine littéraire et historique national
Transplantés sur le théâtre des opérations, nos deux tirailleurs quittent la brousse pour le désert de la fiction française et son formatage à l’heure des toutes-puissantes séries. On devine bien que la production ne peut s’enorgueillir de la puissance de feu qu’a convoquée Sam Mendes pour son 1917 boosté au tout-numérique, mais l’intimité partout vantée se confond avec l’appauvrissement des décors à quatre ou cinq : le no man’s land, la tranchée (singulier ici de rigueur), l’auberge « démocratique » (cf le dialogue), la ferme. Ajoutons un vague chemin, boueux ou pas, et on est bon. Est-ce le choix de filmer en mégotant sur les plans larges, mais on ne sent jamais vraiment le déracinement des soldats africains. D’autant qu’ils sont très vite happés par un scénario qui court après les rebondissements, à la façon d’une série, avec méchants racketteurs (noirs, précisons-le) et capitaine à névrose intégrée (forcément blanc). Pour maintenir l’attention, les personnages sont livrés avec leur problématique clefs en main qu’ils énoncent pratiquement face caméra (l’officier que sa ganache de papa général préférerait mort avec une jolie décoration). [...]
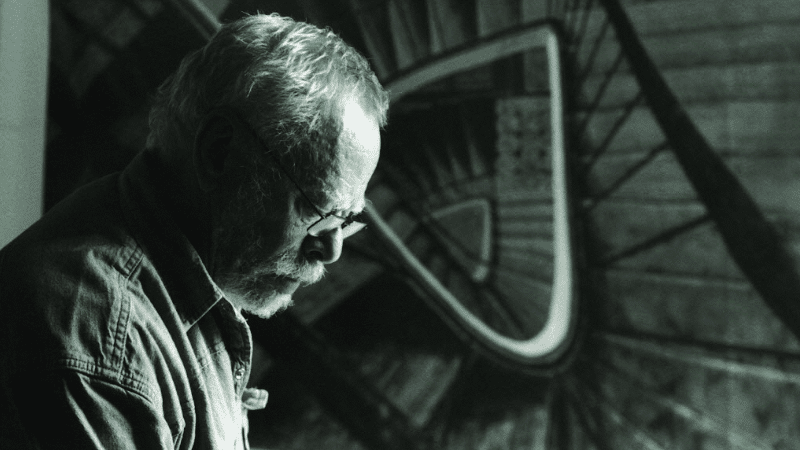
Vous souhaitez lire la suite ?
Débloquez tous les articles de l’Incorrect immédiatement !

TOPS
Napoléon (1927) d’Abel Gance
C’est découvrant Naissance d’une nation de D. W. Griffith au début des années 1920 qu’Abel Gance décide de se lancer à la conquête de Napoléon. Son ambition est démesurée à l’image des grands hommes qu’il admire : le réalisateur français n’imagine pas un film mais six, allant de cette fameuse bataille de boules de neige à Brienne-le-Château jusqu’à la captivité à Saint Hélène. Gance tourne le premier épisode qui retrace la vie de l’empereur de 1781 jusqu’au début de sa campagne d’Italie en 1796. Son film dure sept heures. Le succès est international mais ses financiers abandonnent, le budget prévu pour l’ensemble a déjà été englouti. Gance remontera sans cesse son film jusqu’en 1971, qui sera tronçonné à de multiples reprises par les distributeurs. La seule version véritablement visible aujourd’hui reste la première, reconstituée en 1981 par Francis Ford Coppola, d’une durée de 230 minutes. L’occasion de redécouvrir le génie fou de Gance, avant-gardiste de la technique, qui délaissa le vieux trépied pour des caméras embarquées, même sous-marines, prêt à tout, jusqu’à inventer le split-screen en filmant son majestueux finale de trente minutes de trois points de vue différents (à l’époque diffusé sur trois écrans). Un monument.
llusions perdues (2021) de Xavier Giannoli
Sans doute la meilleure adaptation de Balzac de l’histoire. Le réalisme, le rythme, le propos, le tragique de l’existence, tout y est. On s’en émerveillera encore dans cinquante ans.
L’Armée des ombres (1969) de Jean-Pierre Melville
Melville, Ventura, Signoret, on pourrait s’arrêter là. Un film qui possède une qualité inestimable, la nuance, capable de montrer toute l’obscurité des résistants et de leur destin. Leur héroïsme n’en est que plus étincelant. [...]
Vous souhaitez lire la suite ?
Débloquez tous les articles de l’Incorrect immédiatement !

Comme chacun sait, le cinéma français a des problèmes. Le moindre d’entre eux n’est pas sa stérilité presque totale en termes de films héroïques, qui mettent en scène les grandes figures de l’histoire ou de la littérature française. Comment expliquer l’écart abyssal entre la richesse de notre histoire et la maigreur de la production cinématographique nationale à son sujet ? Notre pays n’est-il plus capable de s’emparer de sa mythologie par son art ?
Il faut commencer par circonscrire le problème. Jusqu’à la fin des années 1970, le cinéma français ose parler de son histoire, du mythique Napoléon d’Abel Gance (1927) à la 317e section de Schoendoerffer (1965) sur la guerre d’Indochine, en passant par Nuit et Brouillard en 1956. Un premier tournant arrive avec l’arrivée au pouvoir de François Mitterrand selon Abdel Raouf Dafri, scénariste et réalisateur, ayant notamment écrit la trame d’Un prophète et de la série Braquo. « Ce n’est pas simplement une question de politique, il s’agit aussi d’une nouvelle mentalité qui s’impose. Maintenant, le héros blanc, le mec qui s’affirme, c’est mort, on va le mettre de côté ». Exeunt donc les figures masculines charismatiques qui jouaient facilement de la gâchette, les Delon, Gabin et Ventura. « Il y a eu une tentative, réussie, de ringardiser ces acteurs-là. Ils n’ont plus trouvé leur place ».
« Ce n’est pas simplement une question de politique, il s’agit aussi d’une nouvelle mentalité qui s’impose. Maintenant, le héros blanc, le mec qui s’affirme, c’est mort, on va le mettre de côté »
Abdel Raouf Dafri
Le résultat ? « On entre dans une forme de neurasthénie, de cinéma Doliprane, où on passe son temps à palabrer sans jamais prendre de décision. À la fin du premier mandat de Mitterrand, le cinéma français c’est de la merde », conclut un Dafri sans pitié. Seulement, le cinéma français n’est pas le seul à avoir connu des périodes de flottement, de manque de confiance. Après tout, dans la décennie précédente, un Hollywood traumatisé par la guerre du Vietnam et usé par l’héroïsme façon John Wayne « fabrique à la pelle des blancs dépressifs » Le cas français doit donc être relativisé. Nous ne sommes pas maudits. Ce qui est étonnant, c’est que nous ne soyons jamais sortis de la morosité des années 80, là où précisément l’ère Reagan marque le retour en force du héros patriote et viril outre-Atlantique, avec les excès que l’on sait – une pensée à Ivan Drago.
Lire aussi : Éditorial d’Arthur de Watrigant : Une année virile
Le problème pour la France est qu’à force de ne pas parler de son histoire, les autres, c’est- à-dire les Anglo-saxons, le font à sa place, avec leurs biais évidents. « Ridley Scott a été plus que limite avec nos Templiers dans son Kingdom of Heaven », donne en exemple Franck Mancuso, scénariste et réalisateur de films policiers. Quitte parfois à retourner complètement l’histoire, ajoute Dimitri Casali, essayiste spécialisé dans la vulgarisation historique et auteur d’une Histoire de France racontée par le cinéma il y a une dizaine d’années. Il cite Master and the Commander, le film de 2003 avec Russel Crowe, qui narre le duel aux quatre coins du Pacifique entre un navire de la Royal Navy et de la Royale lors des guerres napoléoniennes, et où les Français ont évidemment le vilain rôle. Ce film est tiré d’un roman lui-même tiré d’une histoire vraie « où il s’est passé exactement le contraire que dans le film, où les Français l’ont emporté ! » s’étrangle Casali. Les pertes en matière de softpower sont inqualifiables, alors que « les Américains, les Chinois et les Russes investissent un argent fou dans ce domaine, fondé sur le cinéma avant tout », regrette-t-il. En plus de ces problématiques de compétition internationale, cette timidité face à notre histoire est un drame sur le plan intérieur puisqu’un pays qui ne met en plus en scène ses mythes perd le fil de sa propre histoire. Et c’est précisément dans le rapport brisé à l’histoire de notre population en général et du milieu du cinéma en particulier qu’il faut chercher la première explication à notre carence héroïque à l’écran. [...]

Chères lectrices, chers lecteurs, je vous présente mes meilleurs vœux pour cette année 2023. Après les incendies, les attentats, les pandémies, les guerres, la fonte des glaces et les livres de Virginie Despentes, il est temps de jeter un peu de sauternes sur la flamme de l’espérance. Au fond, tout cela peut faire de très bons sujets pour les romans à venir (hormis les succès de Virginie Despentes). Joseph de Maistre aurait adoré, qui considérait que les périodes historiquement cruelles et artistiquement valables se superposaient au point de déclarer : « En un mot, on dirait que le sang est l’engrais de cette plante qu’on appelle génie ».
Quand le monde a l’air calme et la vie matérielle satisfaisante, on s’illusionne beaucoup sur la solidité des choses et l’âme a tendance à pourrir.
Au XXè siècle, cette affirmation pas franchement sociale-démocrate s’est vérifiée, si l’on considère la génération traumatisée mais grandiose qui émergea depuis les gaz et les schrapnells de la Grande Guerre, son audace, son style, ses mille répliques explosives à la destruction qui ne l’avait pas éteinte.…

Vous souhaitez lire la suite ?
Débloquez tous les articles de l’Incorrect immédiatement !
L’Incorrect numéro 73
Retrouvez le magazine de ce mois ci en format
numérique ou papier selon votre préférence.