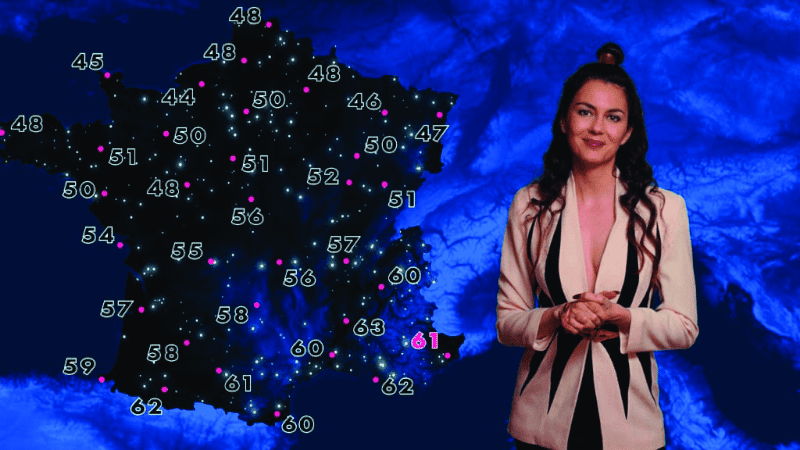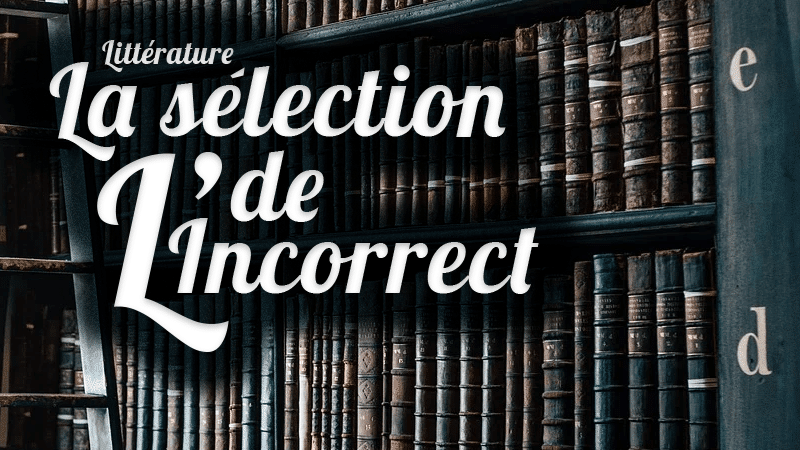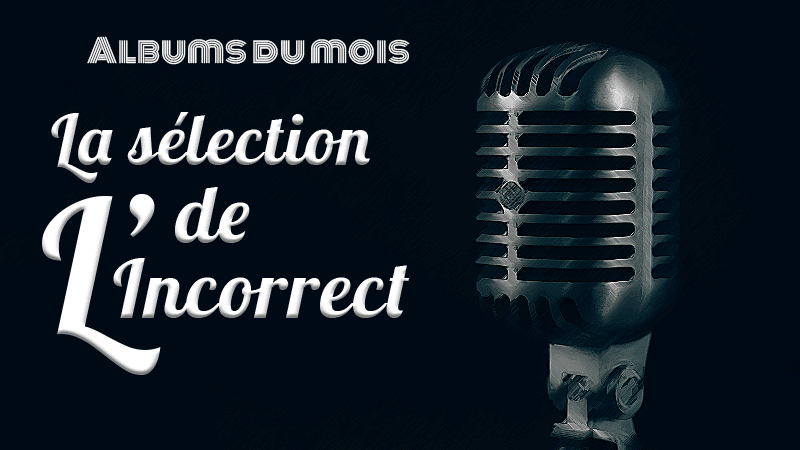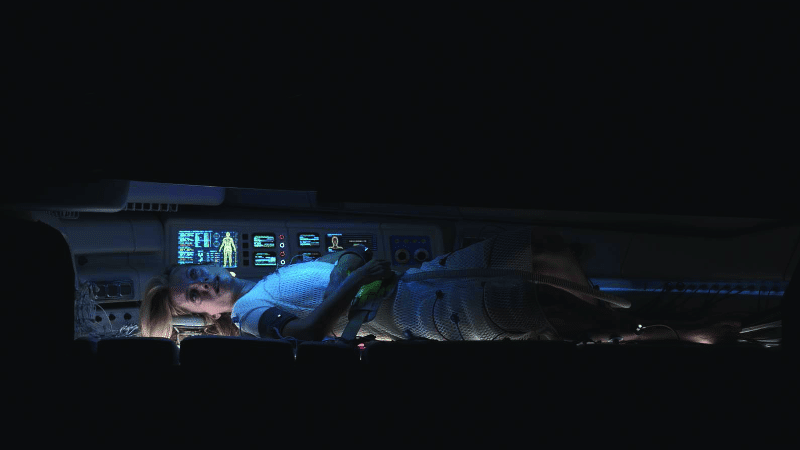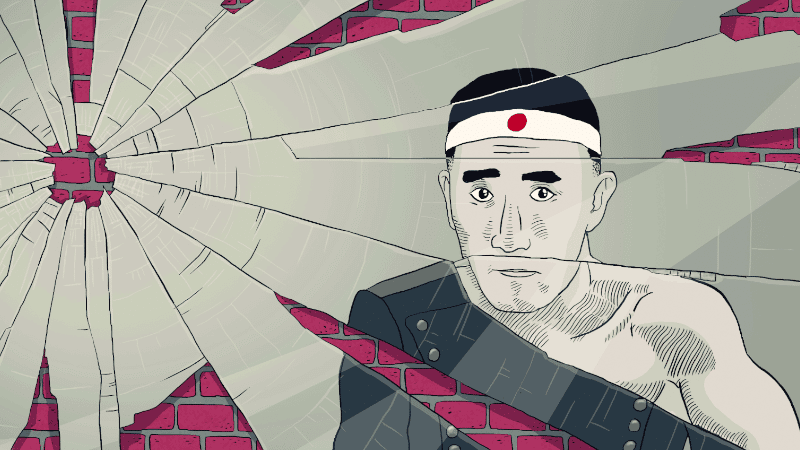“Oui, chère madame, je viens de le recevoir, c’est un très beau travail et je vous en remercie infiniment !” Tenant d’une main son portable, et de l’autre, avec le plus grand soin, un livre ancien admirablement relié, E. raccrocha après avoir salué à nouveau sa correspondante, le visage illuminé par un sourire.
– Je ne sais pas si je t’ai raconté que cet exemplaire rarissime des Essais de Montaigne avait été retrouvé couvert de boue et d’ordures dans une poubelle du square Montholon? J’avais au bout du fil la relieuse qui est parvenue à le restaurer.
– Tout de même, E., « je vous remercie infiniment », tu ne trouves pas que c’est légèrement exagéré, tout de même ? On dirait l’agent spécial Cooper dans la première saison de Twin Peaks affirmant d’une tarte aux cerises qu’elle est absolument miraculeuse, objecta Lucien de S. en se resservant pour la troisième fois un verre de punch coco vigoureusement alcoolisé. Infiniment ! Infiniment ! Et puis quoi encore ?
Lire aussi : Du droit à la bise par Frédéric Rouvillois
Chantal, qui observait son mari du coin de l’œil, chipa en douce une poignée de cacahouètes pour assister à l’échange. – Pour tout te dire, mon cher Lucien, j’ai été il y a peu sur le point de renoncer à la formule, en constatant sur Internet qu’elle était de plus en plus fréquemment utilisée. Bref, j’ai eu peur d’être victime de ces stéréotypes langagiers qui s’insinuent sans prévenir dans nos neurones, nos réflexes et nos façons de parler, et qui finissent par nous faire dire «au niveau de», «enchanté», «excessivement» ou « bonne continuation », comme de vilains bruits qu’on laisse échapper sans le vouloir.
– À propos de « excessivement », j’ai relu l’autre jour ce qu’en dit Renaud Camus dans le livre que tu m’as prêté...
– Ah oui! Dans son succulent Répertoire des délicatesses du français contemporain ! Je me souviens d’une exécution en règle, mais fondée sur l’idée qu’on emploie l’adverbe « excessivement » à tort, ou plutôt, à l’envers, de même que les enfants lorsqu’ils déclarent qu’ils sont « trop contents » d’aller en vacances, que les éditoriaux de L’Incorrect sont « trop stylés » ou que Mbappé a été « trop fort » lors du dernier match du PSG... Parce que l’on confond alors l’abus et la perfection. Tandis que « remercier infiniment » me semble avoir à la fois une utilité et une signification. [...]