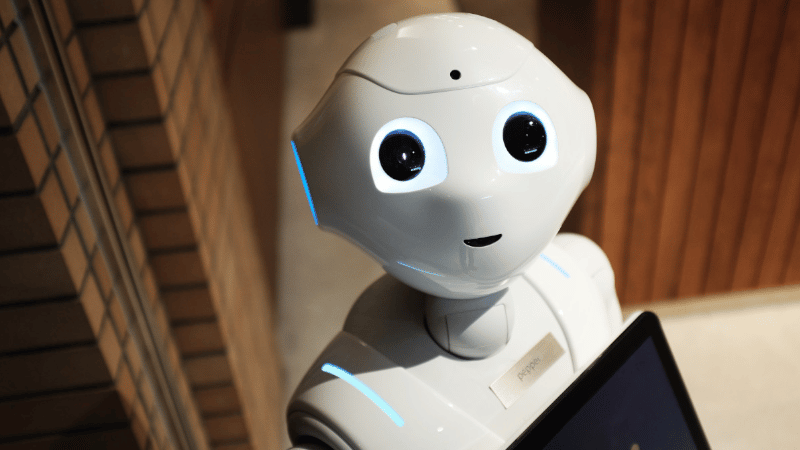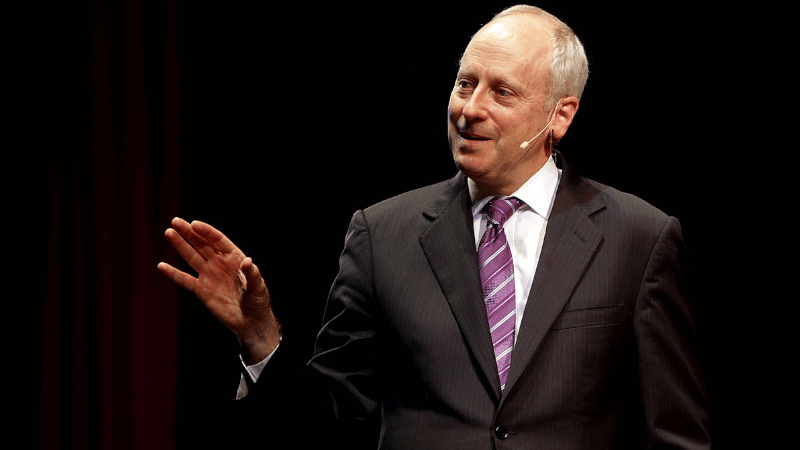Quelles sont les principes fondamentaux du corporatisme en tant que régime économique et social ?
Il faut tout d’abord distinguer corporations et corporatisme. D’un mot, les corporations sont les institutions qui encadraient la vie économique durant le Moyen Âge. Elles étaient des communautés de métiers, imposant un certain nombre de restrictions à la libre concurrence, au nom d’un bien commun supérieur. Mais, et c’est également essentiel, les corporations étaient aussi des communautés de vie, organisant la formation et l’entraide au sein des métiers, célébrant des saints par des fêtes et des processions, encadrant les obsèques de leurs membres, etc. En un sens, le système corporatif subordonnait toujours la quête du profit à des fins jugées plus hautes : la qualité du travail bien fait, l’équilibre des structures sociales, etc. À partir du XIXe siècle, alors que les corporations ont disparu, diverses pensées corporatistes envisagent de les faire revivre : là où, avec la révolution industrielle, le profit semble être devenu une fin en soi, le corporatisme vise à lui redonner à l’activité économique un sens supérieur.
Pour quelles raisons internes et externes le régime corporatif, fondement de la société médiévale, a-t-il été mis en échec avec l’avènement de la modernité ?
Il y a deux raisons fondamentales à l’abandon du système corporatif. Tout d’abord, la montée d’une philosophie individualiste, avec les Lumières au XVIIIe siècle, et la Révolution de 1789 comme point culminant. En effet, les corporations ne se justifient que si l’on considère que l’homme est naturellement membre de communautés, ce qui était la vision médiévale. Dès lors que l’on affirme qu’il n’existe que des individus, que seule vaut la liberté individuelle, alors les corporations n’apparaissent plus que comme des contraintes injustifiées à cette liberté.
Au lieu de voir des antagonismes dans la société, le corporatisme voit des complémentarités. Les hommes peuvent être différents, mais ce qui importe et qu’ils soient à leur place
Ensuite, il y a la révolution industrielle, avec la montée de la grande entreprise. Celle-ci est un facteur de déracinement considérable : les millions de travailleurs qui migrent des campagnes vers les villes industrielles se coupent de leurs communautés naturelles ; ils sont davantage portés à ne voir le monde que sous le prisme de leurs seuls intérêts propres. Ajoutons enfin un troisième facteur, plus contingent : si le système corporatif avait fonctionné de manière satisfaisante pendant des siècles, il avait néanmoins été peu à peu dénaturé par des interventions royales parfois trop interventionnistes. À la veille de la Révolution, les corporations étaient devenues beaucoup plus rigides qu’elles ne l’avaient été durant le Moyen Âge. [...]
La suite est réservée aux abonnés. Déjà abonné ?
Se connecter