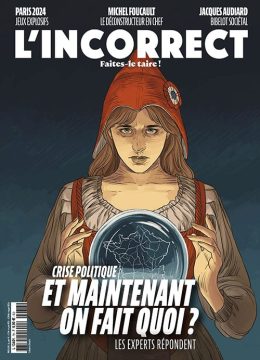Immortel David Bowie : la grande rétro
Par
Publié le
25 janvier 2019
Partage

[vc_row][vc_column][vc_column_text css=”.vc_custom_1548424386490{margin-right: 25px !important;margin-left: 25px !important;}”]David Bowie semblait immortel. Éternellement jeune, éternellement élégant, éternellement créatif. Il s’en est pourtant allé il y a tout juste trois ans un 10 janvier 2016, laissant derrière lui une œuvre colossale. Son parcours personnel se confond avec les cinquante dernières années de l’histoire occidentale.
Mieux que quiconque, David Bowie comprit la transformation du domaine culturel en une industrie de divertissement de masse. Plutôt que de subir la société du spectacle, il sut la confronter, l’utiliser et la défier. Son approche était totalitaire, totalisante, comme pour mieux interroger l’entreprise d’hébétude de la culture de masse.
Bien plus qu’un simple chanteur pop, David Bowie était et restera un artiste iconique de son époque. Un artiste qu’il serait difficile de réduire à la seule musique rock anglaise d’exportation mondiale depuis les années 1960 jusqu’à nos jours. David Bowie explose le cadre dans lequel il est apparu. Homme influencé par les artistes de son temps (citons Lou Reed, Iggy Pop, Peter Hammill du groupe Van Der Graaf Generator, King Crimson ou bien encore la musique noire américaine de ces années là), David Bowie fut aussi une influence pour de nombreux mouvements de la fin des années 1970.
Lire aussi : [EDITORIAL DE ROMARIC SANGARS] Les soleils du déclin
À commencer par les mouvements punk et post-punk. Des groupes comme The Cure, Siouxsie And The Banshees, Joy Division ou Japan en sont les preuves manifestes. Né le 8 janvier 1947 (son dernier album Blackstar est sorti le 8 janvier 2016) à Londres, David Bowie commençait timidement sa carrière discographique en 1967 avec l’album intitulé David Bowie. Premier essai à mi-chemin entre le néo-folk des années 60 et la variété, cet album ne permet pas à son auteur de sortir d’un relatif anonymat malgré certaines qualités évidentes.
Il faudra attendre deux ans pour que David Bowie ne devienne véritablement célèbre et ne cesse plus jamais de l’être. C’est avec l’album Space Oddity que David Bowie prit son envol. La chanson titre devint un tube planétaire surfant sur les interrogations spatiales de l’année 1969. Sorte de bande son progressive du film 2001, l’Odyssée de l’Espace, le titre témoignait de l’espoir de conquérir l’espace que nourrissaient les occidentaux suite à l’alunissage réussi de la navette Apollo 11. À peine un an plus tard, le très inspiré David Bowie sortait un de ses plus grands grands chefs d’œuvre à ce jour avec l’album The Man Who Sold The World.
Contrastant avec ses débuts délicats, le Londonien donnait une interprétation personnelle d’un rock métallique en devenir avec le soutien du guitariste Mick Ronson et du producteur Tony Visconti, au moment même où le groupe de Birmingham Black Sabbath faisait paraître son premier album. Oeuvre au propos métaphysique, The Man Who Sold The World dévoilait une facette beaucoup plus sombre de l’artiste. Tourmenté par la schizophrénie de son frère adoré, l’Anglais entamait sa première transformation. Se rêvant surhomme au sens Nietzschéen, David Bowie se défiait mais parvenait alors à vaincre ses angoisses au terme de cette expérience cathartique.
En 1971, David Bowie publiait un autre disque de génie : Hunky Dory. Influencé par le cabaret, l’homme se faisait auteur de chansons dominées par le piano, en témoignent les deux succès Changes et bien entendu Life On Mars. David Bowie lui-même considérait Life On Mars comme sa plus belle chanson, il l’avait d’ailleurs choisie pour ouvrir sa compilation I Select au milieu de titres plus méconnus, déclarant qu’il ne pouvait pas ne pas l’inclure. Autre titre majeur, The Bewlay Brothers, destiné à l’origine au marché américain, et doté d’une construction sophistiquée qui n’était pas sans rappeler les essais de King Crimson (le guitariste Robert Fripp travaillerait longuement avec David Bowie par la suite).
David Bowie semblait alors au sommet et condamné à un oubli programmé à l’instar des autres célébrités éphémères de l’époque. C’était sans compter sur la plus grande force de cet artiste aux cent visages : sa capacité à se réinventer sans cesse. En 1971, David Bowie n’était pas encore le rockeur le plus populaire de Grande-Bretagne.
Un autre chanteur « glam » lui avait ravi cette couronne qui lui était pourtant destinée. Avec Electric Warrior, Marc Bolan le démiurge du groupe T. Rex (en plus de l’espace, les dinosaures étaient une autre marotte des années 1970… avec le refroidissement climatique, ce qui est assez amusant à noter) s’installait comme l’artiste en vogue chez les jeunes gens. Le très narcissique David Bowie ne pouvait pas laisser cet affront impuni. Convoquant à nouveau son complice Mick Ronson, l’Anglais enregistrait en 1972 son album le plus connu : Ziggy Stardust And The Spiders From Mars. Un disque furieux, très rock, très nerveux, joué à un tempo rapide. Un disque culte.
David Bowie ne faisait alors plus qu’un avec son personnage de scène. Très ambitieux, l’album Aladdin Sane repoussa les limites du rock « glam ». À cette occasion, David Bowie collaborait avec le pianiste funambule Mike Garson. La chanson Panic In Detroit rythmée par des percussions tribales rappelant certains morceaux des Rolling Stones pour Sticky Fingers, était aussi un hommage à l’ami Iggy Pop que David Bowie sortit du gouffre en produisant le disque proto-punk Raw Power (et plus tard le chef d’œuvre absolu The Idiot qui marqua profondément Ian Curtis de Joy Division).
Time était l’aboutissement du style cabaret de David Bowie, lequel amateur de Jacques Brel (il reprendrait Le Port d’Amsterdam en anglais pour une face B, depuis gravée sur la réédition de l’album de reprises Pin-Ups) se laissait aller à pousser sa voix dans ses derniers retranchements. La chanson Lady Grinning Soul, quintessence du Bowie deuxième période, clôturait magistralement ce nouveau sommet pop.
Lire aussi : Électro : RÉVOLUTION SONORE OU TYRANNIE DU DIVERTISSEMENT ?
Entre 1973 et 1976, David Bowie sortait quatre disques supplémentaires (hors les disques enregistrés en public que je ne commenterais pas ici mais qui le mériteraient tant certains furent majeurs) : Pin Ups un album de reprises plutôt anecdotiques à quelques exceptions près, Diamond Dogs, Young Americans et Station To Station (le disque favori de l’auteur de Science-Fiction, Maurice G. Dantec). Diamond Dogs, disque rock en apparence classique, annonçait pourtant une nouvelle orientation dans la carrière de David Bowie.
La chanson We Are The Dead faisait figure d’avant-goût au Bowie de demain, au Bowie producteur d’Iggy Pop. Diamond Dogs restait néanmoins un disque de transition parcouru de quelques éclairs de génie (Big Brother, Diamond Dogs, Rebel Rebel). Un disque par ailleurs remarquable pour sa pochette, splendide comme souvent.

David Bowie, caméléon, se muait en 1975 en crooner de « blue eyed soul » mâtinée de glam rock. Young Americans apparut comme un ovni dans la discographie du Thin White Duke. Il comportait de nombreuses bizarreries : première reprise des Beatles sur un disque original avec Across The Universe (Bowie avait déjà repris les Rolling Stones sur Aladinn Sane avec Let’s Spend The Night Together), première chanson créditant des compositeurs invités (le tube disco Fame, écrit conjointement avec John Lennon et Carlos Alomar futur guitariste officiel de Bowie).
L’artiste anglais excella dans le registre américain, comme le prouvent les compositions Fascination et Young Americans. La pochette assez kitsch n’est pas celle qui avait été imaginée au départ, car le Thin White Duke souhaitait confier sa réalisation au célèbre illustrateur Norman Rockwell, connu pour ses images d’une Amérique idyllique. Face au délai d’attente de six mois, l’homme toujours pressé qu’était David Bowie renonça.
Lire aussi : Bertrand Burgalat « La techno a suivi un chemin institutionnel en musique »
Un an plus tard, sortait le disque qui redéfinirait tout le parcours de David Bowie, l’immense Station To Station. Monolithe noir de la discographie de l’artiste anglais, l’album lui permit de renouer avec le continent européen. S’ouvrant par la chanson la plus longue de David Bowie, le diptyque éponyme Station To Station d’une durée de plus de dix minutes, Station To Station annonçait le désenchantement des années qui suivirent la période hippie et le retour du Thin White Duke plus lucide que jamais. Premier album officieux de la fameuse trilogie Berlinoise, Station To Station est un disque essentiel. Les titres funk se font plus poisseux, plus glauques. Stay préfigurait d’ailleurs les futurs albums de Talking Heads, A Certain Ratio, The Fall ou bien encore Gang Of Four.
1977, année d’une première transformation européenne. Le punk s’imposait alors en Angleterre, Kraftwerk devenait un phénomène mondial… La jeunesse anglaise et continentale redécouvrait les expressionnistes, vibrait pour Antonin Artaud, se piquait d’architecture Bauhaus. Finies les fleurs dans les cheveux, place au noir. En France, les Rennais de Marquis de Sade délivraient une interprétation très personnelle de ce genre bourgeonnant. Ils étaient de grands admirateurs de David Bowie.
Parmi les artistes apparus dans les années 1960, et aux exceptions notables de Peter Hammill et d’Iggy Pop, seul David Bowie fut en mesure de comprendre ce changement majeur. On parle à tort de trilogie Berlinoise, je crois qu’il faut compléter cette période par Station To Station qui en est l’introduction, et par Scary Monsters qui en est l’apothéose. Cinq disques pour redéfinir la musique populaire moderne.

D’abord Low. La pochette décrit à merveille l’atmosphère archéo-futuriste de l’album. Coiffé comme un Junker prussien rêvé par Philip K. Dick, l’artiste est photographié de profil vêtu d’un grand manteau noir. David Bowie se projetait sans complexe dans un futur incertain, chaotique, violent, décadent. Fasciné par la Mittel-Europa, il livrait une musique jamais entendue jusqu’alors : martiale, distante, froide, et paradoxalement dansante. L’album profite des talents de producteur de Brian Eno, ancien homme à tout faire du fabuleux groupe Roxy Music, au côté de cet autre dandy british qu’était (et que reste) Bryan Ferry. Low est un album difficile à appréhender lors d’une première écoute.
Largement inspiré par le courant Krautrock, il réussit pourtant à s’en détacher pour devenir une création tout à fait originale. Les plages les plus dynamiques succèdent à des morceaux instrumentaux, ou ambient. Sound And Vision, sorte de ballade biscornue dopée par les rythmiques électroniques et hantée par les nappes de synthétiseurs, est d’une modernité confondante. Warszawa est un hymne à une Europe fantasmée, un hymne novateur qui sera souvent copié pour les besoins de diverses bandes originales de films des années 1980. Be My Wife est un rock plus traditionnel traversé par des incursions électroniques incroyables.
Lire aussi : Barbarossa Umtrunk : Tradition futuriste
Ensuite Heroes, suite logique. Disque habité par la guitare de Carlos Alomar, l’album est surtout célèbre pour l’hymne majeur Heroes, poème narrant les déboires de deux amants se retrouvant à l’ombre du Mur de Berlin. Histoire d’un amour interdit traditionnel entre deux jeunes que tout réunit, et que la réalité oppose, Heroes est l’hymne de la fin des années 1970. Au-delà de ce sommet mondialement connu, des compositions très osées comme Black Out, Joe The Lion ou Beauty And The Beast. David Bowie et son partenaire Brian Eno prolongent leur exploration de la musique dite d’ambiance avec les quatre plages V-2 Schneider, Sense Of Doubt, Moss Garden et Neukoln. Encore un quasi sans faute.
Avant la sortie de Lodger, David Bowie sortait un grand disque en public sobrement intitulé Stage. Témoignage d’une époque depuis révolue, Stage était un instantané d’une époque où le désespoir festif du disco côtoyait le désespoir actif du punk. La fin des nations européennes n’était pas pour Bowie un concept mais une réalité vécue. Lodger va encore plus loin que ses prédécesseurs, David Bowie était post-punk depuis 1976, avant même que le punk n’ait officiellement existé.
Il expérimenta et amena le rock vers l’ « art rock » dans cet album à mi-chemin entre le Zappa de Zoot Allures et les délires ethniques de Talking Heads (African Night Flight). Comme toujours un tube, ici c’est Boys Keep Swinging dont les paroles renvoient à la chanson All The Young Dudes, composée par David Bowie et interprétée par les proto-lads de Mott The Hopple.
Témoignage d’une époque depuis révolue, Stage était un instantané d’une époque où le désespoir festif du disco côtoyait le désespoir actif du punk. La fin des nations européennes n’était pas pour Bowie un concept mais une réalité vécue.
Sorti en 1980, Scary Monsters fut l’apothéose de la période durant laquelle David Bowie inventa la New Wave du rock britannique. Cet album est d’ailleurs celui que je préfère dans cette carrière pourtant incroyablement riche. Dès l’ouverture It’s No Game, en compagnie d’une chanteuse japonaise, David Bowie réinventait le rock and roll. Les guitares stridentes de Scary Monsters (And Super Creeps) étaient les trompettes de l’apocalypse bling bling des années 1980 qui arrivaient.
Toujours en avance sur son temps, David Bowie anticipait la décennie de Bernard Tapie, achevée près de 10 ans plus tard dans le plus grand fracas par l’auteur Bret Easton Ellis avec les romans Glamorama et American Psycho. La chanson Fashion évoquait cyniquement cette mode devenue omniprésente qu’incarneront avec brio Thierry Mugler, ou l’icône Grace Jones. David Bowie n’était pas qu’au coeur des années Palace, il en fut l’inventeur.
Si David Bowie a créé l’esthétique des années 1980, il en fut aussi, très cruellement, la plus célèbre victime. Je ne parlerai pas ici de l’expérience Tin Machine (groupe rock brut de décoffrage qui ne correspondait pas à la personnalité de David Bowie), ni de ses incursions réussies au cinéma (avec Tony Scott pour Les Prédateurs au côté de Catherine Deneuve, ou bien le film d’héroïc fantasy Labyrinth, sans oublier l’émouvant film de guerre Furyo dont la chanson originale était interprétée par son copycat David Sylvian collaborant avec Ryuichi Sakamoto), et m’en tiendrai à la carrière solo de David Bowie. Trois albums sont sortis dans les années 1980 : Let’s Dance, Tonight et Never Let Me Down. Cette période est moins reluisante que les précédentes, c’est pour cette raison que je serai moins long.
Let’s Dance est un album réussi dans son genre. Un vrai disque commercial, un vrai succès. David Bowie était en ce temps le maître de l’industrie du spectacle. À son corps défendant ? Je ne le crois pas, David Bowie n’a jamais rechigné à atteindre un succès autre que de pure estime. David Bowie n’était pas un artiste incompris, il ne vivait pas en autarcie comme Peter Hammill qu’il admirait tant. Pourtant, on y trouvait ça et là quelques moments intéressants. Les tubes sont réussis et atteignaient leur objectif, la présence du guitariste Texan de blues Stevie Ray Vaughan surprenait, la version de China Girl était bonne… Ce n’était pourtant pas un grand disque. C’était un disque décevant compte tenu de la qualité à laquelle nous avait habitués son auteur.
Lire aussi : Antoine Volodine, Poète-monstre pour époque finale
Vinrent ensuite l’album reggae Tonight, sur lequel on trouvait la bonne chanson Loving The Alien (ainsi qu’une reprise pas dégueulasse de God Only Knows des Beach Boys), et Never Let Me Down, sur lequel on trouvait la bonne chanson Time Will Crawl. Rien de transcendant. Ces années 1980 furent un purgatoire pour David Bowie, incapable de renouer avec les succès commerciaux et critiques du passé. Pour bon nombre de connaisseurs, David Bowie n’était plus.
Ce qui importe chez David Bowie, c’est le timbre, c’est-à-dire la texture sonore de ses créations toujours produites avec la plus extrême précision.
David Bowie resta longtemps plongé dans ce purgatoire, trop longtemps pour un homme comme lui. La renaissance prit quelques temps. Il fut le lecteur de Pierre et le Loup de Sergei Prokofiev en 1988, puis joua avec le groupe Tin Machine. Assez pauvre. La renaissance vint en 1993, peu de temps avant son cinquantième anniversaire, par la grâce d’un album passé inaperçu à sa sortie, la bande originale de Buddha Of Suburbia. David Bowie donna tout pour cette petite bande originale, animée d’une nouvelle vigueur créatrice. L’album n’était pas impérissable mais il annonçait le retour d’un grand artiste.
En effet, deux ans plus tard David Bowie revenait avec un de ses meilleurs disques, l’excellent 1. Outside. Disque dense et difficile d’accès, influencé par la musique industrielle de Nine Inch Nails et du groupe expérimental The Swans, 1. Outside sait pourtant faire part aux sublimes mélodies typiques de David Bowie. No Control montrait déjà ce que Depeche Mode ferait près de dix ans plus tard ! Cet homme était décidément inépuisable. Ce qui importe chez David Bowie, c’est le timbre, c’est-à-dire la texture sonore de ses créations toujours produites avec la plus extrême précision.
Poursuivant sur sa lancée, et afin de célébrer dignement son cinquantième anniversaire (qui fut l’occasion d’un mémorable concert au Madison Square Garden en compagnie de la crème des rockeurs de l’époque), David Bowie sortait Earthling en 1997. Disque d’une très grande qualité, Earthling démontre que David Bowie fut éternellement à l’écoute de son temps. Jungle, musique industrielle trip-hop, métal, grunge. Tous les courants contre-culturels de l’époque sont analysés méthodiquement, et réinterprétés au travers du filtre du Bewlay Brother.
I’m afraid of Americans était à la fois une charge virulente contre l’Amérique marchande et omnipotente et une déclaration d’amour paradoxale. Un grand titre. La suite, moins marquante, ne fut pas pour autant dépourvue d’intérêt. Hours, Heathen et Reality ne sont pas de mauvais disques. Surtout Heathen qui a la particularité de présenter Cactus, une reprise des Pixies qui rend justice à la chanson originale, et I’ve Been Looking For You une reprise d’un rock de Neil Young assez grandiose.

David Bowie continua à exercer son art en dépit de ses soucis de santé. The Next Day était un genre d’hommage à sa carrière, un grand disque de rock énergique. Un premier testament d’une trilogie New-Yorkaise inachevée mais complétée par l’album Blackstar sorti il y a quelques jours. Un album en guise de cadeau d’adieu (toujours à la pointe avec ses emprunts à Avishai Cohen, Aphex Twin, ou bien encore à Tv On The Radio). Jazz pénétrant et dramatique mais digne jusqu’au bout. David Bowie était-il le dernier dandy anglais ? Un esthète européen nous a quitté, et, avec lui, une part de notre histoire artistique récente.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]
EN KIOSQUE
Découvrez le numéro du mois - 6,90€
Soutenez l’incorrect
faites un don et défiscalisez !
En passant par notre partenaire
Credofunding, vous pouvez obtenir une
réduction d’impôts de 66% du montant de
votre don.
Retrouvez l’incorrect sur les réseaux sociaux
Les autres articles recommandés pour vous
Restez informé, inscrivez-vous à notre Newsletter