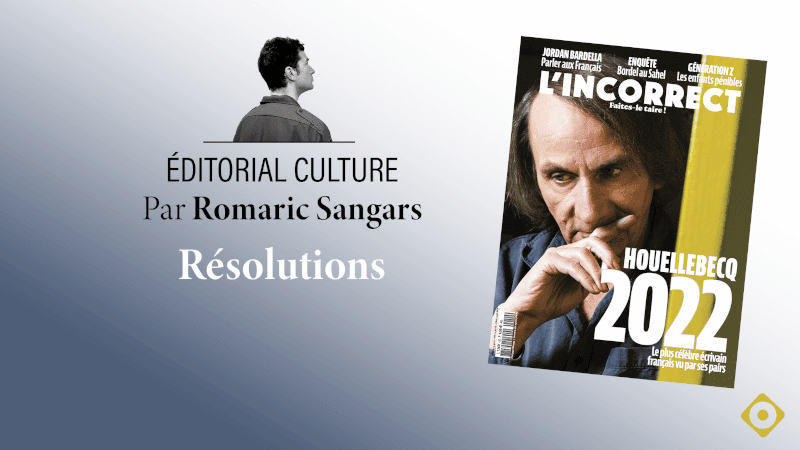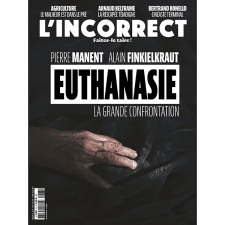Michel Houellebecq jouit aujourd’hui d’un statut de supériorité indiscutable dans le paysage littéraire national, au point qu’on a oublié combien de polémiques, sur ses propos comme sur son style, ont d’abord jalonné une irrésistible ascension débutée il y a trente ans. Alors que sort Anéantir, son huitième roman, l’heure du bilan a sonné, et nous avons réuni pour cela quelques écrivains à nos yeux remarquables et également sensibles à leur époque. Michel Houellebecq est-il le plus grand de nos écrivains vivants ? Il est en tout cas « le contemporain capital », pour Christian Authier, critique et romancier qui prépare justement un livre sur l’auteur de Soumission (Houellebecq politique, à paraître en mars chez Flammarion).
Pour Matthieu Jung, auteur du Triomphe de Thomas Zins, l’un des plus grands romans des années 2010, Houellebecq est « un écrivain considérable », quand Alexis Jenni, prix Goncourt 2011, s’interroge : « Faut-il donc le réaffirmer si souvent ? Je suis perplexe, je me demande quelle position est défendue par cette affirmation répétitive : prophétisme ou déni ». Nicolas Mathieu, qui reçut également le prix suprême en 2018, botte en touche, estimant que « la question du grand écrivain relève désormais du folklore » et qu’il a perdu de la puissance dans ses derniers romans, ce que note aussi Pierre Jourde, romancier impeccable et observateur lucide et féroce du milieu littéraire depuis bientôt trente ans. [...]