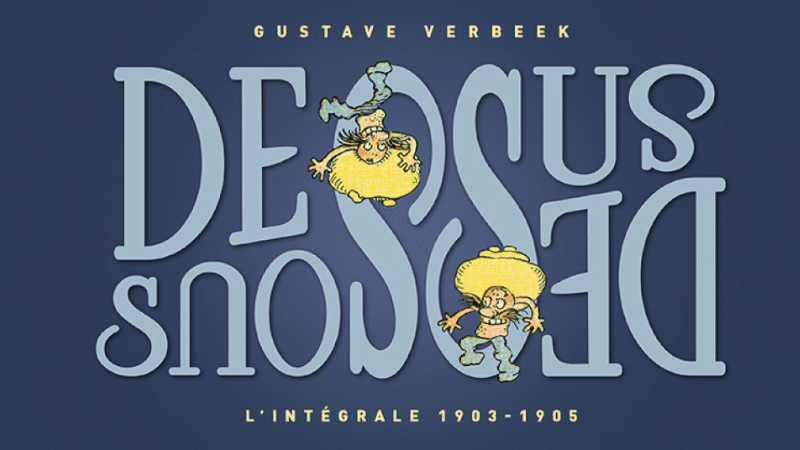Augustin Frison-Roche : Quand on se penche vraiment sur l'histoire de l'art, on voit qu’effectivement tout est religieux. On commence avec des tombes, des temples et le constat qu'on fait, c'est vraiment que l'art naît de la religion, naît du besoin de formaliser un rite. L’art réside dans cette dimension double, à la fois transcendante et pratique, de recréer un monde conformément à une vision. Car il n'y a pas de sociétés traditionnelles sans Dieu, sans spiritualité. Toutes les sociétés traditionnelles partent de ce constat : il y a un réel visible et un réel invisible. Et si on veut représenter le monde tel qu'il est vraiment, il faut représenter le réel visible et le réel invisible. L’art permet cette double représentation. Aujourd’hui dans un monde de plus en plus matérialiste, l'art garde quelque chose de cela. L'artiste ne peut pas s'empêcher finalement de recréer un monde conforme à son désir. [...]